Idées
Les juges entre l’application des règles en vigueur et l’impartialité
Les juges sont pris entre deux feux : d’une part, les exigences d’une société de moins en moins tolérante, et, d’autre part, les situations de détresse sociale, que vont engendrer les condamnations d’un père, frère, par ailleurs également soutiens de famille. Que faire alors ? Quel volet privilégier ?
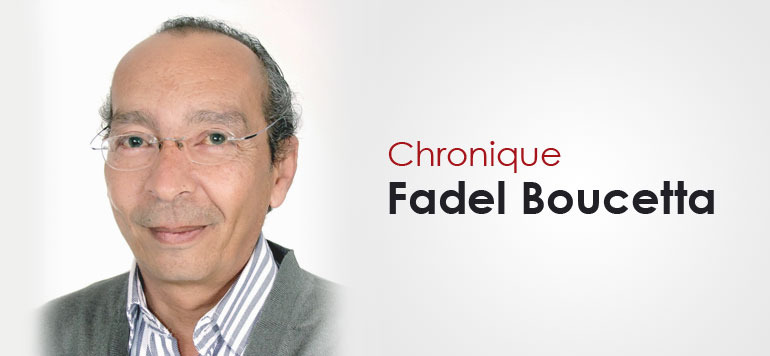
Nous avons abordé dans une précédente chronique le rôle primordial joué par les juges au sein d’une société. Il leur incombe de préserver un équilibre entre les différentes parties d’un conflit. La mission est noble, périlleuse, mais aussi ambiguë. Car comment dire le droit, appliquer les règles et règlements en vigueur, tout en faisant preuve d’une totale impartialité ? Quand un juge doit ordonner l’expulsion d’une famille entière qui ne paye plus ses loyers depuis belle lurette, il ne peut, quelque part, s’empêcher de penser à un cousin ou parent à lui, dont il connaît la situation précaire, et qui risque de se retrouver dans une pareille situation. Lorsqu’un magistrat préside une séance au tribunal correctionnel, que lui sont présentés, par exemple, des jeunes gens poursuivis pour viols ou outrage à la pudeur, et qu’il doit les condamner à des peines de prison, l’image fugace de sa propre fille lui traversant l’esprit fera en sorte que les condamnations seront plus sévères. C’est le quotidien des magistrats, juges et procureurs confondus. Ces derniers requièrent toujours les peines les plus lourdes, souvent au nom de l’exemplarité des châtiments, et au bénéfice de la société. Les juges, eux, sont pris entre deux feux : d’une part, les exigences d’une société de moins en moins tolérante, et, d’autre part, les situations de détresse sociale, que vont engendrer les condamnations d’un père, frère, par ailleurs également soutiens de famille. Que faire alors ? Quel volet privilégier ? Souvent le doute s’installe, car, après tout, le juge est avant tout un Homme, croyant en ses certitudes, convaincu de la justesse de son raisonnement, et conscient de sa formation académique pointue. Car l’on ne devient pas magistrat par hasard, comme ça du jour au lendemain. Le chemin est long, parsemé de concours, d’examens, de stages et d’évaluations de toutes sortes. Puis, un jour…c’est le grand jour : l’apprenti magistrat va se retrouver présidant une séance au tribunal, n’ayant pour limites que ce que dictent les textes de loi, et sa propre conscience. Et c’est là que cela devient intéressant, car de la conviction humaine vont dépendre des milliers de cas. Cette conviction n’est pas toujours la même, et dépend de la personnalité du magistrat : ainsi, dans deux salles correctionnelles juxtaposées, les délinquants en instance de jugement (et en bons connaisseurs des arcanes du Palais de justice) savent que, dans celle de droite, le juge est un Monsieur affable, courtois, calme et pondéré…mais d’une sévérité implacable : avec lui point de sursis à espérer, il serait plutôt du genre à contribuer au surpeuplement carcéral à lui seul ! Par contre (et ça tout le monde le sait, pour reprendre une célèbre expression), dans la salle de gauche, sous des airs bourrus et renfrognés, sans le moindre sourire ou sentiment de compassion, le juge dissimule un humanisme profond, grâce auquel il est capable d’empathie, aussi bien avec les délinquants qu’avec les victimes, toujours enclin à étudier le fond du fond des dossiers, afin d’accorder, autant que faire se peut, des circonstances atténuantes aux prévenus qu’il va juger. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les juges sont aussi polyvalents ; selon les tribunaux, les régions, les nécessités du service, un magistrat peut être procureur un jour (soit la magistrature debout), juge un autre jour (soit la magistrature assise) ; les rôles ne sont pas les mêmes, et donc le magistrat doit s’adapter, passant, sans crier gare, d’un côté à l’autre. Tout ceci fait de la fonction de magistrat une situation fort recherchée, très demandée, et, dans tous les cas, très honorifique. D’ailleurs, pour s’en convaincre, il convient de relever que les magistrats rendent la justice «au nom du Roi», et que, dans la Fonction publique, les procureurs (seuls avec les ambassadeurs et les gouverneurs) officient avec le grade et l’appellation «Procureur de Sa Majesté». Ceci toujours dans le souci d’affirmer la puissance et la force de la loi, et de ceux chargés de veiller à son application.

