Idées
La loi et l’esprit de la loi
Quiconque fréquente les prétoires de tribunaux constate que la gent féminine est fort présente. On trouve des femmes occupant la fonction de «présidente de chambre», de «conseillère près la Cour d’appel», ou, même si c’est encore assez rare, présidente de tribunal. Seulement voilà, on constate une quasi-absence des femmes dans les Cours d’assises ou dans les tribunaux traitant d’affaires pénales.
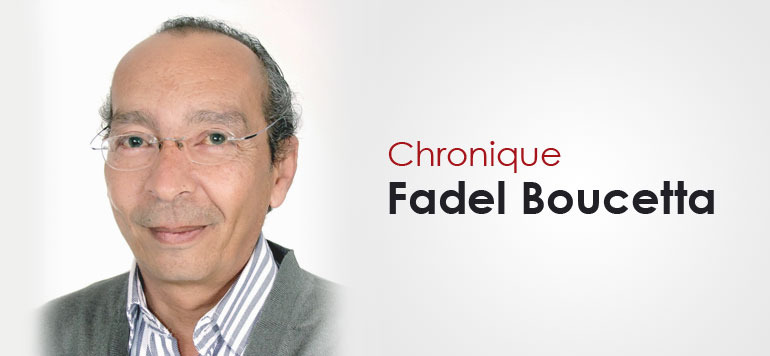
Il y a la loi, puis l’esprit de la loi, cher à Montesquieu, et enfin l’application de la loi, qui est du ressort humain puisque mise en œuvre par des hommes. Le résultat peut être parfois étonnant. Prenons le cas, courant, des litiges de loyer. Un locataire se retrouve en retard de paiement de son loyer. La loi est claire: en cas de manquement à ses obligations, il se verra expulsé du local qu’il occupe, par un tribunal faisant une application normale des textes en vigueur. Seulement voilà, les choses ne sont pas toujours aussi évidentes. Récemment, un cas similaire était soumis à l’appréciation des juges. Un propriétaire demandait l’expulsion de son locataire, qui ne payait plus son loyer depuis quelque temps déjà. Pour son excuse, ce dernier arguait de difficultés conjoncturelles : maladie, puis perte d’emploi, et donc de salaire. Le tribunal opta pour une solution ambiguë, condamnant le locataire à régler les loyers dus, sous astreinte pécuniaire par jour de retard, mais refusa l’expulsion. L’argumentation et les attendus de l’arrêt expliquaient que, certes, le règlement du loyer était un impératif contractuel ; mais en même temps, il estimait que l’expulsion aurait eu pour résultat de mettre une famille entière à la rue, augmentant ainsi le nombre de citoyens en situation précaire, et mettant en danger l’unité d’une famille, composée notamment d’enfants en bas âge. L’appréciation, en elle-même, est correcte, mais l’application de la décision posait problème. En effet, un tribunal, à côté de l’application stricte des textes, joue, au sein de la société, le rôle de régulateur, essayant d’équilibrer certains rapports de force qui s’établissent entre citoyens. Un propriétaire foncier dispose de moyens (dans tous les sens du terme), qui le mettent en position de force par rapport à son locataire ? Ce dernier, du fait souvent de la conjoncture, n’est pas en mesure de faire face aux pressions qui s’exercent sur lui: paiement ou expulsion. Et c’est là qu’intervient le magistrat, dont le rôle principal est de veiller à une saine application des mesures législatives. Seulement voilà, en donnant satisfaction à l’une des parties, on condamne l’autre partie à basculer vers la précarité. C’est le difficile rôle des juges dans tous les tribunaux, où il faut sans cesse pouvoir trancher et résoudre un litige, sans pour autant créer des situations encore plus complexes. Les choses se compliquent lorsqu’il s’agit de dossier pénal ; là il s’agit non seulement de régler des conflits, mais aussi, souvent, de priver les gens de leur liberté, ce qui n’est pas simple. A ce propos, une remarque s’impose: quiconque fréquente les prétoires de tribunaux constate que la gent féminine est fort présente. On trouve des femmes occupant la fonction de «présidente de chambre», de «conseillère près la Cour d’appel», ou, même si c’est encore assez rare, présidente de tribunal. Seulement voilà, on constate une quasi-absence des femmes dans les Cours d’assises, ou dans les tribunaux traitant d’affaires pénales. Dans ces tribunaux, il n’est plus question de loyers impayés, d’échéances non honorées ou de crédits en souffrance. Là, l’objet principal, si l’on ose dire, est l’humain. Il s’agit de tribunaux répressifs, où l’on distribue à la chaîne les années de prison, voire la peine de mort. Pas de femmes dans ces tribunaux, le législateur estimant sans doute qu’étant donné la traditionnelle sensibilité féminine, des dames seraient bien embarrassées, s’il fallait condamner un prévenu à la peine capitale ou à une réclusion criminelle à perpétuité. En Europe, et notamment en France, dont nous avons repris en gros la structure du système juridique, ces états d’âme n’existent pas. Isabelle Prévost-Desprez est une magistrate française, présidente de la Cour d’assises de Paris, qui a enchaîné les grands procès criminels…et avec elle, ça ne rigole pas, tant les verdicts prononcés sont sévères, mais toujours d’une grande qualité juridique, que même les ténors du barreau français apprécient. On espère donc que dans le cadre d’une féminisation accrue de nos tribunaux, on puisse voir un jour une femme présider un tribunal criminel, et statuer ainsi sur des dossiers épineux, qui retiennent et captent l’attention du public.

