Idées
Les affres de la garde à vue
la geôle d’un commissariat, prévue pour accueillir des délinquants endurcis, n’a pas à ressembler à un palace.
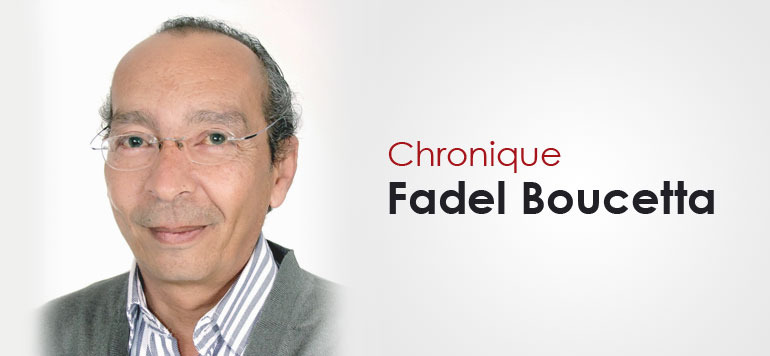
La semaine dernière, les déboires judiciaires d’une star marocaine ont défrayé la chronique en France comme au Maroc. Au-delà de ce fait divers, c’est l’aspect juridique qui nous intéresse le plus. Le public a donc appris que l’artiste avait été mis en examen (c’est-à-dire formellement inculpé de certains faits et gestes), puis placé en garde à vue. Que signifie exactement, techniquement et pratiquement une garde à vue ? Cela commence dès l’interpellation par la police, qui conduit l’intéressé au commissariat. À partir de là (disons qu’il est midi un vendredi), on lui signifie qu’il est là pour 48h, soit jusqu’à dimanche à midi. Mais comme ça tombe en week-end, les procureurs ont tendance à la prolonger de 24h…officiellement pour les besoins de l’enquête. Au commissariat, c’est la totale : l’interpellé doit se dévêtir entièrement pour une palpation (ou fouille) intégrale, dite de sécurité, histoire de voir si rien n’est dissimulé, dans la bouche, les cheveux, ou autres parties du corps. Ses habits sont auscultés un par un. Chemise, pantalon, dessous, veste, chaussette, cravate, pull… tout est palpé minutieusement. Puis l’interpellé se rhabille, mais sans sa ceinture, ni ses lacets de chaussure et sa cravate. On l’installe dans une espèce de grande pièce, sans fenêtre, mais avec une vitre blindée qui donne sur l’intérieur du commissariat. On est gardé, donc, à la vue des policiers qui veillent à éviter tout suicide éventuel…ou agressions diverses, car dans cette pièce (appelée aussi le dépôt) arrivent en continu les personnes interpellées durant les rondes de police. On peut donc y croiser des dealers, des maquereaux, des tueurs, des braqueurs, des caïds de banlieue… Bref, tout un assortiment de gens que l’on n’a pas l’habitude de côtoyer. Interdiction de fumer, de manger… On attend, on observe le roulement chez les policiers : ceux qui arrivent prendre leur service, ceux qui s’en vont, les jeunes, les anciens, ceux qui chargent leur arme avant de partir en tournée… En somme, la vie intime d’un commissariat, vu de l’intérieur. On attend, les heures passent, et on attend toujours.
Dans les commissariats, les avocats ne sont pas les bienvenus, donc aucun secours à attendre de ce côté, on attend donc, encore et toujours; on essaye de dormir un peu, mais c’est difficile: trop de bruits, d’odeurs, de portes qui claquent, de cliquetis divers, de ronflements, de coups de gueule des policiers, d’arrivants excités : bref, une ambiance dantesque ! Et comme on n’a plus de montre et que les locaux de garde à vue n’ont aucune fenêtre donnant sur l’extérieur, on perd la notion du temps qui passe. Quelle heure est-il? Comment est le temps ? Fait-il nuit ou jour? Pas de radio, ni de lecture, aucune distraction: on attend, encore et toujours….et ce petit jeu peut durer 48 h, les magistrats professionnels sachant que cela ramollit les délinquants les plus durs ; alors les tendres…
Les juges savent que pour sortir de là, tout le monde est prêt à passer aux aveux, ça simplifie les choses ! Et en général, comme dans un ballet bien rodé, on trouve toujours à proximité un «gentil» policier qui vous invite gentiment à dire rapidement toute la vérité pour sortir de cet enfer. Car, argumentera-t-il, c’est uniquement devant le juge que la vraie discussion aura lieu…et souvent les gens cèdent, bêtement, en répondant à certaines questions apparemment anodines, mais qui serviront de preuve contre eux plus tard.
Le passage par une garde à vue est le moment le plus éprouvant dans le parcours judiciaire. La prison, à côté, serait un véritable éden ! Car durant la durée de la GAV, on fait sentir aux individus qu’ils n’existent plus aux yeux de la société ; on les a retirés du circuit social car ils ont commis une bêtise. Laquelle peut aller du multiple homicide avec préméditation, à une banale escroquerie portant sur 1000 DH ! Ils n’ont plus aucun droit, sinon celui de respirer : on mange quand on vous donne à manger ; on ne sort pas d’une pièce fermée à clé ; on n’a plus aucun contact, même visuel avec le monde extérieur ; personne à qui faire la conversation, ou un livre pour passer le temps, voire un magazine ou un journal ; on ne dort pas non plus, les conditions de confort étant minimales! Alors ce traitement a toujours choqué beaucoup de gens, qui dénoncent sa dureté et son impartialité aveugle. Mais du côté juridique, on répond qu’on ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs, et que la geôle d’un commissariat, prévue pour accueillir des délinquants endurcis, n’a pas à ressembler à un palace ! C’est pourquoi on ne saurait trop conseiller aux honnêtes gens d’éviter ce genre d’expérience qui demeure traumatisante à vie.

