Idées
La privation de liberté, une décision à prendre avec précaution
La loi prévoit qu’une personne peut être privée de sa liberté (provisoirement, n’est-ce pas ?), dans trois cas bien précis…pas quatre ou cinq, mais bien trois: d’abord, il s’agit d’empêcher une fuite éventuelle du suspect vers d’autres cieux ; ensuite, l’empêcher de communiquer avec d’autres personnes impliquées dans la même affaire, et enfin pour éviter la destruction éventuelle de preuves confondantes.
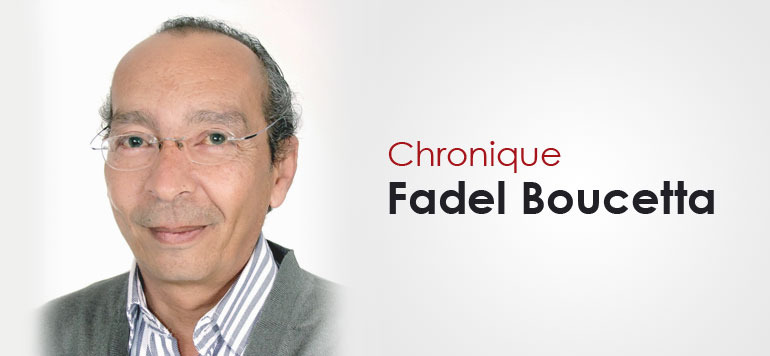
La multiplication des affaires pénales incriminant des personnes connues, tant en France qu’au Maroc, amène les gens à découvrir dans les colonnes de la presse tout un vocabulaire spécial bien connu des gens du prétoire, mais parfois assez confus pour le commun des mortels. Et il faut dire que les notions juridiques elles-mêmes, ainsi que la terminologie employée, concourent à cette confusion. Essayons donc d’apporter un éclairage à ce sujet.
Penchons-nous d’abord sur la notion de «détention provisoire». Elle s’oppose frontalement à deux autres principes chers au législateur : la présomption d’innocence et …la liberté provisoire. Chez les juristes, apparemment, on n’est jamais sûr de rien, et donc restons dans le provisoire ! Le premier principe est clair : tout suspect est réputé innocent, jusqu’à ce que sa culpabilité soit officiellement reconnue par un tribunal. En effet, dans son dossier, il peut y avoir des failles, des PV mal rédigés, des faits contradictoires ou encore l’absence de preuves décisives. Le suspect est donc innocent…et pourtant on le place en détention provisoire, donc on l’incarcère, donc il va en prison et on le prive de sa liberté. Pourtant, en droit, la privation de liberté est une notion délicate, à manier avec précaution, si l’on entend respecter les dispositions constitutionnelles. Et pourtant, bien des magistrats de par le monde usent et abusent de la mise en détention provisoire, malgré les dispositions annexes.
La loi prévoit qu’une personne peut être privée de sa liberté (provisoirement, n’est-ce pas ?), dans trois cas bien précis…pas quatre ou cinq, mais bien trois : d’abord, il s’agit d’empêcher une fuite éventuelle du suspect vers d’autres cieux ; ensuite, l’empêcher de communiquer avec d’autres personnes impliquées dans la même affaire (par exemple pour préparer de gros mensonges à servir aux magistrats) et enfin pour éviter la destruction éventuelle de preuves confondantes. Cela se tient, et les juges emploient donc cette méthode de privation dans certains dossiers. Mais la loi a également prévu d’autres moyens que la détention préventive, pour arriver aux mêmes fins de contrôle. Le prévenu est alors mis en «liberté provisoire», (toujours le provisoire), sous certaines conditions. Il devra verser au Trésor public une caution : et plus elle est élevée, moins le prévenu ne risque de s’envoler, sinon, adieu la caution. Il sera mis sous contrôle judiciaire, c’est-à-dire l’obligation de rester dans une zone géographique délimitée, (par exemple la région du Grand Casablanca), et n’en sortir sous aucun prétexte sans en avertir le parquet en charge de son dossier. Et enfin, il sera astreint à se rendre une fois par jour (ou par semaine, selon les cas) au commissariat de son quartier afin de signer une fiche de présence. C’est pour ces différentes raisons que l’opinion publique s’émeut dès qu’une personne connue est placée en détention provisoire. A tel point que, dans une récente affaire, le président du parquet a publié un communiqué, affirmant que telle personne incarcérée bénéficie de conditions de détention «parfaites», donnant moult détails, plus embarrassants qu’autre chose ! Il serait donc peut-être temps de procéder à un relifting du Code de procédure pénale, limitant les cas de détention provisoire aux affaires vraiment graves, et aux suspects particulièrement dangereux. Cela contribuerait à renforcer l’Etat de droit au Maroc, et clouerait le bec aux traditionnels détracteurs de notre pays. Et tout se prête à ce réaménagement juridique : une législation en ce sens est, d’ores et déjà, prête dans les grandes lignes, et n’attend plus que les décrets d’application. Espérons que le rythme va s’accélérer et que les nouvelles dispositions seront rapidement mises en œuvre.
