Pouvoirs
« Le cheikh et le calife », nouvelle réflexion sur l’islam politique au Maroc
En trois périodes historiques, l’auteur analyse l’interaction de trois acteurs politiques et religieux :la monarchie, le Mouvement unicité et réforme et Al Adl.
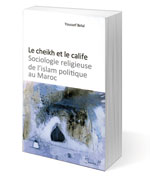
Le livre de Youssef Belal, Le cheikh et le calife, sociologie religieuse de l’islam politique au Maroc(*), publié en cette fin de mois de janvier aux éditions Tarik, ne pouvait pas mieux tomber. Les transformations politiques et sociales que vit le monde arabe, y compris le Maroc, depuis la révolution du jasmin rendent sa lecture intéressante. L’ouvrage est certes le fruit d’une enquête de terrain menée pour les besoins d’une thèse de doctorat en sciences politiques soutenue à Lyon en 2007, mais cela n’enlève rien à son actualité (voir encadré). L’auteur a choisi comme sujet d’étude, en plus de la monarchie en tant qu’acteur religieux et politique de premier plan, les deux mouvements de prédication, ou ce qu’il appelle «communautés émotionnelles» : le Mouvement unicité et réforme (MUR) et la Jamaâ (Al Adl) d’Abdessalam Yassine.
Pour commencer, il soulève un constat : la religion n’a jamais été neutre ou absente dans le discours et les actions politiques. Cela aussi bien chez les détenteurs du pouvoir que chez d’autres acteurs, qu’ils soient purement religieux ou de simples acteurs politiques sans aucune obédience religieuse.
Outre les acteurs, l’auteur s’est intéressé à leur évolution dans le temps. Il a dégagé trois périodes historiques du Maroc. Son travail couvre ainsi la période du Protectorat français, celle de l’indépendance sous le règne de Hassan II, et celle, actuelle, sous celui de Mohammed VI. Ceci lui a permis d’aboutir à un autre constat : d’un côté, la religion a toujours occupé la sphère publique et, de l’autre, l’existence d’espaces profanes et de pratiques séculières n’est pas forcément contradictoire avec la religion.
Au fil de son analyse, l’auteur met l’accent sur une réalité historique en lui consacrant tout un chapitre : le Mouvement national, né pendant les années 30 du siècle dernier, a été nourri par les idées de la salafiya prônées par Allal El Fassi et ses compagnons.
Le régime du Protectorat a usé, lui aussi, de la religion, pour déposer le Roi Mohammed V en 1953 au nom de l’islam. Bien avant, le maréchal Lyautey, premier résident général de la France au Maroc, écrivait déjà en 1915, comme le cite l’auteur lui-même : «Je n’ai tenu le Maroc jusqu’ici que par ma politique musulmane, je suis sûr qu’elle est bonne et je demande instamment que personne ne vienne gâcher mon jeu».
Au lendemain de l’indépendance, cette réalité n’a pas changé. Là encore, ce ne sont pas les exemples qui manquent. «La gauche, écrit l’auteur, dont les dirigeants ont été éduqués par la salafiya, affirme son attachement à l’islam et, parfois, a recours au langage théologique dans la lutte de pouvoir qui l’oppose à Hassan II». D’un autre côté, Allal El Fassi a usé tour à tour de son statut de alem et de celui de zaïm du Parti de l’Istiqlal dans ses écrits pendants les années 60. N’est-ce pas lui-même, cela dit en passant, qui a suggéré d’insérer la commanderie des croyants dans la première Constitution de 1962 ? De même, c’est au nom de l’islam que le Parti communiste marocain (PCM) a été interdit en 1959. Par ailleurs, si le Roi Hassan II a accumulé son capital religieux, dit l’auteur, dès les premières années de l’indépendance, ce n’est qu’avec la Marche verte de 1975 qu’il est consacré «guide de la communauté nationale dans une mise en scène du sacrifice et de la fusion mystique du Roi et du peuple».
Pouvoir : le fondement est religieux, l’exercice profane
Les mouvements islamiques marocains, nés à partir des années 70 du siècle dernier, notamment la Jamaâ de Yassine et le MUR de Raissouni, sur lesquels Youssef Belal met l’accent dans cette recherche, ont su, eux aussi, répartir leurs tâches entre religieux et politique. Ainsi, au sein de la Jamaâ, le cheikh Yassine est médiateur entre Dieu et les croyants, les acteurs politiques (comme Nadia, sa fille), eux, tiennent un discours séculier, «et le cercle politique -structure dédiée à la vie publique- dispose d’une grande autonomie tout en étant soumis à Yassine». C’est à peu de chose près le même scénario au MUR : d’un côté, le mouvement (dirigé alors par Ahmed Raïssouni avant sa démission suite aux attentats du 16 Mai 2003) se consacre aux fonctions strictement religieuses et à l’éducation à la vertu ; de l’autre, le PJD, qui se veut un parti politique comme les autres, est, de ce fait, un acteur séculier dans la société. Concernant la monarchie, l’auteur estime que la symbolique religieuse n’a jamais été incompatible avec l’existence d’un espace profane. Là encore, il cite un exemple : le Roi Hassan II, alors qu’il a fait le choix d’une politique publique d’inspiration socialiste en nommant Abderrahmane Youssoufi à la tête du gouvernement en 1998, n’a pas hésité à renforcer le contrôle de l’Etat sur les oulémas qui ont fini par accepter leur fonctionnarisation. Ce qui fait dire à l’auteur que si «le fondement du pouvoir au Maroc est religieux, son exercice est profane».
*ENS éditions 2011, Lyon, France. Tarik éditions 2012, Maroc. 330 pages. 80 DH

