Pouvoirs
La GSU survivra-t-elle à la multiplication de ses courants ?
Après «l’Action démocratique», un autre courant, «l’Initiative démocratique», a vu le jour début mars.
Les deux courants ne ménagent pas leurs critiques envers le parti, tiraillé entre gauche radicale et large front démocratique.
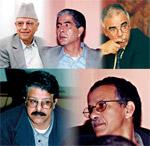
La Gauche socialiste unifiée (GSU) est-elle en train de subir le dictat des courants ? Après l’émergence, en juillet dernier, de l’Action démocratique, avec pour chefs de file Ahmed Harzenni et Kamal Lahbib, un deuxième courant, l’Initiative démocratique, a vu le jour lors d’une conférence nationale tenue le 6 mars à Rabat.
Cette fois-ci, c’est Omar Zaïdi, l’un des fondateurs de la GSU et figure connue de l’extrême gauche des années 1970, qui en est l’initiateur. Le communiqué rendu public à l’issue de cette conférence n’y est pas allé avec le dos de la cuillère à l’égard des dirigeants du parti de Mohamed Bensaïd. Le communiqué fustige les travaux du premier congrès. «Certains, dit le communiqué, ont réussi à tenir un congrès formel, avec, comme horizon, de fonder une organisation qui gère les contradictions du parti avec une logique qui ne diffère en rien de la culture du Makhzen.» En fait, c’est moins le principe de l’émergence de ce nouveau courant au sein de la GSU que son timing qui pose problème.
Un des points de divergence concerne la participation au gouvernement
Les statuts fondateurs de la GSU légalisent officiellement la pratique des courants depuis son premier congrès de juillet 2004. Une première dans l’histoire des partis politiques marocains de gauche. «C’est la seule manière d’éviter la fragmentation du champ politique et les scissions. Unité ne doit pas être égale à uniformité. Le pouvoir au sein du parti reviendra au courant majoritaire qui a su former des alliances à l’occasion du congrès», souligne El Mostapha Meftah, secrétaire général adjoint du parti.
Toute plate-forme détenant 10% et plus des voies pendant le congrès, stipulent les statuts de la GSU, a le droit de s’ériger en courant: le premier à voir le jour conformément à cette règle a été l’Action démocratique, formé à la veille du premier congrès par Ahmed Harzenni et Kamal Lahbib. Plus, pour encourager ce phénomène de courant, et l’instituer comme culture fondatrice du parti, certains militants, alors même qu’ils n’adhéraient pas aux idées formulées par la plate-forme de l’Action démocratique, avaient soutenu ce courant pour lui permettre d’obtenir ses 10 % légaux.
Selon cette logique, un courant ne peut tirer sa légalité que du congrès. «Dire qu’il faut un congrès pour qu’il devienne légal est une fausse idée. On n’a lié la constitution d’un courant au congrès que pour lui donner une chance de représentativité dans les organes dirigeants du parti», rétorque M. Zaïdi. Est-ce à dire que la culture de courants n’est pas encore assimilée par les militants de la GSU ? «Non, répond Mustapha Bouaziz, cadre du parti. Parmi les militants, certains considèrent que le courant est un parti au sein du parti ; on serait alors en présence d’une fédération de partis, ce n’est pas le cas de la GSU. Le parti à courants a une direction nationale, mais il permet aux différentes sensibilités de s’organiser et de s’exprimer, à condition de ne pas empêcher le parti de travailler en tant que corps, selon le principe de la majorité. Il faut savoir résoudre l’équation : diversité dans l’unité».
Ahmed Jazouli, président du Centre de démocratie et auteur d’un livre sur les partis politiques marocains, va dans le même sens. «Des courants institutionnalisés au sein des partis n’ont jamais existé au Maroc, rappelle-t-il. La GSU en fait une première expérience. Mais elle ne la réussira qu’en instaurant une démocratie interne et en permettant à la minorité de s’exprimer librement et de défendre ses points de vue, c’est le congrès qui tranche par vote.»
Au-delà des questions de légalité des courants, que reproche-t-on au parti ? Pour répondre à cette question, un retour en arrière est nécessaire.
Depuis sa création, en juillet 2002, par la fusion de quatre composantes de la galaxie marxiste-léniniste (OADP, Mouvement pour la Démocratie , Démocrates Indépendants et d’autres sensibilités de gauche), la Gauche socialiste unifiée (GSU) se démène pour résoudre l’équation : comment concilier diversité et unité ?
En fait, le parti de Mohamed Bensaïd, avant même sa création, a toujours été tiraillé entre deux alliances. D’une part, le Rassemblement de la gauche démocratique (RGD) ou G5, qui regroupe le Parti de l’avant-garde démocratique et socialiste (PADS) d’Ahmed Benjelloun ; Annahj Addimocrati de Abdallah El Harrif ; le Congrès national ittihadi (groupe Bouzoubaâ-Amaoui) ; Fidélité à la démocratie de Mohamed Sassi et la GSU. D’autre part, le Pôle démocratique, large coalition allant de l’USFP jusqu’aux islamistes d’Al Badil Al Hadari, en passant par le PPS et le PSD, et même par des personnalités indépendantes qui partagent les mêmes idéaux de démocratie et de citoyenneté. Au lieu de continuer de tirer à boulets rouges les uns sur les autres, les camarades d’hier se sont engagés, en effet, à mettre en valeur ce qui les unit d’abord : le plus grand chantier est la réforme constitutionnelle. Une réforme dans le sens d’une véritable séparation des pouvoirs dans une monarchie parlementaire où le Roi règne mais ne gouverne pas. Le G5 fait de cette réforme un impératif pour toute transition démocratique. Au sein de ce groupe, les relations entre la GSU et l’association Fidélité à la démocratie vont encore plus loin, puisqu’elles ont opté pour la fusion et ont fixé sa date : juillet 2005.
La Koutla est morte mais on visite régulièrement sa tombe
Le Pôle démocratique s’inscrit en fait davantage dans le registre du virtuel que du réel. Il faut dire qu’un froid s’est installé dans les relations entre les trois composantes de la Koutla (USFP, PI et PPS) et l’OADP, depuis la formation du premier gouvernement Youssoufi, en 1998 (l’OADP était le seul parti de la Koutla à avoir voté contre la Constitution de 1996 et à avoir boudé, deux ans plus tard, la participation au gouvernement d’alternance). Les relations avec le parti de Mohamed Bensaïd se sont encore détériorées depuis la fusion de l’OADP dans la GSU et le rapprochement de celle-ci avec les autres météores de l’extrême gauche. Les ponts n’ont jamais été totalement coupés (la Koutla s’est réunie au grand complet au lendemain des événements du 16 mai), mais il est patent que la GSU a choisi son camp. «L’alliance sur laquelle il y a des avancées réelles est celle initiée avec le G5. Mais nous croyons toujours qu’il serait important de revenir à l’esprit de la charte fondatrice de la Koutla qui faisait de la réforme politique et institutionnelle une condition à toute avancée démocratique», reconnaît M. Meftah.
Mustapha Bouaziz formule deux scénarios : l’un, utopiste, verrait tous les gens de gauche rassemblés au sein d’un seul parti, mais avec des courants différents, depuis l’USFP jusqu’à la gauche radicale. L’autre, plus réaliste, imagine deux partis, avec des courants : l’un formé de l’USFP, du PPS et du PSD, une sorte de social-démocratie ; l’autre, de la GSU et des partis de la gauche radicale, «le grand parti socialiste» en quelque sorte. Quelle différence ? «Différence d’appréciation de la conjoncture entre les deux : le premier pense que le passage à la démocratie passe par la participation au gouvernement, l’autre croit que le passage au gouvernement est un degré d’intégration dans l’actuel système et que toute transition à la démocratie a un impératif : la réforme de la constitution», répond M. Bouaziz.
C’est cette différence d’appréciation politique de la conjoncture qui a donné naissance aux deux courants, l’Action démocratique et l’Initiative démocratique. Les deux se rejoignent sur un point : ils ne sont pas d’accord sur l’évaluation que fait le parti de la conjoncture politique. Kamal Lahbib l’exprime ainsi: «Nous estimons que la phase que traverse le pays actuellement est une phase de transition démocratique réelle. Nous prônons un large front démocratique plutôt qu’une alliance avec une extrême gauche qui ne fera que nous bloquer. Notre courant ne fait pas de la réforme constitutionnelle un préalable. C’est beaucoup plus complexe que ça». Comment la GSU parviendra t-elle à inculquer une culture des courants tout en préservant son unité ? C’est toute la question
Mohamed Bensaïd, Ahmed Harzenni, El Mostafa Meftah (en h.), Omar Zaïdi et Kamal Lahbib, figures de proue de la GSU, confrontés à la difficulté de développer une culture des courants sans affaiblir le parti.

