Société
Hassan Semlali : « On est beaucoup plus dans la formation des formateurs en matière des droits de l’homme »
Nous voulions mettre en confrontation les expériences internationales et la nôtre dans ce domaine. Les rapports qui en résultent sont de nature à enrichir la littérature transitionnelle, du moins à mettre entre les mains des chercheurs une matière de travail.
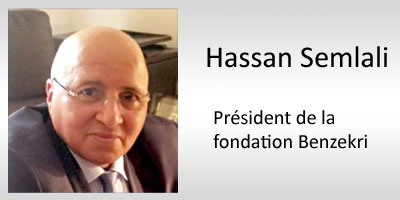
Créée en mai 2008, soit un an après le décès du père de la justice transitionnelle au Maroc Driss Benzekri, la Fondation pour les droits humains et la démocratie qui porte son nom entame sa vitesse de croisière avec un nouveau programme qui s’étend sur trois ans. Son président actuel, Hassan Semlali, ancien détenu politique ayant passé 15 ans en prison, compte poursuivre le travail destiné aux cadres des ONG en matière de formation sur les mécanismes internationaux des droits de l’homme.
Six ans après sa création, on a l’impression que la fondation est une coquille vide…
Non, pas une coquille vide. C’est vrai, la fondation est passée à ses débuts par une période de tâtonnements où il fallait mettre en place une conception de travail qui cadre avec le legs et la mémoire de Driss Benzekri. Mais, depuis 2010, la fondation a pris son envol et notre conception de travail a été bien arrêtée. Il ne s’agit surtout pas d’une structure qui défend les droits de l’homme au quotidien comme c’est le cas à titre d’exemple de l’OMDH ou de l’AMDH, mais d’une fondation qui fait une évaluation périodique de la situation des droits de l’homme au Maroc à travers des colloques, des séminaires avec des thématiques bien précises. On n’est pas dans l’action quotidienne et directe, mais dans la réflexion et l’évaluation. Notre dernière action en date est le colloque sur la réforme de la justice que nous avons organisé en 2013 à Rabat, auquel ont assisté des avocats, des professeurs de droit, des juges et des représentants de la société civile.
Avez-vous arrêté un programme de travail ?
Bien entendu. Un premier programme a déjà pris fin, il s’est étalé de 2010 à 2013, programme axé spécialement sur la formation des formateurs en matière des droits de l’homme. Cette formation a touché en septembre 2011 et à l’échelon maghrébin les acteurs issus des partis politiques, de la société civile, mais aussi des journalistes. Ce sont des experts du centre des droits de l’homme de Genève qui l’ont assurée en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert. Nous avons constaté en effet que ces acteurs ne maîtrisent pas suffisamment les mécanismes et les instruments internationaux dans ce domaine et donc il fallait combler leur déficit en termes de compétence. Deux ateliers ont été organisés avec comme objectif de doter ces jeunes du Maghreb des capacités et des savoirs en matière des droits de l’homme comme l’appréhende le système onusien, mais aussi de renforcer les compétences des cadres des ONG dans l’élaboration de rapports et de plaidoyers tant à l’échelle nationale qu’internationale. Nous avons aussi organisé, à la veille de la Constitution de 2011, un séminaire pour évaluer le chemin accompli dans l’application des recommandations de l’IER et nous avons formulé des propositions dans ce sens. Maintenant, on entame pour quatre ans un nouveau plan de travail de formation sur les droits humains, et aussi d’évaluation des organismes de gouvernance sur des thèmes comme la liberté de presse, la liberté de conscience ou encore l’amazighité. Nous allons créer aussi un institut, une espèce d’université, pour enseigner les valeurs de la justice transitionnelle et former des cadres en la matière. N’oubliez pas que l’expérience de la justice transitionnelle de l’IER est un modèle au plan international et dans le monde arabe.
Justement, qu’a fait votre fondation pour appliquer ces recommandations, plusieurs sont restées lettre morte…
Il n’est pas du ressort de la fondation de suivre leur application. Il faut d’abord rappeler que le rapport final de l’instance est tout un programme de justice transitionnel et de construction de la démocratie. Parmi ces recommandations il y en a qui s’inscrivent dans la durée, certaines ont été incluses dans la nouvelle Constitution, ce sont les réformes institutionnelles, comme par exemple la primauté du droit international humanitaire sur le droit interne, ou encore l’indépendance de la justice. D’autres, c’est vrai, bien qu’amorcées, marquent du retard, comme par exemple la question des archives nationales. Une loi sur le sujet a été adoptée, mais il faut aller au-delà, car qui dit préservation des archives dit préservation de la mémoire. Même chose pour la réhabilitation communautaire qui suppose un développement à long terme des régions qui ont souffert des années de plomb, or sur ce sujet il faut dire qu’il n’y a pas un mécanisme de suivi. La réinsertion sociale et professionnelle n’est pas encore tout à fait réglée, là aussi, un mécanisme de suivi fait défaut.
Oui, ça n’est pas du ressort de la fondation, mais où en est le CNDH dans tout cela ?
Le CNDH n’est pas un organe d’exécution de ces recommandations, et même s’il l’aurait souhaité il n’a pas les moyens de le faire. La réhabilitation communautaire, l’insertion professionnelle des victimes des années de plomb ou la couverture médicale, le CNDH propose, mais c’est en fait l’Exécutif qui doit agir.
n La fondation ne devrait-elle pas au moins suivre la recommandation, chère à Benzekri, de transformer certains lieux de détention en musées, comme Derb Moulay Chrif ?
Cette question relève aussi de la mémoire, mais elle n’est pas encore réglée. Des centres de détention dont celui que vous avez cité sont remplis d’histoire, et il faut certainement les transformer en lieux de mémoire. Là non plus, ça ne relève pas de la fondation. Tout ce que peut faire cette dernière est de préparer des rencontres pour faire une évaluation. C’est ce que nous avons fait en partenariat avec le CNDH en 2013 quand on a organisé un colloque à Rabat sur la justice transitionnelle, nous voulions mettre en confrontation les expériences internationales et la nôtre dans ce domaine. Les rapports qui en résultent sont de nature à enrichir la littérature transitionnelle, du moins à mettre entre les mains des chercheurs une matière de travail.
Pour quand ce prix international décerné par la Fondation Benzekri ?
A partir de cette année. A sa dernière réunion en décembre dernier, le bureau de la fondation a décidé en effet que cette distinction internationale soit biennale, une façon d’honorer et de maintenir vivace la mémoire de Benzekri. Elle sera décernée à la personne ou à l’organisme qui brillera au plan international dans le ciel de la justice transitionnelle.
Côté financement, comment gérez-vous tout cela ?
Nous sommes une petite structure avec trois permanents, nous tournons à 300000 à 400 000 DH par an. Nous comptons surtout sur les dons d’anonymes et sur l’aide qui nous est octroyée par le CNDH.

