Culture
Première édition réussie pour le Festival du documentaire de Khouribga
Le premier prix est revenu à une réalisatrice libanaise.
Un jeune Marocain de 26 ans remporte le prix du jury.
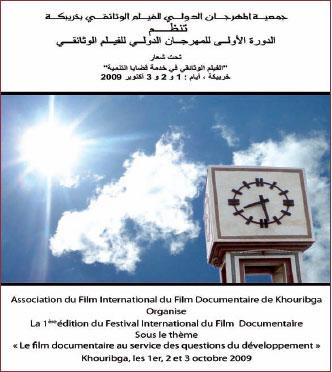
Le tout nouveau Festival international de Khouribga consacré au film documentaire (FIFDOK) s’est s’achevé le 3 octobre. Trois jours durant, le complexe culturel de la ville a accueilli des centaines de spectateurs pour visionner 11 œuvres de 12 réalisateurs représentant 10 pays (le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie, l’Egypte, le Liban, l’Arabie Saoudite, la Palestine, la Syrie, la France et la Belgique). Cette 1ère édition du FIFDOK a été organisée sous le thème du «film documentaire au service du développement», de ce fait une caravane cinématographique a été montée en faveur des villages de la commune de Ouled Issa bénéficiaires de l’aide de l’INDH ainsi que de deux établissements scolaires.
C’est la réalisatrice libanaise Dima Al Joundi qui a obtenu le Grand prix du Festival avec son film «Bonnes à vendre», de même que le Prix des critiques du festival. Elle y traite du thème des domestiques sri-lankaises qui vont de plus en plus travailler dans les familles libanaises nanties. Elles sont souvent l’objet de mauvais traitements allant de la confiscation de passeports et de la privation de liberté, aux sévices corporels, voire à la mort, essentiellement par suicide. Selon le documentaire, elles seraient aujourd’hui quelque 100 000 à avoir été au centre de tractations, et pas seulement financières, entre des agences d’embauche qui pullulent entre Beyrouth et Colombo.
Le Prix du jury, présidé par Mohamed Belhaj, Senior Producer à Al Jazeera documentaire, a été attribué au Marocain Yassine El Idrissi pour son premier documentaire «En attendant la neige» retraçant avec des images bucoliques et puissantes le quotidien du petit Ismaël dans son village perché sur les hauteurs d’Ifrane (voir entretien). Quant au Prix de la ville de Khouribga, il a été décerné à l’Egyptien Azeddine Saïd pour son film «Al lafif». Sur la base de plans courts, répétitifs, et d’effets spéciaux, le réalisateur tente de nous faire entrer en transe avec les derviches tourneurs de la Vallée du Nil, connus pour leurs danses circulaires chères à Jalaledine Roumi, l’initiateur du soufisme.
Le président du festival, Habib Nasseri, lui-même critique et chercheur, explique que le FIFDOK «a été porté par différentes personnes membres de son association dans le but de rompre avec cette habitude au Maroc d’organiser des grands festivals dans des grandes villes et pour encourager les échanges avec des pays étrangers dans le domaine du documentaire». «Nous avons commencé, rajoute-t-il, avec trois jours parce que nous avions des moyens limités, principalement la subvention de 150 000 DH de l’INDH, les 20 000 DH de la Ville de Khouribga, ainsi que le soutien technique et logistique du Centre cinématographique marocain (CCM)».
M. Nasseri précise qu’ils en sont au début et qu’ils ont la volonté de développer le festival en l’étendant à cinq jours et en programmant davantage de films de tous les continents, «d’Amérique latine et d’Asie notamment». A la question du déséquilibre entre les films en compétition, puisque toutes les oeuvres sont mises au même niveau, qu’elles soient le travail d’un débutant ou qu’elles soient le fait d’un documentariste chevronné, le président répond : «Pour la seconde édition, on va réfléchir concrètement aux critères de sélection des films, mais on va continuer à mêler pour la compétition les travaux d’amateurs et de professionnels. Parce qu’il n’y a pas que les professionnels qui ont des choses à dire, de même que des amateurs peuvent créer des films qui questionnent ceux dont c’est le métier».
Mohamed Belhaj, président du jury, abonde également dans ce sens : «Avant de visionner les documentaires durant le festival, nous n’avons reçu aucune information sur les candidats. Ce que nous sommes venus juger c’est un film, pas le parcours de son réalisateur. L’inverse aurait faussé le jeu». Et de conclure : «En tant que premier festival, il a certainement des lacunes, mais il reste un très bon festival grâce à l’énergie et au temps que les organisateurs y ont consacré et parce qu’il met en lumière un genre tout à fait marginalisé, spécialement au Maroc où il n’est pas considéré comme cinématographique, alors que le cinéma lui-même a débuté grâce aux documentaires des Frères Lumière, au XIXe siècle»
