Culture
Pour en finir avec les préjugés
L’unique nouvelle de Toni Morrison est à lire de toute urgence, autant pour elle-même que pour la postface signée de Zadie Smith.
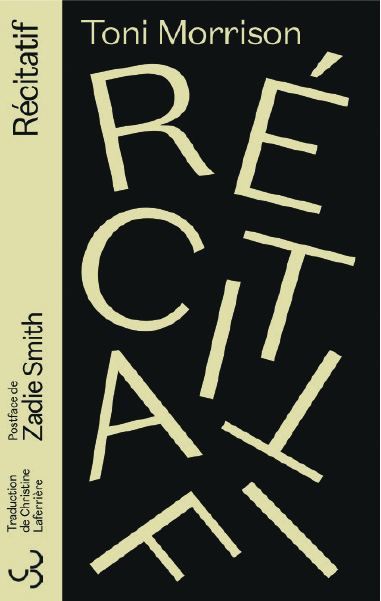
Au foyer de St-Bonaventure qui accueille des orphelines se rencontrent deux petites filles de huit ans, Roberta et Twyla. Elles ont leur mère, mais celles-ci ne peuvent pas s’en occuper. «Ma mère dansait toute la nuit et celle de Roberta était malade», raconte Twyla. Sur ces mots s’ouvre l’unique nouvelle écrite en 1988 par l’écrivaine américaine Toni Morrison, prix Nobel de littérature. Un bijou.
Roberta et Twyla deviennent inséparables, mais ce n’était pas une évidence. «À la minute où je suis entrée et où Bozo le Clown nous a présentées, j’ai eu la nausée. Être tirée du lit tôt le matin, c’était une chose, mais être coincée dans un lieu inconnu avec une fille d’une race tout à fait différente, c’en était une autre». Le nœud de l’intrigue est posé : l’une est noire, l’autre blanche. Mais le génie de Toni Morrison c’est de ne jamais révéler laquelle est de quelle couleur. Devenues adultes, les deux femmes se recroisent de loin en loin. Leur situation évolue au gré de leurs choix, dans des sens différents. Si elles se sentent «comme des sœurs séparées depuis bien trop longtemps», elles ont de moins en moins de choses à se dire. Un souvenir les obsède : celui de Maggie, la vieille employée de cuisine à la peau «couleur de sable». «Tu te souviens de Maggie ? Le jour où elle est tombée et où les cagoules [un groupe de filles plus âgées] se sont moquées d’elle ?», demande Twyla. «Roberta a levé les yeux de sa salade et m’a regardée fixement. «Maggie n’est pas tombée, a-t-elle dit. […] Elles l’ont renversée». Ce qui les éloigne semble moins être leurs situations sociales que le sens donné à cet événement : colère pour l’une, culpabilité pour l’autre. Le terme même de récitatif est emprunté à l’opéra – Toni Morrison a d’ailleurs écrit un livret – et désigne les passages déclamés entre les moments chantés, passages suivant le rythme de la phrase parlée et où le personnage se livre souvent à une introspection face à un doute ou un dilemme. C’est donc un temps d’épreuve.
Mais l’épreuve, note dans sa brillante postface l’écrivaine anglo-jamaïcaine Zadie Smith, est moins celle de ces deux femmes dont le lien repose sur le souvenir d’avoir été «deux petites filles qui savaient ce que personne d’autre au monde ne savait. Comment ne pas poser de questions. Comment croire ce qu’il fallait croire». Elle est adressée aux lecteurs.
Penser la race de façon relative
«Cette nouvelle extraordinaire que vous avez entre les mains a été spécifiquement conçue comme “l’expérience d’ôter tous les codes raciaux d’un récit concernant deux personnages de races différentes pour qui l’identité raciale est cruciale”», s’enthousiasme l’autrice de White Teeth (traduit en français sous le titre de Sourires de loup). Dans ce texte, Toni Morrison interroge la langue ordinaire et brouille à dessein ce qui est, dans le contexte américain, considéré comme propre aux Blancs et propre aux Noirs. Zadie Smith se prête au jeu de chercher à deviner qui est qui. Mais aucun détail ne permet de conclure avec certitude. La question de la race se double de considérations sur la classe sociale : «Quelle version de l’échec de l’instruction est la plus noire ? Quel genre de pauvres mangent si mal – ou s’estiment heureux de manger une mauvaise nourriture ? Les Noirs pauvres ou les Blancs pauvres ? Ou bien les deux ?» C’est aussi l’Histoire qui affleure, avec ses violences que certains préfèrent ne pas évoquer pour passer à autre chose et que d’autres estiment nécessaire de faire reconnaître. Au cœur de cette réflexion, c’est l’affirmation de l’individu et sa demande de reconnaissance. Pourtant, ce à quoi nous invite Toni Morrison ce n’est pas à la reconnaissance de différences créées par l’Histoire et qui seraient objectivées et soumises au jugement : c’est bien au contraire à la reconnaissance de la complexité, de l’imbrication des identités et des façons de les mettre en avant ou en sourdine selon nos expériences subjectives forcément complexes et relatives. La vraie libération, conclut Zadie Smith, c’est «la reconnaissance de quelqu’un chez tout le monde».

