Culture
Mohamed Afifi (1932-2014) : un écrivain rare
Enseignant-chercheur à Grenoble, Rédouane Taouil est un fervent passionné de la littérature de Mohamed Afifi, décédé le 9 février 2014 à 80 ans.
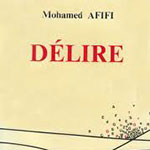
«L’originalité est la marque du génie», soutenait Marcel Proust dans ses méditations sur la quête de formes nouvelles d’écriture. Cette sentence s’applique, à coup sûr, à Mohamed Afifi, cet écrivain que la mort est venue arracher à sa vivante plume et sa luxuriante bibliothèque dans une indifférence coupable parce qu’ignorante. Passionné de la compagnie des livres et du frémissement des grands écrans, il laisse une œuvre singulière marquée du double sceau de l’élégance et de l’originalité, qui prend au sérieux l’humour et la dérision et s’inscrit en faux contre l’esprit de sérieux.
Ses nouvelles et contes réunis dans Délire, qui est une merveille de l’esprit, comme ceux de son manuscrit Murmures dans un miroir, mêlent, dans un style burlesque, fantastique et magique, pour pointer les fils invisibles de la servitude et de la domination, les caprices du pouvoir et l’impuissance face à la cruauté de l’absurde. La nouvelle intitulée La séparation, qui est emblématique à cet égard, est ensorcelante. Elle peint la métamorphose d’un fonctionnaire qui, pour vivre libre, décide de se séparer de lui-même et adresse une auto-déclaration de mort à son chef de service. Qu’elles portent sur la politique ou des faits de société, ses chroniques usent de riches références, de savoureuses citations et d’assertions inattendues.
«Lassé de tout, il a décidé de mettre fin à ses jours. Il ne sortait plus que la nuit», «Boire des tisanes n’est pas ma tasse de thé», «A la demande de l’auteur, les représentations de la “la cantatrice chauve” furent suspendues. L’interprète avait un cheveu sur la langue», «J’appellerai au secours en faveur de muets qui se noient», «Il eut le visage lacéré à coups de griffes et faillit perdre un œil. Il avait appelé un chat un chat», «Il était grand charmeur et au moindre signe les femmes lui tombent dans les bras. Pourtant, il les voyait le quitter irrémédiablement après les premiers baisers. Il avait une langue de vipère». Voilà un florilège qui, bien que peu illustratif, manifeste tout à fait la virtuosité de cet adepte de l’écriture fragmentaire.
Causeur érudit, sa conversation était un régal à l’image de ses écrits. Elle donnait à repérer les trésors de la littérature et du cinéma mondial qu’il connaissait sur le bout des doigts et des yeux. Guide de vagabondages malicieux, il pouvait promener son interlocuteur avec jubilation à travers les séquences de Los olividados de Luis Bunuel, les cauchemars de Au-dessous d’un volcan de Malcom de Lowry, les émotions de Quand passent les cigognes de Mikhaïl Kalatozov ou les allégories de La lucidité de José Saramago ou les histoires de vie de Manuscrit trouvé à Saragosse de Potocki ou encore les personnages de Mamma Roma de Pasolini.
Généreuse, son érudition le portait à user de citations diverses de Humphrey Bogart qui aimait à répéter que «chaque cigarette est un clou de son cercueil», de Jean Cocteau comme «Si je préfère les chats aux chiens, c’est parce qu’il n’y a pas de chat policier» ou de Henri Jeanson qui profère que «la vie est une course contre la mort… Le meilleur ne gagne pas» ou encore de Jean-Louis Borry, qui était membre de son jury de mémoire au célèbre Institut des Hautes Etudes cinématographiques, telle «l’humour est une source de désordre, et ce désordre est positif».
«Il naquit à Casablanca, à deux pas du square Zerktouni où il faillit se casser les jambes en apprenant à jouer au football, à deux brasses du port de pêche où il faillait se noyer en s’essayant à nager, à un jet de pierre de la rue de Mogador où il fit ses études primaires, à quelques arrêts du bus du Collège musulman et du lycée Lyautey où il interrompit son second cycle, à quelques heures d’aéroplane de Paris, où il tente d’étudier la cinéasterie. Alors se prenant au sérieux, il signera deux courts métrages et un documentaire de long métrage, Images d’Orient. Plus tard, se souvenant qu’il avait obtenu malgré tout le certificat d’études primaires, il écrivit.
Ainsi fut-il ». Cette nécrographie, empreinte d’autant de tendresse que d’autodérision, est signée de la main de l’auteur de Délire qui n’hésite pas à exercer sans tabou son ironie ravageuse, y compris à l’endroit de sa future disparition. Son œuvre polyphonique ne doit pas être conjuguée au passé simple. Telle la madeleine de l’auteur de A la recherche du temps perdu, les beaux ouvrages de Mohamed Afifi suscitent immanquablement le souvenir de la pléiade du Beau Maroc d’antan dont il faisait partie à l’instar de l’amoureux bilingue de la poésie, Mustapha El Kasri, et de l’infatigable arpenteur des méandres des rimes et des scènes, Said Saddiki. Par ces temps de kitch, l’héritage de cette pléiade est à mettre à l’abri de la menace d’amnésie. Aussi bien, convient-il de se délecter de la lecture de Délire et d’autres textes qui ne peuvent, grâce à la Toile, être prisonniers des araignées de l’oubli, pour découvrir une écriture inédite en littérature marocaine écrite dans la langue… de Proust.

