Culture
Le Maghreb sera à l’honneur au XIIe Salon du livre de Casa
Le XIIe Salon international de l’édition et du livre se tiendra à la foire de Casablanca du 10 au 19 février. 58 pays participants dont 15 pays arabes, 559 exposants. La profusion
des débats, rencontres, animés par 200 penseurs triés sur
le volet, compensera la modicité des moyens mobilisés, puisque
le coût de la manifestation ne dépassera pas 5 millions de dirhams.
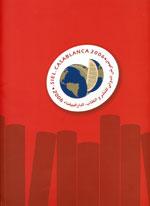
Aune semaine de la XIIe édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), les supputations vont bon train quant à la tournure qu’il va prendre cette fois. Car il est difficile de deviner la couleur et l’humeur de ce SIEL si inconstant. Impulsée par le ministère de la Culture, cette manifestation à caractère à la fois culturel et commercial «s’adresse aux entreprises nationales ou étrangères touchant aux secteurs d’activité suivants : édition, librairie, presse, distribution, imprimerie, messageries, bibliothèques, papeterie…», dans le généreux dessein de susciter la curiosité pour le livre et de stimuler le goût de la lecture. Tâche gratifiante dont le SIEL ne s’est pas toujours honorablement acquitté.
Après avoir viré à la braderie, le SIEL a remonté la pente
Après une entrée en fanfare et un parcours estimable mais évanescent, le SIEL commença à s’embrumer tant et si bien qu’il fut transformé en une affligeante braderie. On y proposait des ouvrages tombés en désuétude à des prix extrêmement modiques. On y exhibait des manuels défraîchis. Plus grave : on y répandait impunément une littérature sectaire, fanatique, haineuse, au mépris de l’exhortation clairement exprimée dans le règlement du SIEL «de ne pas exposer des documents pouvant porter atteinte aux bonnes mœurs, à la moralité publique, aux institutions nationales et aux convictions religieuses».
Pendant que les stands bradeurs croulaient sous le nombre de visiteurs alléchés, ceux qui faisaient honneur au salon étaient snobés. Beaucoup d’exposants fermaient boutique et s’en allaient ruminer leur désappointement. Le SIEL était mis en capilotade, on ne donnait pas cher de sa survie. Il survécut. Pour cela, il a fallu que le ministre de la Culture, Mohamed Achaâri, imposât aux éditeurs «de présenter des nouveautés et de limiter les quantités à exposer, parce que le salon doit être un vecteur de développement de la profession et non pas un moyen de sa destruction», quitte à se mettre sur le dos d’inquiétants bradeurs qui n’hésitèrent pas à le taxer de «censeur du Coran».
700 000 visiteurs en 2005, on en attend un million cette année
Depuis la VIIIe édition, le SIEL a pris des couleurs plus seyantes, sans toutefois s’être totalement débarrasé de ses scories. Les bradeurs continuent insidieusement d’y sévir, les indésirables en souillent encore les meilleures intentions et les fanatiques y font toujours des messes basses. Mais de manière feutrée. Malgré ces désagréments, le SIEL est redevenu une grande fête, abondante aussi bien en nouritures spirituelles que terrestres. On y vient en bande ou en famille pour le seul plaisir de se fondre dans la foule ou dans l’espoir de rencontrer son auteur favori. On y fait ses provisions en livres sans trop fatiguer sa bourse. On y taille une bavette en sirotant un jus ou en mangeant un morceau dans l’une des baraques qui y fleurissent pour la circonstance.
Ils étaient 507 301 à monter au SIEL pour la Xe édition, 700 000 en 2005, et les organisateurs tablent, sans excès d’optimisme, sur le million de visiteurs cette année. Sur une surface d’exposition de 19 000 m2, les maisons d’édition ont déjà retenu la moitié. Cinquante-huit pays, dont 15 pays arabes (Maroc, Tunisie, Mauritanie, Algérie, Libye, Egypte, Jordanie, Liban, Soudan, Syrie, Emirats Arabes Unis, Koweït, Arabie Saoudite, Sultanat d’Oman, Palestine), sont attendus. La foire de Casablanca propose aux 559 exposants des stands de 9 à 99 m2, clés en main, à condition d’en payer le prix, qui est astronomique. Les plus nantis ne regardent pas à la dépense pour être à leur avantage au XIIe SIEL, les mal pourvus chercheront refuge chez Sochepress ou Sapress, ou chez l’une des prodigues maisons d’édition étrangères.
Avec trois cents parutions par an, l’édition au Maroc fait pauvre figure
Bien entendu, les éditions marocaines seront présentes en force. Ce sera l’occasion d’en tâter le pouls.
Eddif, après avoir traversé la tourmente, a-t-elle repris du poil de la bête ? Yomad, une maison d’édition qui se consacre à l’enfance, tient-elle la route, malgré la modestie de ses moyens ? Wallada a-t-elle repris des couleurs après une période exsangue? Toutes vont avoir le scrupule de présenter essentiellement des nouveautés. Le Fennec n’en est pas chiche avec 8 titres, dont se dégagent Les islamistes marocains, de Malika Zeghlal, Années de plomb, chronique d’une famille marocaine, de Sietsk de Boer, Le griot de Marrakech (Mahi Binebine), ou encore Metro mohal (Youssef Fadel). Les éditions Tarik, dont l’audace n’est pas la moindre vertu, feront assaut de séduction avec neuf publications dues à Zakya Daoud, Souad Guenoun, Dominique Caubet, Abdelkader Benali, Saïd El Hajji, Henri Michel Boccara, Habib Mazini, Salah El Aïda Hachad, Abdelfafattah Fakihani. Autant dire que leur stand vaut le détour. On n’oubliera pas de s’y procurer le dernier Elias Sanbar, Figures du Palestinien, dont on vante la justesse. En tirant sur le filon peu juteux du théâtre, Edisoft suscite la curiosité. Là encore, une escale s’impose et un ouvrage retient l’attention : L’image du juif dans le théâtre marocain, de Mohamed Al Wadi. S’arrêter chez Marsam procure habituellement des agréments. Ceux-ci seront, cette année, inhabituellement, en portion congrue. A peine trois titres, dont l’un est fort brillant. Il s’agit de Dans le jardin de Hawwa, de Zakia Zouanat. Les grosses écuries (Eddif, Okad, Dar Toubkal, Dar Attakafa, Najah Al Jadida…) seront forcément de la partie. Pour l’heure, elles n’ont pas encore annoncé la couleur. Gageons qu’elle sera radieuse.
L’édition au Maroc ne parvient toujours pas à atteindre les sommets auxquels elle aspire, malgré la contribution du ministère de la Culture, sous forme d’aide à l’impression, à hauteur de 50 % du coût, en faveur d’une quarantaine de titres, et les 1,5 MDH consentis par le Bureau du livre de l’ambassade de France. Tout juste 300 parutions par an, pas de tirage excédant 1 500 exemplaires, sauf, exception, et des méventes à la pelle. Ce qui est indigent, en comparaison, par exemple, avec un petit pays comme le Portugal, où 6 000 titres sont annuellement publiés. Le ministère de la Culture rapporte le malaise à l’analphabétisme (60 %) et à l’illettrisme croissant. La corporation, elle, charge les pouvoirs publics, «coupables» de négligence envers le secteur éditorial. Dans une simple province telle que le Québec, les éditeurs reçoivent une subvention de 14 millions de dollars, fait-elle remarquer. C’est sans doute ce son de cloche qui retentira lors de la rituelle journée professionnelle (lundi 13 février). Mais il n’y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.
Comme d’habitude, il y aura une profusion de débats, de rencontres, d’animations et de lectures. Pas moins de deux cents penseurs, triés sur le volet, tenteront d’éclairer nos lanternes. Tête d’affiche, une fois n’est pas coutume : le Maghreb. Au XIIe SIEL, la littérature maghrébine, dans son immense richesse et ses fatales imperfections, sous toutes ses coutures et facettes, sera mise en exergue. La jeunesse n’est pas oubliée, puisqu’un espace d’animation de 270m2 lui sera dédié. Les bibliophiles, quant à eux, pourront assouvir à loisir leur vertueux vice : une bibliothèque, comportant 1 000 ouvrages consacrés au Maghreb, sera mise à leur disposition. Ce sera vraiment une fête du livre. Elle coûtera 5 millions de dirhams. La moitié du budget d’un vulgaire festival.

