Culture
Essaouira, capitale de l’Andalousie perdue
Du 29 octobre au 1er novembre se tiendra la VIe édition du Festival des Andalousies Atlantiques.
Dix concerts, trois lieux et une nouvelle direction artistique.
Au menu : ala, gharnati, mutrouz, flamenco,…
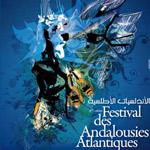
Le Festival des Andalousies Atlantiques se présente comme un voyage dans le temps. Un temps perdu, jamais retrouvé, dont les Arabes durent en faire leur deuil tout en restant inconsolables tant, dans l’Andalousie conquise, ils avaient eu à cœur de manifester leur part de lumière, bâtissant ingénieusement, inventant à foison, traduisant à tour de bras, philosophant sans dogmatisme, jetant les bases d’édifices scientifiques, créant des musiques novatrices et vivant en parfaite harmonie, souvent complice, avec leurs prochains juifs. C’est en l’an 2000 qu’émergea l’idée de mettre au jour cette manifestation. En la circonstance de la rencontre qu’elle a concoctée autour de l’héritage andalou, l’universitaire Oumama Aouad convia quelques personnages de marque, dont André Azoulay, qui la persuada de convertir le séminaire en festival. Deux ans plus tard, le dessein prit corps, au cœur d’une cité peu «andalouse» aux yeux de beaucoup : Essaouira.
«Ce n’est pas l’épopée andalouse qui m’intéresse au premier chef, ce sont ses prolongements. De ce point de vue, Essaouira me semble la plus qualifiée, en cela qu’elle se révèle la plus proche historiquement de la réalité que nous avons héritée d’Al-Andalus. Toute une génération souirie évoque encore ce temps où musulmans, juifs et chrétiens vivaient dans une belle harmonie. Et il est révélateur quant à l’esprit de cette ville que des gens de divers horizons culturels, de plusieurs appartenances ethniques et spirituelles continuent à y affluer», plaidait Oumama Aouad.
La mémoire du paradis andalou ravivée
Malgré son ardeur, Oumama Aouad ne fit que deux tours à la tête du Festival des Andalousies Atlantiques, puis s’en alla ; le chercheur Mohamed Ennaji, qui lui succéda, non sans enthousiasme, prit, à son tour, du champ au bout de trois saisons, les commandes sont maintenant confiées à l’exquise chanteuse Françoise Atlan, qui aura à prouver que son plumage vaut son ramage. Au fond, peu importe que des timoniers soient passés par-dessus bord, pour des raisons plus ou moins avouables, tant le navire, contre vents et marées pécuniaires (son budget n’excède pas les deux millions de dirhams), maintient son cap, sans déroger à ses principes, ni changer sa ligne de conduite.
La musique judéo-marocaine à l’honneur dans cette VIe édition
L’an 1492 scelle la fin de la présence arabe en Andalousie. Nombreux pourchassés trouvent refuge à Tétouan, Fès, Rabat et Salé, où ils débarquent avec larmes et chiches bagages, dont un inestimable, le tarab al-ala, éclos au paradis andalou, par les soins du fameux Zyriab (né à Bagdad en 789, mort à Cordoue en 857), qui en fixa les normes que Ibn Baja (né à Saragosse en 1070 et mort à Fès en 1 138) se fit un devoir d’affiner et d’enrichir. Grâce à ces exilés, ce genre musical se propage à travers le Maroc, s’épanouit et rayonne, au point d’être considéré comme une spécificité marocaine, qui fera école, puisque l’algérienne Tlemcen, des siècles plus tard, en façonne une variante, appelée tarab al-gharnati. Lequel, dans les années vingt du siècle dernier, se met à séduire les villes d’Oujda, Rabat et Salé. Tarab al-ala et tarab al-gharnati étant les legs les plus vivaces de l’Andalousie défunte, il n’est guère étonnant qu’ils soient avantagés par la VIe édition du Festival des Andalousies Atlantiques. Cinq concerts leur sont accordés, auxquels prennent part alternativement les orchestres Zyriab (Oujda) et Tarab (Tlemcen).
Véritables passeurs, les chanteurs et musiciens juifs marocains y étaient pour beaucoup dans l’introduction et le rayonnement de la ala et du gharnati. Mais leur apport au patrimoine musical marocain ne s’arrêtait pas là. Ils s’étaient aussi illustrés dans le hawzi, chaâbi, flamenco ou jazz et les métissages heureux. Que reste-t-il de Chikh Zouzou (Ben Soussan), Lili Lâabassi (Ajini, ajini), Zahra Lfassia (Laâroussa), Salim Lahlali (Mahhani zine), Albert Souissa (Ya rabbi lahnine), Félix Lmaghribi (Lâathar ya lâatar), Sami Lmaghribi (Qaftanek mahloul)… ? Rien ou presque, à peine un vague souvenir chez ceux qui n’ont plus vingt ans depuis longtemps. Inadmissible ! Aussi, le festival entend-il réparer cet outrage, du moins symboliquement, d’abord en perpétuant le souvenir de Zahra Lfassia, par la voix de la sublime Hayat Boukhriss, puis en invitant à sa table Haïm Louk, rabin de la communauté juive marocaine et maître du chant liturgique ; Raymonde El Bidaouia, dont l’art consommé du chaâbi et du malhoun fait sensation, et Maurice El Mediouni, l’inventeur du piano oriental.
Concerts de musique andalouse et plages dédiées au chant judéo-marocain forment les moments les plus goûteux de cette édition qui, du reste, accorde une grande attention au flamenco, avec Ana China, et à la danse sacrée indienne, emmenée par Ravi Shankar Mishra.
Un pèlerinage à Essaouira s’impose pour qui veut avoir son content d’effluves d’un passé lointain et proche.

