Idées
Whatsapp ou le conflit entre la technologie et la loi
Avec la bénédiction du régulateur national, les entreprises de télécoms marocaines essaient de protéger leur chasse gardée et de s’offrir une position de rente par entente sur la téléphonie mobile. Leur position risque de nuire aux intérêts des usagers et à l’image d’un Maroc performant dans les télécommunications et ouvert à la pénétration des technologies de l’information.
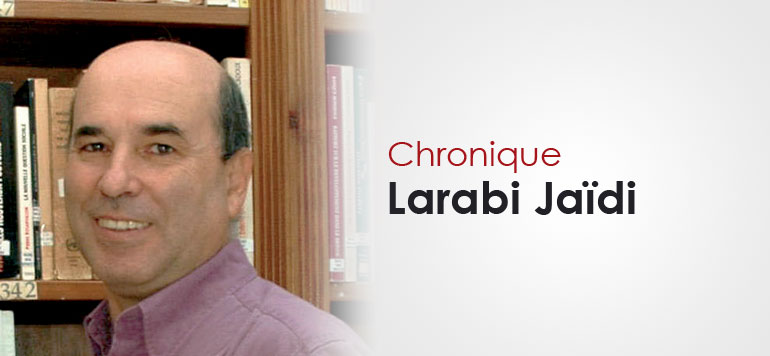
L’enjeu est grand dans cette confrontation. Il pose deux problèmes autrement plus importants que la défense des intérêts des usagers ou des opérateurs : celui du conflit entre la technologie et la loi et le mode de résolution institutionnel de ce conflit. L’avènement de l’Internet a brisé les monopoles étatiques des télécommunications et a rendu obsolètes des modèles économiques anciens. La vitesse à laquelle les technologies de la communication progresse complique les relations entre les acteurs de ce marché : les opérateurs des télécommunications, les consommateurs de ces services et les régulateurs. Le problème est que les technologies et la loi sont souvent en tension, sinon en conflit. La réglementation peine à suivre les mutations technologiques ; elle réagit souvent tardivement quand les pratiques sont déjà enracinées dans la société. L’usage gratuit de services de téléphonie mobile a suscité de très nombreuses réactions. Le point central du débat était de déterminer si un fournisseur de ces services devait être soumis à l’ensemble des obligations pesant sur un fournisseur de services équivalents.
La plupart des régulateurs ont adopté une approche pragmatique de cette question. Nombreuses sont aujourd’hui les applications qui permettent de communiquer par Internet sans être adossées à un statut d’opérateur. Quelques pays avancés ont, à un certain moment, voulu faire entrer ces applications dans les rangs. Des blocages visaient à protéger les opérateurs ne souhaitant pas voir leurs clients migrer vers des applications tierces proposant d’effectuer gratuitement des appels au détriment des forfaits téléphoniques standard. Mais, dans pratiquement tous ces pays avancés, les autorités de régulation ont tranché en faveur de la levée des restrictions sur ces applications. Ces autorités estiment que les blocages mis en place par les opérateurs mobiles afin de conserver leur bande passante sont un frein à l’innovation.
Aujourd’hui, des pays en développement mènent une bataille d’arrière-garde sur cette question. Mais pas tous. Des pays comme l’Egypte, l’Ethiopie, la Gambie, le Centrafrique bloquent, régulièrement ou temporairement, ce type d’applications. Les compagnies de quelques pays du Golfe font pression sur les régulateurs de leur pays pour bloquer ces services, estimant qu’ils leur livrent une concurrence jugée déloyale en arguant de surveiller leurs contenus. Par contre, au Sénégal, à la suite d’une plainte des consommateurs, l’Autorité de régulation a sommé l’opérateur historique et filiale du groupe télécoms français Orange de remédier au blocage de l’accès au service de Voix sur IP Viber. Au Gabon, l’Autorité de régulation a répondu à la demande du président gabonais en personne pour que les appels sur VoIP ne soient bloqués en aucune manière.
En Afrique du Sud, si des opérateurs ont rejeté les applications de VoIP qu’ils accusent de concurrence déloyale, d’autres opérateurs se sont opposés à la régulation de ces applications parce qu’ils croient fermement que cela causerait du tort à l’industrie des télécoms et aux consommateurs. Dans d’autres pays, les parlements se sont impliqués dans ce débat. Ils ont réagi aux plaintes des opérateurs en décidant d’auditionner les arguments des différents acteurs des télécoms, d’écouter leurs arguments avant de proposer des changements de réglementation pour gérer ces applications et l’impact de ces outils de communication sur la concurrence.
Au Brésil, WhatsApp a été suspendu une courte période. Les entreprises de télécoms locales avaient fait pression pour convaincre leur gouvernement que l’application est illégale et non réglementée. Un juge a ordonné le blocage du service de messagerie parce que ce dernier aurait refusé de communiquer des informations dans le cadre d’une enquête policière. La réaction des consommateurs a été vive. Un autre juge a annulé cette décision. Un des quatre grands opérateurs a fait appel de la sentence, considérant que le blocage porte préjudice à ses clients. L’Agence nationale de régulation a fini par dénoncer la suspension, arguant qu’elle porte préjudice aux utilisateurs en faisant prévaloir des principes constitutionnels.
Dans les pays où le droit des consommateurs est effectivement reconnu, la résolution des conflits entre usagers et opérateurs se fait par le dialogue. Ainsi, des agences de régulation mettent en place des comités de consommateurs. Ces comités n’ont pas vocation à se substituer à d’autres entités (Conseil national de la consommation, instances juridictionnelles), ni à régler des litiges. Ils n’interviennent pas sur la préparation de projets législatifs ou réglementaires. Ces structures sont un lieu d’échanges et d’information avec les représentants des consommateurs. Elles identifient les problèmes dont la résolution est facilitée par la concertation. Il est navrant de constater que, dans notre pays, des décisions portant atteinte aux intérêts des usagers soient prises sans que des instances de dialogue ou de concertation ne soient sollicitées pour des avis d’intérêt public. Sur ces questions, l’agence de régulation ne doit pas disposer du monopole de la décision, l’avis du Conseil de la concurrence doit être sollicité.
