Idées
Vue et revue d’«Europe»
«Littérature du Maroc», tel est le thème de la dernière livraison de la revue littéraire française Europe pour l’année qui vient de s’écouler. Le dernier numéro en date de cette même revue qui fut consacré au Maroc remonte à 1979, soit il y a plus de trente ans. C’est en quelque sorte la littérature marocaine vue et revue d’Europe.
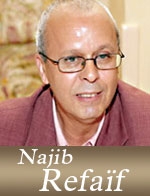
Qu’est-ce qui a donc tant changé, depuis, dans le monde de la littérature marocaine ? Ce n’est pas tant à cette question que cette livraison tente de répondre, mais l’état des lieux, certes non exhaustif, fournit quelques réponses en creux. Il va de soi que l’on ne peut pas ne pas relever, en trente ans d’écart, l’émergence de nouveaux auteurs toutes langues confondues et dont les œuvres marquent de leur empreinte la littérature marocaine, autant qu’ils sont marqués à leur tour par l’air du temps qui passe au Maroc et ailleurs. Ailleurs, parce qu’il y a trente ans, en effet, les auteurs marocains nés ou résidant à l’étranger n’apparaissaient dans aucun état des lieux, pour la bonne raison que nulle trace n’en attestait l’existence. C’est en ce sens que l’on peut parler d’émergence de nouvelles voix d’une diaspora littéraire dispersée à travers une partie de l’Europe, tant en Belgique et aux Pays-Bas qu’en France ou en Espagne, pays d’accueil des premières vagues de l’émigration marocaine. A ce propos, l’année 2014 sera célébrée partout en Belgique sous le thème : «Mémoire de l’immigration marocaine» et afin de marquer le cinquantenaire de l’arrivée de la première vague d’ouvriers marocains en terre belge. Là aussi, nul doute que l’on retrouvera quelques auteurs et artistes belgo-marocains, d’expression francophone ou flamande, qui sont les descendants de ces ouvriers qui ont fait ce long voyage vers le Nord. Leurs œuvres sont nourries de cette mémoire silencieuse mais partagée et de cette double appartenance vertigineuse.
Mais revenons au dernier numéro de la revue Europe qui relève que le grand changement dans la littérature marocaine c’est d’abord la disparition de grands auteurs tels Mohammed Khair-Eddine, Mohamed Choukri, Driss Chraïbi, Amrane El Maleh, Abdelkébir Khatibi, Ahmed Bouanani ou Mohamed Leftah. Ces écrivains disparus laissent un vide considérable dans le Royaume des lettres. Par ailleurs, leurs œuvres ont marqué, chacun à leur façon, la création littéraire marocaine tant par le souffle que par le style ou la langue. Ont-ils eu réellement une influence sur la nouvelle génération d’écrivains comme le souligne la présentation de la revue ? Trop tôt pour l’affirmer mais on peut en discuter tant la nouveauté vient bien plus des thématiques abordées, plus libérées de l’autocensure ou de la «pudeur» qui marquaient parfois les œuvres de certains de ces auteurs disparus. Mais si l’on ne peut encore parler de relève, ni même de rupture avec les littératures d’il y a trente ans (puisqu’on en est à comparer les deux numéros 1979 et fin 2013), force est de constater que les deux nouveautés essentielles sont l’arrivée des femmes, en grand nombre, dans cette «nouvelle littérature» marocaine, et ce, dans les deux langues, l’arabe et le français; mais aussi une écriture en langue amazighe qui s’inscrit avec plus ou moins de réussite dans le paysage littéraire marocain. Autre constat, les romanciers et poètes francophones et arabophones de renom qui ont marqué les quarante dernières années sont toujours là, tels qu’en eux-mêmes, la mémoire littéraire marocaine les préserve: Tahar Ben Jelloun, Mohamed Bennis, Abdellatif Laâbi, Mohamed Berrada, Driss Khouri, Mohamed Achaâri, Abdelhak Serhane, auxquels s’ajoute, le vent en poupe, un Fouad Laroui plein de fougue et de talent.
Et pour conclure, reprenons ce par quoi les auteurs de cet excellent numéro sur le Maroc ont commencé: la poésie telle que la vit, en vit et la conçoit le poète marocain Mohamed Bennis. En effet, dès l’ouverture du dossier le poète donne le ton dans un long et intéressant entretien avec Jacques Ancet intitulé «Dans les plis infinis de la parole». Répondant à une question sur l’état de la langue arabe qui préoccupe le poète, Bennis réplique : «L’arabe est la langue de mon corps. Je ne l’aborde pas en tant que langue d’expression ni en tant qu’instrument idéologique, quel qu’il soit». Au cours de cet entretien de grande facture, rare en langue française de la part de Mohamed Bennis, le poète revient sur sa propre généalogie poétique qui va du souffle tellurique de la poésie antéislamique aux lumières extatiques du poème mystique, en passant par l’apport de la poésie française et de ses maîtres Baudelaire et Mallarmé. La modernité française (sa poésie en l’occurrence) m’a aidé à prendre conscience des risques qu’affronte un Oriental. Les poètes français modernes (dont le père symbolique est Baudelaire) sont des bilingues. Par ce «bilinguisme» ils ont introduit la part de la langue de l’autre dans le cartésianisme de leur propre langue.

