Idées
Violences urbaines
Dans les villes, la solidarité qui pouvait exister dans les campagnes se délite et il suffit que les occasions d’emploi se fassent rares, que se multiplient les activités informelles de stricte survie, pour que la violence ait plus de possibilités de se développer, probablement davantage pour les urbains de seconde génération que pour ceux qui viennent de migrer de la campagne.
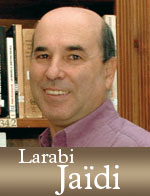
L’insécurité et les violences perpétrées par des bandes organisées se développent dans la plupart des villes (Casablanca, Rabat, Tanger, Fès, Marrakech…). Ce phénomène, jusqu’à récemment limité aux principales métropoles régionales, tend à prendre de l’ampleur, à se diffuser dans les villes moyennes, sinon même les petites villes… Est-ce en raison de la pauvreté, des inégalités de revenus importantes ou de leurs évolutions respectives que la violence atteint de tels sommets ? Est-ce en raison d’une insuffisance des effectifs de la police et d’une justice trop inefficiente que la violence se déchaîne ? Est-ce à cause des fortes empreintes laissées par les années de plomb dans les comportements tant des forces de l’ordre que des citoyens que la violence se maintient à un niveau très élevé ? Est-ce en raison de toutes ces causes ?
En premier lieu, un nombre important de ces violences sont l’expression de problèmes sociaux et des fractures sociales qui la caractérisent. L’accroissement des inégalités tend à accentuer la violence probablement parce qu’elle est ressentie comme particulièrement injuste dans des territoires où les inégalités sont déjà très élevées. L’action de l’Etat contre les inégalités n’est pas ressentie comme de nature à modifier cette évolution, la tentation de «taxer» directement ceux qui apparaissent comme nantis devient alors forte. L’exclusion sociale, la pauvreté, la discrimination et le travail informel constituent un terreau fertile pour les activités illicites.
En second lieu, l’urbanisation mal maîtrisée apparaît comme une cause de violence importante, non seulement parce qu’elle génère une concentration socio-spatiale de la pauvreté et de l’informalité mais aussi parce que, dans les villes, la solidarité qui pouvait exister dans les campagnes se délite et il suffit que les occasions d’emploi se fassent rares, que se multiplient les activités informelles de stricte survie, pour que la violence ait plus de possibilités de se développer, probablement davantage pour les urbains de seconde génération que pour ceux qui viennent de migrer de la campagne.
En troisième lieu, il existe une relation entre le développement de la violence urbaine et la faiblesse des institutions sur le plan local qui se traduit par une absence prolongée des autorités et des représentants légitimes de la loi dans nombre de quartiers. Pour beaucoup de citoyens, la police ne peut non seulement résoudre le problème de la violence urbaine, mais elle fait partie du problème, parce qu’elle est souvent abusive, incompétente, corrompue. Cette perception si négative des forces de l’ordre public s’explique par la difficulté de l’adaptation des forces policières aux fonctions de sauvegarde de la sécurité publique dans le respect des droits humains. A ces problèmes s’ajoutent la faiblesse et l’inefficacité du pouvoir judiciaire. Nombre de délits violents ne sont pas dénoncés, ni traduits en justice. L’impunité agit comme un puissant levier pour les activités illégales qui produisent souvent de grands bénéfices avec très peu de risque pour ceux qui les réalisent.
Face au vide de l’Etat de nouvelles formes de violence sont apparues provoquées par des bandes de jeunes qui cherchent dans la criminalité et dans le trafic des drogues une nouvelle forme de vie. Les membres des bandes se recrutent chez les jeunes issus de milieux pauvres et rejetés du système scolaire, mais aussi parmi des adolescents qui poursuivent encore leurs études. Les membres de ces bandes développent des «microcultures», basées sur la reconnaissance (d’où l’importance des signes, des codes), dans les territoires contrôlés par la violence, ont des activités illégales pouvant être extrêmement fructueuses.
Réduire la violence lorsqu’elle atteint le niveau qu’elle connaît actuellement est un peu comme tenter de «faire la quadrature du cercle». C’est dire la difficulté. On peut considérer qu’il y a un ensemble de pré-requis visant à rendre la société davantage cohésive et à réduire la violence: diminuer de manière substantielle les inégalités socio-économiques, favoriser une redistribution plus égalitaire, développer une éducation primaire et professionnelle de qualité, améliorer la qualité des institutions, notamment et surtout la justice et la police, inventer des politiques de la ville. D’aucuns diront que ces politiques sont de long terme et n’ont pas d’effets immédiats sur la violence urbaine et que les réponses strictement répressives peuvent apparaître comme les plus efficaces. On doit cependant souligner que l’efficacité du système répressif ne peut être confondue avec une répression plus importante.
La complexité du phénomène de la violence montre qu’il n’existe pas de réponses faciles. Des politiques de sécurité publique plus globales pour combattre l’exclusion paraissent nécessaires, appliquant des mesures préventives et d’insertion sociale. L’objectif est de renforcer les politiques publiques locales, d’inventer une nouvelle politique de la ville et de maintenir un certain équilibre entre les tâches répressives et préventives de la police, et, surtout, gagner et maintenir la confiance dans le tissu associatif local. En définitive, il s’agit de promouvoir la «bonne gouvernance» en matière de sécurité citadine.
