Idées
Une histoire coloniale
Certains écrits et témoignages ont de quoi blesser le sentiment national par la teneur de certains propos et descriptifs, et le caractère ouvertement raciste ou européocentriste pour les plus tempérés.
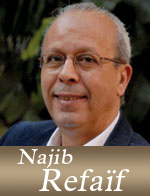
Comment bien lire le présent pour mieux le vivre et conjuguer au futur pour s’y projeter sans connaître le passé afin de ne rien oublier ? Curieusement, c’est en ses temps d’oubli que l’on fait le plus appel à la mémoire dont on a même fait un devoir : le devoir de mémoire. L’expression sonne comme une sentence à rime riche et hautement lyrique. Mais plus prosaïque, l’historien œuvre dans le passé comme on recompose les débris d’un objet antique en terre cuite. Ses outils sont limités et mités par le temps qui passe : documents écrits vermoulus, portulans illisibles et désorientant, mythes et légendes colportés par un imaginaire collectif enfiévré. Une fois tout cela réuni, l’intuition sert de liant et l’histoire se met à parler par la bouche de l’historien. Peu tendre avec cette discipline, Paul Valéry se gaussait en comparant l’historien et la liseuse de bonnes aventures: «L’Historien fait pour le passé ce que la tireuse de cartes fait pour le futur. Mais la sorcière s’expose à une vérification et non l’historien». C’est là bien entendu une vue très caricaturale du travail sur l’histoire à l’ancienne lorsqu’il fait parler un passé enterré comme s’il s’agissait d’un être vivant. Vaste débat que l’on laissera aux spécialistes intéressés.
Au Maroc, on en aura bien besoin cette année, laquelle, comme on le sait, marquera dès la fin du mois de décembre l’anniversaire du centenaire du Protectorat. Et là, on n’est pas dans l’histoire de l’antiquité et ses objets perdus, mais bien dans le début du XXe siècle. En effet, le traité de Fès qui a instauré le régime du Protectorat au Maroc a été signé le 30 mars 1912. Archives, images et illustrations sont disponibles et consultables librement en France comme au Maroc. Jamais matière historique n’a été aussi abondante tant dans l’édition que dans la presse de l’époque, dans les institutions et les archives publiques et privées. Toute une littérature dite coloniale, des écrits en sciences sociales et des études dans tous les domaines de l’art, du patrimoine et de l’architecture. Sans compter les monuments et les bâtiments d’époque dans plusieurs villes du Maroc. Ce trop plein de matière historique a été peu exploité sinon pour être dénigré par nombre de chercheurs dans les années d’après-l’Indépendance. Cela explique, peut-être, le peu d’intérêt accordé à cette période historique du pays. En effet, le tropisme anticolonial des intellectuels nationalistes ou panarabistes, doublé d’un engagement idéologique marqué par l’anti-impérialisme aigu de la gauche marocaine, ont mis une chape de plomb sur ce «patrimoine colonial» que personne ne revendiquait comme une composante de l’histoire contemporaine marocaine. Seuls quelques collectionneurs bibliophiles et souvent francophiles se mettaient à chiner à la recherche d’ouvrages coloniaux dans divers domaines des arts, des témoignages et autres écrits et mémoires relatant cette époque. Il faut dire que cette littérature comporte un peu de tout. Certains écrits et témoignages, en effet, ont de quoi blesser le sentiment national par la teneur de certains propos et descriptifs, et le caractère ouvertement raciste ou européocentriste pour les plus tempérés. Mais au milieu de tout cela, on peut trouver un gisement de connaissance et des analyses pertinentes sur des aspects de la vie et de la société marocaine. En matière de sciences sociales, si l’on peut contester certains aspects, analyses et postures de tel ou tel chercheur, souvent à la solde de l’administration du Protectorat, on peut aussi assouvir ses connaissances dans la lecture d’autres études, comme celles de Jacques Berque par exemple. Il y a aussi en matières d’art et de patrimoine des ouvrages d’une grande valeur tels ceux de Besançenot sur les costumes, Félix Chottard sur la musique andalouse ou Pierre Laouste, auteur du célèbre Mots et choses berbères et bien d’autres auteurs de même acabit. Mais, ce n’est pas seulement la matière scientifique, intellectuelle, artistique et patrimoniale dont il s’agit de discuter et de débattre avec un recul apaisé et l’objectivité sereine qui sied à un tel débat. C’est en revenant à la genèse et au détournement de ce Protectorat que l’éminent historien Charles-André Julien qualifie de fiction (voir son ouvrage Le Maroc face aux impérialismes, Editions J.A), qu’on peut interroger et relire ce passé composé de tant d’illusions, d’incertitudes et d’espoir. Au centre de ce Protectorat, côté français, rayonnait un homme porteur du grand mythe colonial. Son parcours a marqué les esprits par sa stature complexe faite de grandeur, d’élitisme contradictoire, d’altérité et de passion pour le Maroc mais aussi d’une idéologie d’ordre et de conservatisme revendiqué. En 1922, il fit cet aveu édifiant dans une lettre à un de ses amis installé en Algérie : «J’affirme avec une conviction croissante que notre force et notre avenir au Maroc y reposent sur une politique conservatrice, traditionnelle, hiérarchique, et non sur une évolution démocratique et moderniste, bien au contraire».
(Voir Lyautey, Juin, Mohammed V : Fin d’un Protectorat. Editions Eddif).

