Idées
Sociétés démocratiquement modifiées
Pourquoi Baudelaire avait-il un jour ajouté ces deux articles aux dix-sept autres que la Déclaration des droits de l’homme de 1789 comptait déjà : le droit de se contredire et celui de s’en aller ?
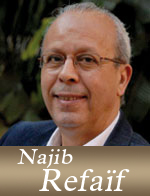
Pourquoi Baudelaire avait-il un jour ajouté ces deux articles aux dix-sept autres que la Déclaration des droits de l’homme de 1789 comptait déjà : le droit de se contredire et celui de s’en aller ? D’abord c’est en préfaçant les Histoires extraordinaires d’Edgar Poe que l’auteur des Fleurs du Mal a fait cette proposition. Mais c’est également dans un contexte bien précis, celui du décès de Poe et Nerval. Il s’agissait donc de la disparition regrettée de deux auteurs chéris par le poète. Mais comme on a très souvent tendance à prêter aux poètes, à raison du reste, des aphorismes à multiples interprétations là où ils n’ont proféré que des paroles de circonstances, le rajout des deux articles proposé par Baudelaire prendrait aujourd’hui une dimension politique universellement vérifiable.
Prenons un exemple proche de nous et dont l’actualité dramatique a fait et continue de faire la une des médias, après l’assassinat de l’opposant tunisien Choukri Belaïd le 6 février dernier. Dans un article publié par le journal électronique Le Huffington Post, sous la plume de Benoît Margo, on peut lire ce constat : «Les espoirs soulevés par le premier renversement d’un dictateur arabe sous la pression populaire étaient immense. La Tunisie a paru être le pays de la région le mieux préparé à la démocratie : relativement petit, avec une population plutôt homogène et éduquée, et un tropisme européen important. On a même parlé d’un “laboratoire” de la démocratie arabe». La suite de l’article est une tentative d’explication de l’échec de cette première transition et des erreurs commises par le parti majoritaire tunisien Ennahda dans la conduite de cette expérience. Tous les experts et observateurs politiques partagent aujourd’hui cette analyse pendant que les populations concernées de «la région» (comme on dit lorsqu’on ne veut pas dire «le monde arabe»), enfermées dans ce «laboratoire de la démocratie», se demandent ce qu’elles font là-dedans. Imaginez des millions d’être vivants encagés et pédalant à perdre le souffle tels des hamsters ou des rats de labo sur une roue qui tourne à vide. L’image est à peine exagérée lorsqu’on sait que cette métaphore laborantine est souvent utilisée par des experts pour qui la démocratie est une prophylaxie, un antidote ou un vaccin qui préservent, guérissent ou prémunissent ce grand corps malade qu’est le monde arabe contre un mal de vivre politique. Certes, ce n’est pas le propos de l’auteur de l’article précité, bien au contraire, il a su brièvement mettre le doigt sur les erreurs commises par des responsables fraîchement adoubés sans expérience ni même compétence. Le titre de l’article résume d’ailleurs clairement cette approche : «L’erreur islamiste du modèle tunisien». Cependant, la notion de laboratoire et de modèle a été très souvent employée sans discernement en englobant tous les pays avec les dégâts et erreurs d’appréciation que l’on connaît.
Parce que ce qu’on a appelé «révolutions arabes» sont nées sous un signe d’ambiguïté, les transitions qui les ont portées vers un nouveau projet de société (que d’aucuns ont cru inscrit dans la modernité), ont échoué face à la tentation traditionaliste qui a essayé de figer un mouvement nouveau dans une vision du passé. Il en va d’ailleurs de la politique comme de la pensée ou de l’art en général lorsque ceux-ci, dans un tropisme salvateur, tendent à se libérer du carcan du passé. «Maintenir une tradition même valable, écrivait Alfred Jarry en parlant de l’art dramatique, est atrophier la pensée qui se transforme dans la durée ; et il est insensé de vouloir exprimer des sentiments nouveaux dans une forme conservée». Mais le paradoxe est que souvent une tradition surgit ou revient drapée dans les atours flamboyants d’une révolution alors que (et sans vouloir faire dans le jeu de mots facile) le vocable «rêve-évolution» part d’un «rêve», c’est-à-dire une utopie, un projet de société ou une ambition mais qui vont être portés par une «évolution» dans le temps, un progrès au sens de progression, dans l’acception à la fois scientifique et rationnelle du terme, mais aussi chronologique et temporelle.
Mais quid de la proposition de Baudelaire quant au droit de se contredire et celui de s’en aller ? Chaque gouvernant devrait la méditer selon l’idée qu’il se fait d’une véritable démocratie, car lorsque l’erreur, l’inexpérience ou l’incompétence, sont en contradiction avec le principe d’engagement et les promesses qui l’ont porté, le droit de s’en aller devrait être garanti. Une des illustrations de ce droit vient d’être magistralement livrée par le pape Benoît XVI qui a pris la décision de démissionner de ses fonctions pontificales pour des raisons de santé. Invoquant son âge, 85 ans, et sa vigueur, le souverain pontife a confessé qu’elle «s’est amoindrie ces derniers mois d’une telle manière que [je] dois reconnaître [mon] incapacité à administrer le ministère qui m’a été confié».

