Idées
Relancer l’économie
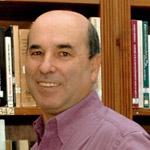
L’économie nationale n’en finit pas de surprendre. Loin de s’effondrer à la suite du choc de la crise, elle pourrait enregistrer une croissance de 5% en rythme annuel. Dès le mois de juillet, le consensus des prévisionnistes faisait repasser la croissance au-dessus de celle de la zone méditerranéenne en 2009. Un comportement étonnant au regard du tableau dressé par la majorité des analystes six mois plus tôt. Après l’éclatement de la crise en 2008, le recul de la demande adressée au Maroc et le ralentissement de l’investissement étaient déjà de nature à faire basculer l’économie dans la récession. Ultime soutien de l’activité, la consommation, revigorée par les revenus des ménages ruraux, a permis de contenir l’effet négatif des canaux de transmission de la conjoncture internationale. Le principal antidote au pessimisme ambiant résidait alors dans l’ampleur des marges de manœuvre dont disposaient les autorités économiques, tant dans le domaine budgétaire que monétaire. De fait, cette liberté d’action a été largement mise à profit. L’explication la plus couramment admise à propos de la «résilience» de l’économie marocaine met en avant l’incidence de la politique monétaire. La baisse des taux d’intérêt par la banque centrale n’a pas seulement limité l’impact potentiellement dépressif de l’offre ou l’effondrement du marché boursier. Elle a réussi à contenir le ralentissement de la consommation des biens durables et maintenir le niveau des dépenses des ménages. La baisse des taux a profité de deux façons aux ménages. Elle leur a d’abord permis de refinancer (et par la même occasion d’étaler dans le temps, voire d’accroître) leurs emprunts immobiliers à des conditions plus favorables. Elle a, d’autre part, évité l’effondrement du boom immobilier. Celui-ci a globalement fait plus que compenser l’effet de la baisse des valeurs boursières sur la richesse des ménages. Contrairement au patrimoine boursier, qui est fortement concentré sur la partie la plus riche de la population, le patrimoine immobilier est largement diffusé et constitue pour la majeure partie des foyers l’essentiel de leur richesse. La valorisation de ce patrimoine leur a permis d’accroître leur consommation, en dépit de la dégradation de l’emploi et de la baisse de la Bourse.
La politique monétaire n’explique cependant pas tout. Les mesures du Plan de crise, vu leur modestie, n’ont peut-être pas engendré un surcroît d’activité, mais le maintien du niveau des dépenses publiques prévues dans la Loi de finances a préservé les stimulants budgétaires à la croissance économique. Durant 2009, l’Etat a injecté des ressources appréciables dans les circuits productifs de l’économie. L’effet multiplicateur de ces ressources a été vraisemblablement relevé par la réaffectation de quelques dépenses, initialement destinés à couvrir les engagements de la Caisse de compensation, vers les programmes d’investissement public. Tirée par la consommation des ménages et la vigueur de l’impulsion budgétaire, la dynamique de l’activité a entraîné un arrêt du mouvement de déstockage, qui aurait pesé sur les chiffres de croissance. Une telle contribution prépare généralement la relance de l’investissement productif dont dépend véritablement la pérennité de la reprise. Celui-ci dépend à son tour de la vigueur de la demande, des marges de capacité de production inexploitée et de la situation financière des entreprises.
L’examen de ces trois variables ne laisse place qu’à un optimisme modéré, dans le meilleur des cas. Les perspectives de consommation, tout d’abord, sont bornées par le niveau d’endettement des ménages. Les ressources mobilisées pour le financement des crédits à la consommation sont essentiellement consacrées à l’équipement des maisons et à l’achat d’automobiles. Ces dépenses ont peu de chance d’être renouvelées à court terme et les données disponibles montrent que le potentiel d’élargissement des prêts s’est amenuisé. A terme, un relèvement des taux d’intérêt pourrait entraîner un retournement du marché immobilier et peser sur le revenu disponible des ménages. Celui-ci a connu une amélioration sensible du fait des bonnes récoltes agricoles, de la baisse du prix du pétrole et de quelques allégements fiscaux. Des facteurs qui ont contribué, cette année, au soutien des revenus et donc de la dépense privée. Il n’est pas acquis qu’ils vont se reproduire en 2010. Côté entreprises, la situation n’est guère plus encourageante. Dans un contexte de concurrence exacerbée sur les marchés d’exportation, la capacité des entreprises à défendre leurs marges de profit est beaucoup plus limitée que par le passé. Les profits des entreprises ont dû tomber à un niveau plus bas que celui de l’année dernière. Compte tenu de l’endettement significatif des entreprises et du niveau encore très bas d’utilisation des capacités productives, une reprise marquée de l’investissement semble peu probable. Autant dire que le profil de la politique macroéconomique de 2010 sera déterminant pour la sortie de crise. Pour prévenir tout décalage dans les retombées de la crise mondiale, il faut que les ménages et les entreprises soient conduits à anticiper sur la reprise, en maintenant ou même en accroissant leurs dépenses au lieu de les réduire. L’Etat sera-t-il amené à soutenir l’activité par des allégements des coûts des emprunts des achats de biens de consommation et d’investissement? Aura-t-il à prendre des mesures pour accélérer les programmes existants en matière de dépenses publiques et contribuer indirectement à la création d’emplois ? La reprise est à sa portée si l’on ose utiliser une combinaison efficiente des politiques budgétaire et monétaire à des fins conjoncturelles.

