Idées
Rééquilibrer la croissance
Le Maroc n’a pas beaucoup à attendre de l’impulsion extérieure. La tendance de la demande externe est une contrainte sur laquelle le gouvernement n’a aucun contrôle : les trois principaux clients du pays connaissent tous de sérieuses difficultés qui affectent, par contagion, la chaîne de la production nationale.
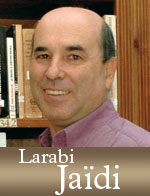
Dans un contexte économique international perturbé, les prévisions de la croissance de l’économie nationale pour 2013 semblent plutôt encourageantes. Les autorités publiques parient sur un taux supérieur à 4%. Une relative bonne nouvelle, une perspective meilleure que tous les voisins. Si la saison agricole, qui s’annonce favorable, confirme l’hypothèse d’un regain de croissance, gardons-nous, toutefois, de tout excès d’optimisme. Au-delà de la performance attendue d’un agrégat macro-économique, fût-il celui de la croissance, les effets de la crise risquent de continuer à se manifester à différents niveaux : précarité de l’emploi, vulnérabilité sociale, reproduction des inégalités… In fine, la robustesse de la réactivité de l’économie nationale dépendra de l’évolution de la position de ses comptes financiers et extérieurs et de sa capacité institutionnelle non seulement à mettre en œuvre des politiques macroéconomiques adaptées, mais à infléchir le profil de croissance vers un modèle de développement plus équilibré.
Le gouvernement s’est appuyé sur les bons antécédents en termes de politiques macroéconomiques robustes et de réformes structurelles pour mobiliser les financements extérieurs et intérieurs nécessaires à la mise en œuvre de politiques contracycliques. Il a pris des mesures pour boucler le budget dans des conditions soutenables. Il a assoupli sa politique monétaire et injecté des ressources supplémentaires pour couvrir les besoins de financement des entreprises. La crise lui a donné l’occasion de réformer les dépenses mal ciblées de la Caisse de compensation et dégager des ressources pouvant bénéficier effectivement aux pauvres et personnes profondément affectés par la crise. Ces mesures et bien d’autres prises par le gouvernement sont des mesures à minima : elles sont indispensables mais elles ne suffiront pas. Davantage d’efforts pouvaient être faits. Des mesures en matière fiscale en vue d’augmenter les recettes, dans le but de diminuer le déficit. Des mesures d’intervention sur le marché du travail en vue de soutenir l’emploi et la génération des revenus. On peut admettre qu’il est difficile de soutenir ce type de mesures sur le long terme car elles peuvent s’avérer délicates à interrompre au cours d’un redressement économique en raison du risque de capture. Mais, dans cet environnement incertain, un programme vigoureux de relance axé sur l’investissement s’imposait car la lente progression des exportations risque de compromettre les emplois au sein des entreprises.
Car, si l’économie mondiale semble en phase de reprise, cette reprise hésitante est véhiculée par des régions et des pays avec lesquels nous n’avons pas de relations commerciales étroites. Nos partenaires et voisins, encore exposés au cycle économique mondial, n’affichent pas de perspectives de redressement. Aujourd’hui nos partenaires traditionnels de l’Union Européenne tournent au ralenti. Conclusion : le Maroc n’a pas beaucoup à attendre de l’impulsion extérieure. La tendance de la demande externe est une contrainte sur laquelle le gouvernement n’a aucun contrôle : les trois principaux clients du pays connaissent tous de sérieuses difficultés qui affectent, par contagion, la chaîne de la production nationale. Le «manque à gagner» en exportations pourrait coûter quelques points de PIB avec son cortège d’effets induits : sous-utilisation des capacités de production, hausse du chômage et perte d’emplois.
C’est à la mise en place d’un modèle de croissance plus endogène que l’Etat devrait réfléchir. Pour susciter un progrès pérenne qui ne soit plus dépendant de tel partenaire ou tel phénomène exogène : aujourd’hui l’économie mondiale, demain la pluviométrie… Car il faut quand même poser une question de fond : comment rendre la croissance de l’économie nationale durable ? Peut-elle durer sans se transformer ? Il y a bien un risque, celui d’une économie qui ne parviendrait pas à enclencher un nouveau cycle économique, qui resterait perpétuellement en voie d’émergence, au bord de basculements qu’elle n’effectuerait pas, soit parce que ses partenaires traditionnels ne transmettent pas les flux avec l’intensité nécessaire, soit parce que ses voisins sont pris dans des convulsions ou n’y ont pas intérêt, soit encore parce que ses élites trouvent plus avantageux de cantonner les évolutions dans un certain seuil pour préserver leurs rentes de situation. On ne peut l’ignorer : l’économie nationale repose sur un système politique «corporatiste» qui maximise les positions et profits des dites corporations (qu’il s’agisse de certaines classes d’affaires, d’ethnies, de familles, etc.) en surfant sur les opportunités de la mondialisation sans pour autant susciter et valoriser l’esprit entrepreneurial. Elles sont donc peu préoccupées, au final, de promouvoir un mode de développement endogène durable, justifiant par exemple des investissements dans la formation et l’innovation, ainsi qu’un mode politique plus représentatif, respectueux d’une répartition plus équilibrée des ressources et du bien-être. Et même si, sur le terrain politique, on observe quelques changements, même si les chancelleries occidentales se félicitent des «avancées démocratiques», on ne peut ignorer que les manquements aux règles de l’Etat de droit, les défaillances du système de l’éducation, les insuffisances de protection sociale handicapent l’économie nationale dans toute velléité de sortie de la vulnérabilité qui est la sienne.
