Idées
Qui doit gouverner ?
Au détour d’une rue, dans un quartier populaire, on lit sur un mur : « Elbouri, dégage ! ». On apprendra que le vilipendé est un marchand ambulant de légumes pris à partie par un autre marchand de légumes plus ancien dans le coin, agacé par la concurrence de l’intrus.
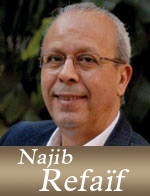
Un an après, on peut relever dans la presse française et notamment dans les rubriques consacrées aux idées et débats, la manifestation d’un certain doute quant aux conséquences de ce qu’on appelle «Printemps arabe». Ce sont souvent les mêmes plumes avisées et enthousiastes qui célébrèrent, une année plutôt, l’avènement de la démocratie dans une contrée qui ne l’a jamais ni connue ni pratiquée. Hommes politiques et intellectuels, en plus des inévitables experts qui hantent les plateaux des télévisions et les tribunes des journaux, ont délivré un certificat de renaissance au monde arabe et fêté l’accès de son peuple à la liberté et à la dignité. Malgré quelques réserves et une certaine inquiétude quant aux résultats des urnes. Car tout le monde en convenait : la démocratie est une pratique et celle-ci passe par un scrutin souverain et transparent. Or, voilà que le peuple, ce bon peuple qui a tant souffert sous le joug de certaines dictatures, choisit des gouvernants qui lui semblent ou se disent proches de ses aspirations. Arithmétiquement majoritaires, les tenants d’une idéologie islamiste qui était dans l’air du temps depuis des années sont sortis victorieux. Et comme dirait Jacques Brel dans sa belle chanson éponyme : T’as voulu voir Vesoul, on a vu Vesoul. La nouvelle donne ne cadre pas tout à fait avec les attentes du «Printemps».
Mais qu’à cela ne tienne. Certains en prirent leur parti et attendent non sans appréhension la nouvelle gouvernance, comme ils disent, de ces barbus dans leur nouveau costume institutionnel. D’autres, plus sages et bienveillants, remontent l’histoire des révolutions et celle des démocraties depuis la Grèce antique pour relativiser le temps de l’apprentissage et de la pédagogie. Une façon de dire qu’il faudrait laisser à ces peuples le temps de se former à l’exercice de la démocratie. Mais quand on sait que ces pays, chacun selon son rythme, ont mis des siècles à instaurer et asseoir des institutions articulées autour d’une démocratie acceptée et intégrée par tous, on est en droit de se montrer sinon impatient, du moins sceptique. Sans compter les autres, bien plus sceptiques qui ironisent sur l’état de délabrement de la démocratie dans les pays dits occidentaux en ces temps de crise, d’indignation et de colère contre les gouvernements et le monde de la finance. En effet, les révoltes et manifestations du Printemps arabe avaient coïncidé, on s’en souvient, avec les diverses marches des indignés et autres occupations de grandes places dans plusieurs capitales d’Europe et jusqu’à Wall Street à New York.
C’est un des paradoxes de la démocratie, et il n’est pas le moindre ni le seul, que d’attirer ceux qui ne l’ont jamais connue tout en attirant les critiques de ceux qui en jouissent. Dans son dernier ouvrage, Qui doit gouverner ? Une brève histoire de l’autorité (Editions Grasset), Pierre-Henri Tavoillot, professeur et président du Collège de Philosophie en France, écrit à juste titre : «La démocratie déçoit ceux qui la possèdent, tout en enthousiasmant ceux qui en sont démunis». Pour cet auteur, c’est là aussi que réside le mystère et que se pose la question : Qui doit gouverner ? C’est du reste la tentative de réponse à cette question qui est le sujet même de son excellent ouvrage qui remonte l’histoire de l’autorité et ses diverses modes d’exercice. Mais on peut se douter qu’il n’en fournit pas une et une seule tant ce mode de gouvernement est en devenir et recèle maints paradoxes et contradictions. Le titre seul de sa conclusion résume en effet ce propos : L’interminable adolescence des démocraties. Autant dire que celles dont on célèbre aujourd’hui sans grande illusion ni enthousiasme le premier printemps en sont à leur premier vagissement.
Restons dans la célébration pour évoquer le vocable francophone «Dégage» qui avait fait florès lors des révoltes en Tunisie, puis en Egypte et ailleurs. Certains se félicitèrent du choix francophone que l’on avait fait et qui avait damé le pion aux fameux vocables anglophones plus usités : Go home et out. Des sémiologues, linguistes et des philologues se sont penchés sur la question, pendant que des chroniqueurs sont allés dénicher, pour s’en délecter, l’étymologie de ce «dégage» dont les acceptions ont traversé la langue française depuis des siècles. Mais il en va des slogans, des vocables et des mots comme de tout ce qui est en vogue à un moment donné : on les met à toutes les sauces puis on les galvaude et enfin on peut en rire. Comment ne pas rire alors lorsqu’au détour d’une rue, dans un quartier populaire, on lit sur un mur ce graffiti en français dans le texte : «Elbouri, dégage !» ? Croyant au départ à une injonction datant du fameux 20 février marocain et visant un agent d’autorité ou un responsable du coin, on va vite apprendre que ledit «Elbouri» vilipendé n’est autre qu’un simple marchand ambulant de légumes. Quant à l’auteur du graffiti, c’est un autre marchand ambulant plus anciennement implanté dans le quartier et agacé par la concurrence déloyale de l’intrus.
