Idées
L’obscure clarté de la nuit
Victor Hugo : « L’homme qui ne médite pas vit dans l’aveuglement, l’homme qui médite vit dans l’obscurité. Nous n’avons que le choix du noir ».
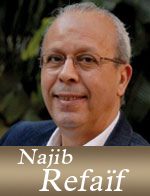
«L’homme qui ne médite pas vit dans l’aveuglement, l’homme qui médite vit dans l’obscurité. Nous n’avons que le choix du noir». C’est ce qu’a écrit Victor Hugo dans un ouvrage intitulé Shakespeare, lequel, loin d’être une biographie de l’auteur de Hamlet, se présente surtout comme un prétexte pour parler de l’art en général et surtout du romantisme comme mouvement littéraire. Ils sont comme cela les grands poètes, ils se mettent à se préparer, à réfléchir et à se promettre de se pencher sur telle question, et c’est tout autre chose qui surgit de leur folle cavalcade dans l’imaginaire. On ne commande pas un poète, on s’en recommande lorsqu’on cherche à appuyer tel sentiment par un argument bien écrit, telle émotion par un poème lu ou telle idée par une citation. C’est du reste ce que fait l’auteur de cette chronique pour introduire le sujet sur la notion du noir, à la fois comme couleur (car le noir est une couleur) et comme idée, état d’âme, situation ou phénomène cosmologique ou astrophysique. C’est ce dernier aspect qui a attiré notre attention sur un article publié lors des rencontres de la Cité idéale organisées l’été passé dans l’abbaye de Fontevraud en France et consacrées à la nuit et aux étoiles. Au cours de ces rencontres, un astrophysicien, Hervé Dole, un type que l’on ne peut que croire sur parole car il est bardé de diplômes, chercheur au CNRS ayant travaillé pour la NASA et qui continue d’enseigner, d’étudier et de chercher encore, bref, cet homme qui sait de quoi il parle et en parle en connaissance de cause et des choses du ciel a donc expliqué dans une longue et belle démonstration théorique à laquelle je n’ai pas tout bien compris sinon l’essentiel, c’est-à-dire la conclusion, à savoir que la nuit n’est pas noire parce qu’elle est traversée par les lumières : «Il est donc permis d’écrire presque sans ironie, écrit-il justement dans la rubrique Débat du quotidien Le Monde (24-25 juin 2012), que la nuit n’est pas noire, dans la mesure où, si nos yeux étaient sensibles aux rayonnements infrarouge et micro-onde, ils verraient une nuit brillante de rayonnements cosmologiques. Le paradoxe n’est qu’apparent, car il existe donc bien des domaines de longueur d’ondes de lumière pour lesquels la nuit est brillante, mais nos yeux ne les voient pas».
En général, les scientifiques ont l’art de casser la poésie et de gâcher l’émerveillement de l’homme tranquille qui ne veut pas se poser de question sur le pourquoi et le comment des choses de la vie. Mais là, avouez que la science ajoute de la poésie à ce qui n’était déjà que trop lyrique. La nuit n’est pas la nuit car son noir n’existe pas puisqu’il est traversé par des lumières cosmologiques que nos autres, pauvres humains, n’apercevons pas, insensibles que nous sommes aux rayonnements infrarouges. Et voilà que le fameux oxymore poétique, «Cette obscure clarté qui descend du ciel», est confirmé puis jeté aux orties comme une vieille et triste figure de style d’une grande et navrante pauvreté rhétorique. Il reste que si le noir de la nuit n’existe pas, c’est toute une couleur qui disparaît, un monde artistique qui s’écroule puisque aucune référence chromatique n’est là pour l’attester. Le peintre monochrome Soulage, par exemple, et dont l’œuvre au noir a fait la réputation, serait un imposteur qui nous aurait bernés. La nuit noire n’est donc que la métaphore de quelque chose qui n’existe pas, qui n’a jamais existé ou alors avant le Big-Bang, mais là il n’y a personne pour en témoigner. Avouez que c’est flippant comme découverte, non ? De toute manière, ce n’est pas cela qui va empêcher les hommes de continuer à s’agripper au mythe de la nuit noire, ni Johnny Hallyday de filer la métaphore en se lamentant que «Noir, c’est noir, il n’y a plus d’espoir». D’accord, nos pauvres yeux de bipèdes bigleux ne sont pas sensibles aux rayonnements infrarouges et autres micro-ondes. D’accord, on ne peut que s’incliner devant le savoir des hommes de sciences, chercheurs intelligents et tout et tout. Mais qui croira que la nuit tous les chats ne sont pas gris ? Qui fournira désormais le noir de la nuit à tous ceux qui s’y réfugient, qui y travaillent, sont en service de nuit pour les bonnes et les mauvaises causes ? A ceux et celles qui pleurent et dansent en chemise de nuit et n’ont que «la nuit pour adresse» et ceux qui s’ennuient jusqu’au petit jour dans les boîtes de nuit ? Bref, pour tous ceux-là et pour bien d’autres, il «règne sur la ville, comme écrit Aragon, une nuit négatrice». Et pour rester chez les poètes car les poètes ont toujours raison, concluons par le plus grand d’entre eux, Victor Hugo, puisque c’est de lui que nous nous recommandons et c’est avec lui que nous avons commencé. S’adressant à ses opposants dans l’Assemblée, du temps où le verbe avait de la gueule et les interventions de la tenue, Hugo écrit : «Nous sommes pour ce qui sert, vous êtes pour ce qui nuit/ Chacun à sa façon de regarder la nuit».
