Idées
L’investissement en perte d’efficience
L’investissement en perte d’efficience
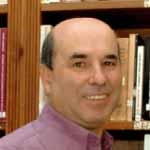
L’investissement est, généralement, considéré comme un vecteur de transformation structurelle. Il constitue la deuxième composante importante de la demande, après la consommation finale des ménages. Mais un des paradoxes de l’économie marocaine est la lenteur des changements structurels alors que le taux d’investissement a été élevé au cours des quinze dernières années. En effet, l’investissement a fait preuve d’un dynamisme sans précédent sur la période 2000-2013 en enregistrant une amélioration de sa part moyenne dans le PIB pour atteindre 32,9% contre moins de 29,2% en 2000. Cette dynamique est le résultat non seulement des efforts soutenus de réformes et de modernisation du secteur financier, mais également de la consolidation des investissements publics dans des secteurs stratégiques tels que les télécommunications, le transport ferroviaire, aérien et routier, les activités portuaires, l’éducation et l’habitat. L’une des caractéristiques de l’investissement au Maroc est la montée de la part des entreprises publiques dans la formation de capital. De 22% en 2000, le poids des investissements portés par les entreprises publiques et les établissements publics (EEP) a atteint 45% en 2012. Au total, l’investissement public, direct et indirect, représente 55,4% de l’investissement total. Le rôle croissant du secteur public s’accompagne d’un déclin de l’investissement privé qui en 2013 représentait 45,6% de l’investissement total comparé à 62,7% en 2002. Les établissements et entreprises publics ont constitué, par ailleurs, de véritables vecteurs de développement, profitant de la modernisation de leur cadre institutionnel et organisationnel, de leurs restructurations opérationnelles dans le cadre de contrats programmes avec l’Etat et de la politique de privatisation et de gestion déléguée des services publics.
Alors que l’économie marocaine affiche un taux d’investissement particulièrement élevé par rapport à ses pairs régionaux, ses performances en matière de croissance ne sont pas significativement meilleures. Ce décalage invite à s’interroger sur l’efficience de l’investissement au Maroc. D’où provient ce décalage ? Une première explication réside dans l’allocation des investissements par secteur d’activité, dans la mesure où le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) est largement prédominant. Ainsi, les ressources allouées aux activités du BTP constituent plus de 50 % du volume global de l’investissement depuis le début des années 2000. Or, une partie de ces investissements est destinée à la construction de logements dont l’effet d’entraînement sur le reste de l’économie est assez limité. En revanche, l’investissement destiné au secteur industriel s’inscrit, quant à lui, à la baisse, dans la mesure où ce secteur représente désormais 38% de l’investissement total contre 43% en 2008. Deuxième explication, la politique d’investissement du gouvernement, concentrée sur de grands chantiers, nécessite du temps avant que les bénéfices ne se matérialisent (construction d’autoroutes, d’aéroports, d’infrastructures portuaires). En revanche, l’investissement dans le secteur industriel est en baisse régulière depuis 2009 en proportion de l’investissement total. Une troisième explication réside dans la présence de contraintes institutionnelles et réglementaires. Le Maroc n’est pas particulièrement bien classé par les différents indicateurs de climat des affaires même si des progrès notables ont été enregistrés dans son classement ces deux dernières années. Ainsi, la Banque mondiale le positionne à la 87e place sur 189 pays dans son dernier rapport Doing Business, soit loin derrière la Tunisie (51) ou la Turquie. Quant au Forum économique mondial, il situe le Maroc à la 77e place sur un total de 148 pays.
Si les indicateurs utilisés par les deux institutions diffèrent quelque peu, ils mettent en exergue certaines contraintes qui entravent le développement du secteur privé au Maroc, aux premiers rangs desquels les carences au niveau de l’administration et les problèmes de corruption, les difficultés d’accès au foncier et les difficultés en termes de transfert de propriété, les problèmes d’accès au crédit pour les PME et l’inefficience du marché du travail imputable notamment à la faiblesse du capital humain. Enfin, les coûts logistiques, estimés à près de 20% du PIB contre 15% et 10% respectivement pour les pays émergents et les pays développés, demeurent élevés.
De façon plus générale, le modèle de croissance en place depuis plusieurs années repose avant tout sur un effort d’accumulation du travail et du capital et non sur celui de l’efficience. La divergence de la productivité du travail au Maroc par rapport aux autres pays de la région est à ce titre éloquente. Pour optimiser la croissance, il faudra recentrer les efforts d’investissement sur l’amélioration de la productivité, ce qui nécessitera à la fois une réorientation des investissements vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée, notamment dans l’industrie, ainsi qu’une nette amélioration du climat des affaires.
