Idées
L’intellectuel et sa doublure
un intellectuel doit-il nécessairement penser contre, s’opposer, se révolter et s’indigner ? contre quoi, contre qui, pourquoi et par quels moyens intellectuels ? telles sont encore une fois les questions pertinentes qui se posent à nous ici
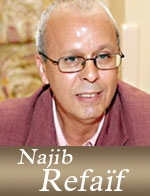
Parler de la démission des intellectuels marocains aujourd’hui, est-ce bien raisonnable ? Parler déjà de leur existence ne l’est pas plus. Et d’abord démissionnaire de quoi et de qui, est-on tenté de se demander ? On lit de plus en plus dans la presse et dans le peu de revues ou d’espaces de débat d’idées qui existe ici ces interrogations sur une entité difficile à cerner. Car en effet, qu’est-ce qu’un intellectuel ? Quelle est son origine, sa marque de fabrique et la fabrique qui le crée ? Quelles luttes mène-t-il et dans quel but ? On voit déjà que le nombre de questions vous dissuade d’aller plus loin dans la quête d’une définition simple et claire. Bien sûr, afin d’y répondre, il serait aisé de se tourner vers le modèle français de l’intellectuel dit engagé, d’en calquer le paradigme et de le coller à telle ou telle catégorie d’écrivains, d’essayistes ou de chercheurs et universitaires de chez nous. Cependant, non seulement comparaison n’est pas raison, mais il est également improbable de trouver un Zola, un Sartre, un Aron ou un Camus. De plus, rien n’est plus difficile et risqué que de se lancer dans une histoire de comparaison culturelle entre les «modèles» et les «admirateurs». C’est justement cet exercice d’admiration qui pousse certains journalistes ou critiques en mal de «copie intelligente» et de textes «intellos» à abuser d’un paradigme aussi injustifiable que fallacieux. Si nous avons cité Zola, c’est à dessein car c’est à partir de l’affaire Dreyfus à la fin du XIXe siècle en France où l’auteur de Germinal a pris partie pour cet officier accusé à tort de haute trahison à cause de ses origine juives. Le célèbre éditorial au titre hautement engagé, J’accuse, a fondé une définition solennelle qui va fonder un statut social pour une certaine catégorie d’intellectuels. Ce statut, qui est une autre exception française, connaîtra différentes fortunes, mais reste en vigueur jusqu’à nos jours. Le développement des médias, notamment audiovisuels, en amplifiera l’écho, avec les intellectuels «cathodiques» du type Bernard-Henri Lévy, André Glucksman, Pascal Bruckner ou le mélancolique Alain Finkelkraut, et depuis peu, l’omniprésent Michel Onfray. Quoique ce dernier ne soit pas trop marqué idéologiquement et se présente plus comme un philosophe de la polémique mais aussi celui du plaisir hédoniste partagé. Quant aux premiers, après avoir déboulonné quelques statues des maîtres penseurs, ils en ont érigé d’autres ou installé quelques fois les leurs. Mais derrière ces intello-médiatiques se cachent humblement une multitude de penseurs et de philosophes plus connus dans les instituts de recherches ou derrière les murs des universités. On en parle peu et peu parlent de leurs travaux, mais leurs œuvres n’en sont pas moins en phase et en intelligence avec l’évolution des idées et des choses du monde.
C’est donc parfois à partir du champ intellectuel et social que l’on pourrait établir, non pas une définition, mais un point d’ancrage. Il est certain que l’université et ce que l’on a appelé «sciences de l’homme» après Durkheim, devenues «sciences humaines» aujourd’hui, sont au cœur du dispositif qui est à l’origine de l’appellation qui nous importe ici. Une désignation qui est chez certains journalistes ou critiques de chez nous une source de malentendus. Est un intellectuel celui qui lit, écrit et n’en pense pas moins. Que lit-il, qu’écrit-il, que pense-t-il et à travers quelle œuvre ? Peu leur chaut. De plus, un intellectuel doit-il nécessairement penser contre, s’opposer, se révolter et s’indigner ? Contre quoi, contre qui, pourquoi et par quels moyens intellectuels ? Telles sont encore une fois les questions pertinentes qui se posent à nous ici.
Mais chez nous, ce ne sont pas les chercheurs et écrivains qui peuvent exciper d’une œuvre cohérente, d’une expérience conséquente et d’une réflexion reconnue qui montent au créneau, comme on dit. Ce sont plutôt les gens qui ont accès à la presse -rarement encore à la télé et peut-être heureusement- en tant que journalistes plus ou moins encartés ou pigistes adoubés par certains journaux qui vendent du papier et des gros titres. Mais dans leur infinie générosité et une fois par semaine, on y sacrifie une page pour s’acheter bonne conscience dans des suppléments, dits culturels, qui sont des suppléments d’âme livrés à quelques plumitifs sans culture et sans ouvrages qui glosent et ergotent sur les choses de la pensée.
Bien sûr, tous ces intellectuels en papier sont engagés. Dans quoi, pour qui et pourquoi ? Seul le vent qu’ils brassent connaît la réponse.

