Idées
L’insupportable grève
Le code de la route
risque-t-il d’amplifier
les comportements de corruption ? C’est le comble de la duplicité. Ce serait admettre implicitement
un seuil tolérable de
la corruption, préférer autonomiser le jeu et
le coût de la négociation entre corrupteur et corrompu.
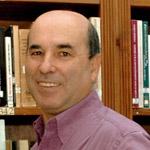
Tout est redevenu normal : les camions roulent, les stations-service sont approvisionnées, les encombrements sont de retour. Mais le prix à payer a été lourd : coût économique, perte de confiance entre partenaires sociaux, perte de crédibilité de l’Etat, prise en otage des citoyens… Dans tous les modes de transport, il existe des conflits. Les grèves n’ont pas manqué chez les cheminots, ou les pilotes. L’intensité des problèmes dépend de plusieurs facteurs : la situation financière du secteur et des entreprises, la politique sociale, l’intensité de la concurrence, les conditions de travail. Mais qu’un cadre réglementaire qui vise à moderniser un secteur, à protéger les citoyens des risques de la route soit combattu avec autant de détermination par la profession, c’est à perdre son latin. On savait que les gens qui transportent les biens ont un formidable pouvoir de pression sur le reste de la société qu’ils peuvent prendre en otage s’ils le souhaitent. Rappelez-vous les tensions entre Kennedy et les associations professionnelles des routiers en 1961 sur la réglementation de la profession aux Etats-Unis. Ou la grève des camionneurs qui a paralysé le Chili du temps d’Allende en 1972. Aujourd’hui, face à ce chantage, nous sommes encore plus exposés qu’hier. Toutes les évolutions de notre environnement économique vont vers plus d’échanges entre agents économiques, plus de flux tendus, moins de stocks et donc plus de vulnérabilité.
Loin d’être confrontés au simple dilemme classique du gouvernement face au corporatisme, nous voici plutôt en présence d’une situation incompréhensible : pourquoi des mesures soutenues par une grande partie de l’opinion publique ne sont-elles pas admises par une profession ? Aucun de ses arguments ne résiste à l’analyse. Inadaptation de la loi à l’environnement national, sous prétexte que la nouvelle réglementation est «importée»? Balivernes ! Des normes standard régissent aujourd’hui les activités économiques de biens et de services. Le transport routier n’y échappe pas. Il y a quelques années, la première mouture de la loi sur la société anonyme a reçu le même accueil : une grève dans son application. Avec des conséquences moins graves, les entreprises se sont redéployées sur un cadre plus souple, celui de la SARL. Mais l’attitude est la même : refus de moderniser le statut juridique de l’entreprise en arguant de la pénalisation de la faute. Le code de la route a-t-il vraiment alourdi la sanction des infractions ? Pas vraiment ! L’innovation est dans le simple assemblage dans un même document de mesures figurant dans le code pénal. Autrement dit : on n’a fait que rendre plus visibles les dispositifs de la loi. Le code de la route risque-t-il d’amplifier les comportements de corruption ? C’est le comble de la duplicité. Ce serait admettre implicitement un seuil tolérable de la corruption, préférer autonomiser le jeu et le coût de la négociation entre corrupteur et corrompu.
Pourquoi le gouvernement a-t-il préféré reculer sous la pression et avec un effet d’image déplorable ? Un déficit de dialogue ? Difficile à comprendre, sachant que le dossier a fait l’objet de plusieurs mouvements de protestation et de rounds de concertations. On a de la peine à croire qu’en gelant le dossier, le gouvernement accepterait de revenir sur la politique engagée voici quelques années, dont l’objectif est de modifier la réglementation du transport routier, afin de moderniser le secteur et de réduire l’hécatombe sur les routes. Ce serait une régression inquiétante, quand on prend la mesure des conséquences de l’insécurité routière sur nos vies. Faut-il pour autant condamner l’attitude du gouvernement de vouloir relancer le dialogue? Ce serait raisonner de manière rigide que de croire qu’un bras de fer était la solution ! Notre société est habituée aux conciliabules dans le dénouement des crises mais ne faut-il pas songer à des solutions institutionnelles dans la régulation des conflits de cette nature ?
Cette grève a relancé le débat sur le service minimum dans les services publics. Souvent de façon caricaturale: d’un côté, les défenseurs inconditionnels du droit de grève, prêts à dénoncer une mesure «liberticide», et, de l’autre, ceux qui dénoncent la «prise en otage» des usagers. En fait, le statut du secteur est entre la profession indépendante et le service public. N’empêche qu’il ne peut se soustraire à des sujétions particulières, imposées au nom des impératifs de continuité ou de sûreté qui caractérisent ces activités. Imagine-t-on un hôpital qui refuserait les urgences ou des électriciens qui se tourneraient les pouces pendant qu’une panne plonge une ville dans le noir ? Certains rêvent aujourd’hui de limiter strictement le droit de grève. Inacceptable. En revanche, les acteurs économiques et sociaux doivent admettre que les statuts dont ils bénéficient sont la contrepartie du caractère particulier du service qu’ils rendent à la collectivité. Celle-ci doit pouvoir décider, par la voie démocratique, dans quelle mesure ce service ou cette activité est indispensable ou non. Et si elle en juge ainsi, le faire accepter est affaire de négociations et de bonne foi de part et d’autre. D’autres pays y sont parvenus. La tâche est particulièrement difficile dans le transport routier : l’entreprise a une tradition de gestion archaïque et les divergences d’intérêt y encouragent les surenchères.

