Idées
L’insoutenable légèreté budgétaire
Pour rétablir la soutenabilité budgétaire ou la préserver, il ne suffit pas d’opérer de nouveaux ajustements des soldes budgétaires au gré de la conjoncture. Il faut mettre en oeuvre de nouvelles règles qui réorganisent les finances publiques.
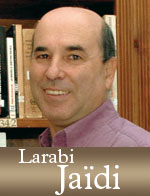
Les perspectives budgétaires se sont assombries au point de s’interroger si les finances publiques du pays ne sont pas engagées sur une trajectoire d’insoutenabilité. Au début des années 90, un déficit de 5% faisait craindre le retour des démons de l’endettement et de l’inflation et menaçait de brider la croissance. Alors que la nouvelle Constitution impose au Parlement et au gouvernement de veiller à «l’équilibre des finances de l’Etat», le bateau de nos finances tangue dans une mer agitée. Sa coque est à 7% au dessous du niveau de flottabilité. L’inquiétude du naufrage est grande, compte tenu du fardeau de dépenses futures et d’un gouvernail des ressources au point mort.
De nouvelles règles budgétaires efficaces sont nécessaires pour aider à rétablir ou à préserver la soutenabilité budgétaire. De fait, dans beaucoup de pays les procédures budgétaires sont soumises à des règles visant à assurer une meilleure discipline dans la gestion des finances publiques en fonction des variations cycliques. Certes, aux États-Unis comme dans la zone euro, le cadre de ces règles a été de plus en plus contourné. Des règles bien conçues sont difficiles à établir ; elles font l’objet d’une renégociation, l’objectif étant de garantir que l’assainissement budgétaire soit irréversible et compatible avec la dynamique de la croissance. La mise en place des nouvelles règles soulève un certain nombre de questions pour trouver un compromis entre l’efficience économique et des considérations plus pratiques. Quel devrait être l’objectif approprié (le niveau de la dette, du déficit ou des dépenses) ? Devrait-il être réalisé en permanence ou sur un horizon défini (par exemple, le cycle économique) ? Des éléments spécifiques (en particulier l’investissement public) doivent-ils être exclus de la définition de l’objectif ? Aujourd’hui, le Maroc est appelé à se poser les mêmes questions et à adopter des règles qui lui permettraient de gérer ses finances publiques dans l’efficacité et la transparence. D’autant plus que nous sommes à la veille d’une nouvelle loi organique des finances.
Tout d’abord, quelle cible retenir ? Le niveau du déficit ou celui de l’endettement ? En fait, le ciblage d’un niveau soutenable de déficit budgétaire renvoie à celui de la dette pour mieux prendre en compte les considérations de soutenabilité à long terme et d’équité intergénérationnelle. Mais la définition du niveau d’endettement souhaitable reste nécessairement subjective, et des objectifs pour le solde budgétaire ou pour les dépenses peuvent sans doute être plus aisément compris par l’opinion publique. Un inconvénient commun aux objectifs d’endettement et de déficit est qu’ils peuvent toujours être réalisés par des augmentations d’impôts, avec des conséquences risquées pour la croissance économique. On serait donc conduit à préférer un objectif de plafonnement de dépense ou du moins de certaines dépenses. Cibler le solde budgétaire et adhérer conjointement à une norme de dépense pourrait être une solution, peut-être avec une plus grande marge de manœuvre quand le niveau d’endettement est plus bas.
Ensuite, il faut choisir un horizon pertinent. La règle peut être définie sur une base annuelle ou sur le cycle d’activité. Définir un objectif de déficit en termes corrigés des évolutions conjoncturelles permet de répondre aux fluctuations cycliques et de faire face à des circonstances exceptionnelles. En outre, ce dispositif décourage le recours à des prévisions de croissance exagérément optimistes, puisqu’un tel optimisme impliquerait des objectifs ambitieux pour le solde budgétaire non corrigé. Ces avantages ont toutefois pour contrepartie une perte de simplicité, étant donné que l’objectif n’est pas observable avec clarté. Aussi faudrait-il accélérer l’adoption d’un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) pour assurer plus de visibilité à la pluri-annualité budgétaire globale et sectorielle.
En plus, il faudrait définir les éléments à exclure de l’objectif. Étant donné que l’investissement public confère des avantages aux générations futures, les considérations d’équité intergénérationnelle semblent plaider pour le ciblage du solde budgétaire courant et non du solde total. Cette règle peut aussi aider à neutraliser le biais à l’encontre de l’investissement public observé par le passé, où ce poste était une cible facile pour des compressions de crédits. Toutefois, dans la pratique, la distinction entre dépenses courantes et dépenses d’investissement est quelque peu arbitraire. Du reste, ces deux dépenses sont souvent liées. Là aussi, la refonte de la nomenclature budgétaire et l’adoption d’un budget-programme sont d’une grande utilité. Enfin, pour être crédibles, les règles devraient être ressenties comme étant contraignantes et confortées par des sanctions. Toutefois, les dispositifs peuvent renfermer des clauses dérogatoires offrant une certaine flexibilité, de sorte que la politique budgétaire peut remplir son rôle stabilisateur ou faire face à des circonstances particulières.
Assurer la soutenabilité budgétaire à long terme demeure un défi. Pour rétablir ou préserver cette soutenabilité, il ne suffit donc pas d’opérer de nouveaux ajustements des soldes budgétaires au gré de la conjoncture. Il faut mettre en œuvre de nouvelles règles qui réorganisent les finances publiques. L’application de règles est souvent difficile et nécessite de considérer avec précaution les objectifs appropriés et les compromis qu’elles impliquent. Un des moyens d’atténuer le dilemme crédibilité-flexibilité est d’améliorer la transparence de la gestion budgétaire par l’obligation faite à l’Exécutif de soumettre au Parlement des programmes annuels de stabilité. Les deux pouvoirs assumeront, ainsi, une responsabilité partagée dans la préservation de nos équilibres financiers, comme le veut la Constitution.
