Idées
Les temps de la réforme budgétaire
Annoncée et reportée à diverses reprises, la réforme de la Loi organique des finances sera-t-elle adoptée durant cette législature ?
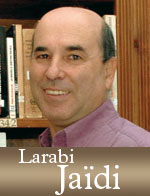
Annoncée et reportée à diverses reprises, la réforme de la Loi organique des finances sera-t-elle adoptée durant cette législature ? Depuis quinze ans, la loi organique de 1998 règne sans partage sur la gestion de l’Etat. Et depuis autant d’années, on dénonçait ses défauts. Elle maintenait un cadre de gestion rigide et parfois opaque, héritier des lois de 1963, 1970 et 1972 élaborées et adoptées en l’absence d’institutions parlementaires. Elle portait à son paroxysme le «parlementarisme débridé» de la Constitution de 1996, en marginalisant les capacités d’amendement du Parlement, et en lui laissant une visibilité réduite sur l’exécution budgétaire. Certes, des réformes budgétaires ont été menées. Elles sont restées à mi-chemin de leurs finalités. La gestion axée sur les résultats ne pouvait s’extraire de la logique d’une loi organique qui raisonne en termes de moyens et non d’objectifs.
Depuis la révision de la Constitution un espoir est apparu, celui de donner un nouveau souffle aux réformes en souffrance et d’initier d’autres. La loi organique des finances figure parmi les priorités. Pour une raison simple : elle est en elle même une véritable «constitution financière». Et bien plus. Sacralisée par son aura de loi organique qui la place à un niveau élevé dans la hiérarchie des normes, elle rendrait possible une réforme plus générale de l’administration, espérée et attendue depuis des années. Par l’ensemble des chantiers qu’elle ouvrirait, la Loi organique des finances (LOF) est le fondement d’une profonde transformation du cadre de la gestion publique. Elle ne se traduit pas seulement par l’élaboration de nouveaux budgets ministériels fondés sur la logique de performance, ni même par la construction d’une nouvelle fonction comptable sur la base d’une comptabilité d’exercice, le développement de nouveaux modes de gestion et la mise en place de nouveaux systèmes d’information. D’autres textes novateurs devront être votés dans son sillage, portant sur le développement du contrôle de gestion de l’administration. D’autres textes devraient aussi être adoptés, qu’ils concernent la déconcentration ou les stratégies ministérielles de réforme. C’est sous son couvert que se développeront les réformes administratives dans les ministères. A cette diversité, la LOF devrait donner une cohérence, assurer un sens.
Aujourd’hui, les espoirs que suscite la LOF sont à la hauteur des frustrations que l’attente des autres réformes de l’administration avait provoquées. D’où le risque d’un malentendu, susceptible de déboucher sur une forte déception. Quand on parle de réforme budgétaire à l’étranger, on utilise l’expression : «new public management» (nouvelle gestion publique). Au Maroc, on devrait parler de «réforme de l’Etat». Parce que justement, la réforme de la Loi organique des finances s’inscrit dans un mouvement plus vaste de réformes institutionnelles. Cette différence de langage illustrerait l’idée que l’on devrait considérer la réforme budgétaire comme un dispositif institutionnel essentiel dans «la gouvernance de l’Etat», tandis que la modernisation de la gestion publique n’est en général perçue et traitée, elle, que comme un simple problème administratif.
Une telle approche revient à ne pas considérer la LOF sous son seul côté budgétaire et comptable ; il est nécessaire de prendre en compte son cadre institutionnel, susceptible d’emporter l’adhésion des acteurs. Le gouvernement a clairement affiché son ambition d’en faire une «réforme systémique». Cette loi redéfinirait l’équilibre des forces entre pouvoir législatif et pouvoir exécutif au profit du Parlement : une telle mutation, concernant en outre le domaine financier, ne peut être sans conséquence sur l’organisation de l’Exécutif. En outre, comme la LOF porterait sur les Lois de finances, sa mise en œuvre serait pilotée par le ministère de l’économie et des finances, dont le poids et l’influence sur l’ensemble de l’appareil administratif sont déterminants. Enfin, le Parlement ne se contente pas d’y adhérer, il souhaite être impliqué, pour la première fois de son histoire, dans la conception et la mise en œuvre de la réforme.
Ce consensus apparent ne doit pas sous-estimer la résistance au changement. Diverses contraintes vont se dresser face à la mise en œuvre de la réforme : technique, humaine, juridique… Mais un obstacle plus que d’autres doit être maîtrisé si l’on veut garantir le succès de l’opération : la maîtrise du temps de la réforme. Aujourd’hui, la LOF a peut-être défini sa mouture première, son cap. Mais le temps joue contre le processus de son élaboration. La loi n’est pas encore votée. Son entrée en vigueur demandera du temps. Il faut donc fixer la date critique, échéance à compter de laquelle s’exécutera pour la première fois une Loi de finances établie sous les nouvelles règles et de nouveaux cadres de gestion. Dans la plupart des pays étrangers qui ont vécu une réforme de la gestion publique, une dizaine d’années ont été nécessaires. Quoi qu’il en soit, le projet ne se mettra en œuvre que progressivement, il faut du temps pour que les structures de pilotage de la réforme soient créées, pour que l’ensemble des directions des ministères s’approprient le projet. Quant à certains concepts de la LOF, ils ne trouveront sans doute leur clarification méthodologique que quand ils seront éprouvés par la pratique. Le temps des principaux acteurs de la LOF peuvent ne pas converger. Le temps politique, lié à la prise de décision et à la communication, débouche souvent sur la succession d’effets d’annonces sur la réforme : cette addition incessante de réformes proclamées ne les rend pas forcément crédibles aux yeux du citoyen. Inversement, le temps de la mise en œuvre administrative de la réforme, plus long, facilite l’opposition au changement, en diluant la réforme dans les méandres administratifs. En se brouillant, ces discours peuvent entacher la réforme de discrédit. Aux principaux acteurs d’agir pour que les deux temps de la réforme soient synchrones, en phase, rendant possible la naissance d’une dynamique.
