Idées
Les multinationales du Sud
Les entreprises émergentes réunissent des caractéristiques communes, qui font d’elles des compétiteurs dans l’économie mondiale.
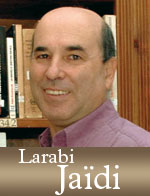
Dans les classements internationaux des plus grandes entreprises mondiales effectués par Forbes, le Financial Times, le BCG (Boston Consulting Group) ou encore la Confédération des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le constat est unanime : les multinationales originelles des pays en développement ont fait une entrée remarquée et remarquable sur la scène internationale. Les entreprises dites émergentes deviennent des acteurs de plus en plus visibles sur la scène internationale. Elles s’appellent Cemex (Mexique), Tata (Inde) ou encore Koç Holding (Turquie). Elles sont chaque année plus nombreuses à entrer dans la compétition globale. Le magazine Fortune répertoriait en 2011 dans son «Global 500» 31 entreprises brésiliennes, la Chine en comptait 91, l’Inde 47…
Les entreprises émergentes réunissent des caractéristiques communes, qui font d’elles des compétiteurs dans l’économie mondiale. Elles ont souvent acquis une position dominante sur leur marché d’origine, accumulé d’importantes ressources financières grâce à une croissance fulgurante et bénéficient d’avantages comparatifs non négligeables, tels que des coûts de production peu élevés. Certaines d’entre elles, en particulier dans les secteurs stratégiques que sont les matières premières, sont des entreprises publiques ; elles servent souvent de paravent aux Etats d’origine qui cherchent à sécuriser leurs marchés ou leurs sources d’approvisionnement. Certains Etats n’hésitent d’ailleurs pas à leur apporter un appui politique et financier (prêts préférentiels, baisses de taxes ou octroi de subventions).
Les concessions sont le premier procédé par lequel ces entreprises qui débutent leur internationalisation se rapprochent des marchés d’implantation. Les entreprises pétrolières et minières publiques chinoises sont particulièrement au fait de ces méthodes. En Afrique, elles obtiennent des concessions en échange d’emprunts ou de prêts attribués par les banques chinoises pour financer des projets d’infrastructures ou de logements. Cette pratique est en train de devenir monnaie courante sur le continent africain, comme en témoigne, dans divers pays, l’obtention par des entreprises indiennes et coréennes de concessions en échange de la construction d’infrastructures.
Une autre tendance se dessine depuis quelque peu : les partenariats stratégiques et opérations de fusions-acquisitions entre multinationales du Sud. En 2011, le montant des fusions a atteint près de 20 milliards de dollars en intra-Asie, 7 milliards en intra-Amérique latine et 1,5 milliard en intra-Afrique. Des pays comme la Chine et l’Inde s’appuient sur leurs diasporas pour favoriser les relations entre leurs entreprises et celles du Sud-Est asiatique. En Afrique, des opérations de grande ampleur entre entreprises africaines et asiatiques ont été réalisées, notamment dans le secteur financier. La prise de participation par la première banque chinoise (ICBC) de 20% dans la banque sud-africaine Standard Bank est à cet égard emblématique. Elle accède par la même occasion à l’important réseau panafricain de cette banque. Dans les télécommunications, ces types d’opérations ne se comptent plus.
Dans leur stratégie d’internationalisation, les entreprises du Sud commencent par miser sur les pays en développement, plus proches géographiquement et culturellement, avant d’accéder au marché globalisé, une fois la taille conséquente acquise et les ressources nécessaires à leur croissance sécurisées. L’expansion «naturelle» des entreprises émergentes du Sud se fait d’abord vers des pays voisins qui disposent d’avantages attractifs : un réservoir de main-d’œuvre, un potentiel de croissance de nouveaux consommateurs, des matières premières abondantes. Elles accèdent ainsi à de nouveaux marchés, élargissent leurs réseaux de distribution, produisent à des coûts encore moindres, et renforcent leurs économies d’échelle. Au delà de l’expansion et de la profitabilité, ce premier contact avec des marchés étrangers représente, pour les entreprises du Sud, un excellent terrain d’apprentissage pour adapter leurs produits aux pays visés et développer l’innovation.
Ces dernières années, un nouveau phénomène est observé. Il s’agit de la sortie des multinationales du Sud hors de leur zone d’expansion «naturelle». Elles visent des zones géographiques lointaines. Le continent africain attire énormément les entreprises chinoises et indiennes. Plusieurs centaines de milliers d’entreprises s’y sont implantées. On y trouve les entreprises chinoises du secteur du BTP, de l’électroménager, des télécommunications, de l’automobile…
Les entreprises indiennes, quant à elles, sont présentes dans l’agroalimentaire, les transports, la sidérurgie, le textile, l’industrie pharmaceutique ou encore les télécommunications. Les entreprises asiatiques semblent aussi porter une attention particulière aux pays d’Amérique latine et des Caraïbes. Bien plus, les rachats de certains fleurons occidentaux par des multinationales originaires des pays émergents attirent l’attention des médias ; il est vrai que ces opérations bousculent l’ordre établi. Mais, aussi spectaculaires soient-elles, ces opérations ne sont pourtant que la partie la plus visible d’un processus qui ira en s’accélérant. Plusieurs grands groupes issus des économies émergentes viseraient à l’avenir à localiser une partie de leurs investissements dans les pays développés pour faire du «rattrapage technologique».
Dans ce mouvement d’expansion internationale des entreprises du Sud, le Maroc n’est pas en reste. Prendre bonne note des méthodes, des échecs et des succès de leurs consœurs du Sud permettrait à nos champions nationaux d’affiner leur stratégie d’internationalisation pour mieux s’adapter à un environnement économique de plus en plus compétitif.
