Idées
Les impasses algériennes
L’ordre social algérien est un «ordre social à accès limité». Le pouvoir politique crée des rentes qui permettent de maintenir une «stabilité» sociale.
La politique économique se résume à la redistribution de la rente, en limitant les initiatives privées pour maintenir la société dans un état de dépendance envers l’Etat.
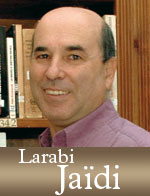
Dans le foisonnement des écrits sur le cinquantenaire de l’indépendance algérienne, trois regards m’ont impressionné. Trois essais percutants d’intellectuels algériens profondément attachés à leur pays. Trois éclairages sans concession sur les impasses politiques, les échecs économiques et les angoisses d’une société en quête d’alternative. «Chroniques d’une expérience post-coloniale de modernisation»1, c’est le titre de recueil de textes de Lahouari Addi. Le politologue interroge la société algérienne contemporaine, évoque le rôle de l’armée, aborde l’écriture de l’histoire avec vigueur, sur un ton intempestif. La séquence historique investiguée (1991-2011) correspond aux mandats de Bouteflika mais elle est tout à fait significative des cinquante années d’indépendance du pays. En 50 ans, la société a changé, mais le régime n’a pas évolué. L’armée, qui a donné naissance à cet Etat, se comporte comme une «mère qui refuse de voir grandir son fils et s’autonomiser d’elle». Dans cet Etat fermé sur lui-même, rongé par la corruption, l’offre politique demeure de faible qualité et sans maîtrise des défis auxquels le pays est confronté. Le pouvoir politique s’oppose à la formation de corps intermédiaires indépendants. Le régime autoritaire, en crise de légitimité, semble épuisé historiquement et idéologiquement. Les dernières élections n’ont fait qu’approfondir la rupture entre l’Etat et la société.
Sombre bilan d’une «société jeune dirigée par des vieux». Une société encore en pleine construction, sur les décombres des communautés locales traditionnelles… C’est pour cela que les jeunes Algériens ne se reconnaissent pas en l’élite au pouvoir, prennent conscience de manière confuse qu’ils ont des opinions politiques et idéologiques différentes. L’Algérie est en train de naître à la politique. Dans ces chroniques, l’Algérie apparaît en suspens : une société où les tensions sociales s’amplifient ; un pays sur lequel planent de grandes incertitudes et qui est sommé de régler la question de la gouvernance. Entre-temps, les cercles occultes continuent d’amasser des fortunes sur la base de la spéculation et la corruption.
«Algérie, l’impasse»2, c’est le titre de l’ouvrage de Zoubir Benhamouche. Selon l’auteur, l’échec de l’Algérie est encore plus flagrant dans le domaine économique. Dans les années 1990, la majorité des Algériens pensaient que le pays s’apprêtait à tourner une page de son histoire, à rompre avec la logique rentière qui prévalait jusque-là. Malheureusement, cette logique a été renforcée avec l’aisance financière du début des années 2000. En un peu plus de dix ans, plus de 200 milliards de dollars ont été injectés dans l’économie, avec des conséquences économiques et sociales extrêmement limitées. Comment comprendre ce paradoxe apparent ? L’Algérie a tout misé sur une politique de grands travaux, en important absolument 75% de ses biens de consommation et tous ses équipements. La dépense publique profite aux sociétés étrangères, une autre partie est prélevée par les importations, l’autre est rongée par l’inflation, une autre est absorbée par la corruption, et enfin une faible partie se fait au bénéfice de l’économie nationale… Rien n’a été fait pour doper le secteur privé, aider les entreprises à se moderniser. Ainsi, l’abondance de réserves de change n’a fait qu’accentuer la dépendance du pays aux hydrocarbures, et renforcer les comportements d’éternels rentiers (à tous les niveaux de la société).
Cette abondance financière a en fait largement contribué à renforcer les facteurs du mal-développement de l’Algérie. Le premier de ces facteurs est connu sous le nom de «paradoxe de l’abondance». Il se résume par l’émergence d’institutions dites «d’extraction», du fait de l’abondance d’une ressource naturelle. Ce modèle institutionnel, qui perdure depuis 50 ans, est socialement perçu comme au service de groupes d’intérêts privés. Il s’est enraciné au sein de l’administration, dans les comportements de toute la société mais également dans l’économie (l’informel, les monopoles, les circuits des importateurs, etc.). Ainsi, en maintenant la logique rentière de la société, non seulement d’importantes poches de résistance aux réformes se sont formées, mais, en plus, le coût social des réformes est décuplé. L’Etat a perdu l’autorité nécessaire pour mener de véritables réformes. La conséquence en est la destruction de la confiance sociale, l’érosion des valeurs morales, une absence de culture du compromis et une société devenue extrêmement violente. L’ordre social algérien est un «ordre social à accès limité». Le pouvoir politique crée des rentes qui permettent de maintenir une «stabilité» sociale. La politique économique se résume à la redistribution de la rente, en limitant les initiatives privées pour maintenir la société dans un état de dépendance envers l’Etat. L’auteur finit par s’interroger : l’Algérie est-elle réformable ? Une question qui peut paraître saugrenue mais qui souligne avec acuité l’importance et l’urgence des réformes institutionnelles à mettre en œuvre.
«La Martingale algérienne»3 est le troisième regard porté sur l’Algérie par Abderrahmane Hadj-Nacer, ancien gouverneur de la Banque centrale. L’essai fournit une grille de lecture, sinon une tentative d’explication de la crise qui menace les fondements mêmes de l’Etat. L’essai s’adresse à des jeunes qui n’ont pas connaissance de leur histoire. La seule légitimité sur laquelle repose le régime, c’est la légitimité dite révolutionnaire. Ce n’est pas la légitimité historique. Jusqu’en 1973, l’Algérie obéissait à une logique de développement. A partir de 1973, la logique rentière s’est installée. L’auteur observe aussi que, paradoxalement, la richesse pétrolière ne contribue pas au développement, et introduit même un facteur de perversion. «A 15 dollars le baril, le pays se met au travail et engage des réformes. A 20 dollars, il ne fait plus d’effort».
Le régime avait une possibilité d’évolution dans les années 1980 et 1990. Une forme d’Etat se constituait. Aujourd’hui, c’est un système opaque qui ne permet à personne de répondre à la question : «Qui est responsable ?». Le système politique semble figé dans un modèle où l’armée détient la légitimité et délègue l’autorité à des civils qu’elle charge de diriger l’administration gouvernementale. Ces réflexions personnelles cherchent à cerner les mécanismes socio-historiques qui ont conduit le pays à s’enliser. La désaccumulation ne se manifeste pas uniquement dans l’ingénierie, la gestion, la gouvernance, mais aussi dans cette incapacité de nombre d’Algériens à ressentir et exprimer le respect de soi, donc des autres. L’inconsistance des élites économiques est narrée de manière convaincante.
Dans ces trois références, les vérités sur l’Algérie sont dites d’une manière crue avec un sens aigu de l’analyse et de l’explication. Elles livrent une analyse rigoureuse -un rien désabusée- de l’état du pays. Pour les trois auteurs, l’Algérie est à la croisée des chemins. Autrement dit, soit elle essaye de se relever en utilisant les potentialités humaines et les richesses naturelles dont elle dispose, soit elle entrera dans une crise profonde. Ce sont aussi des livres d’espoir sur les enjeux des réformes institutionnelles et de la citoyenneté.
1-Editions Barzakh, Alger ; janvier 2012
2-Editions Publisud, Paris, décembre 2011
3-Publié aux éditions Barzakh à Alger ; juin 2011
