Idées
Les états généraux de la santé
La question des droits des patients, en particulier de l’accès à l’information, est quasiment absente dans notre système de soins. Quand elle se manifeste, elle prend souvent la forme d’une remise en cause de comportements médicaux jugés peu vertueux ou irresponsables.
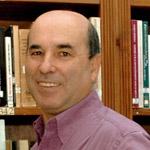
Le chantier de l’Amo est en panne. Des décrets d’application tardent à être adoptés et publiés. Une aubaine pour les assureurs privés en quête d’opportunités pour renvoyer aux calendes grecques le basculement vers le régime public. Au risque de mettre en danger les équilibres futurs de la CNSS. La politique conventionnelle est dans un état de guerre de position. Les conventions médicales signées entre les professionnels de santé et l’Anam, qui régissent les conditions d’exercice et de remboursement des actes médicaux, sont pour partie ou en totalité rejetées par le secteur privé, ce dernier les jugeant contraires à ses intérêts. Le médicament plombe les dépenses de remboursement et souffre de l’absence de politique d’ensemble. Le flou du partage des responsabilités, les méfiances et les désaccords entre le ministère et le secteur libéral, le poids des habitudes freinent l’avancée. Ces tergiversations successives reflètent le piétinement des procédures qui devaient assurer la maîtrise de la progression du chantier. Ce qui fait problème, c’est que le gouvernement semble s’accommoder de cette situation qui fait évidemment perdre beaucoup de son sens au principe de solidarité sociale. Or, le chantier de l’Amo est toujours d’une urgente priorité. Pour une raison simple : le Maroc est un pays où les inégalités de santé sont fortes. Assurer une plus grande égalité dans l’accès aux soins nécessite que ceux-ci soient financés, non par les malades eux-mêmes, mais par la collectivité, via des prélèvements obligatoires. Cela ne va pas de soi, car il faut s’assurer que les prélèvements effectués sont légitimes, eu égard aux priorités décidées collectivement et à l’évolution des techniques et de la démographie. L’objectif est donc d’élargir le champ de la couverture -population et prestations- tout en maîtrisant les dépenses. C’est de là que vient le problème. Car les dépenses de santé ne sont pas seulement une charge pour la collectivité. Elles constituent aussi la source de revenus des professionnels de santé (médecins, dentistes, pharmaciens, laboratoires d’analyses…). Une clarification des rapports entre professionnels de santé, caisses d’assurance et pouvoirs publics est donc nécessaire si l’on souhaite améliorer les performances du système de soins. Au-delà de la question du lien entre rémunérations des professionnels et organisation du système, il faut aborder les enjeux de fond : le contenu de la politique de santé publique, les inégalités à réduire et les dépenses à maîtriser en priorité. Comment sortir d’une organisation segmentée du système de santé, puisque la santé humaine ne se découpe pas en rondelles et mettre en place des réseaux entre médecine de ville et hôpital, entre médecins spécialistes et généralistes, entre médecins, autres professionnels de santé et intervenants sociaux ? Cela demande un vrai bouleversement des pratiques professionnelles et des modes de financement actuels. Comment réduire les considérables inégalités d’offre des soins entre régions en arrêtant des règles de répartition de l’offre de soins dans le territoire transparentes et débattues ? Pour la médecine libérale, doit-on revenir sur la totale liberté d’installation des médecins, en instaurant un mécanisme d’incitation dans le choix des zones géographiques ? Quelle base donner à la rémunération des professionnels et des structures de soins ? Pour la médecine libérale, si l’on veut développer les réseaux, revaloriser l’acte intellectuel et faire du généraliste un acteur de la prévention, ne faudrait-il pas à l’évidence sortir d’une rémunération à l’acte ? Pour l’hôpital, si l’on veut répartir correctement l’offre sur le territoire, faciliter les collaborations entre structures publiques et privées, ne faudrait-il pas aller vers des modes de tarification s’appuyant sur les pathologies prises en charge ? Quels impératifs de qualité des soins ? Ne faudrait-il pas soumettre l’ensemble des médecins à une procédure de re-certification qui est -en général- mal accueillie par les intéressés. Comment dans ce cas l’articuler à la formation médicale continue ?
Ne faudrait-il pas compléter la politique de santé par une politique industrielle du médicament, sans quoi la révision périodique de la liste des médicaments pris en charge par l’assurance maladie sera perçue comme une nouvelle ruse pour faire des économies ? Il ne suffit pas de dire dans les couloirs qu’on entend réduire à terme le poids des dépenses pharmaceutiques, les pouvoirs publics doivent faire connaître clairement leurs objectifs et en assumer les conséquences à l’égard de l’industrie. Quelle place pour les patients ? La question des droits des patients, en particulier de l’accès à l’information, est quasiment absente dans notre système de soins. Quand elle se manifeste, elle prend souvent la forme d’une remise en cause de comportements médicaux jugés peu vertueux ou irresponsables. Ne faudrait-il pas sortir de ces perceptions négatives en affirmant la présence des usagers dans ce champ sanitaire en plein bouleversement ? En contrepartie de la multiplication des acteurs dans le secteur des soins, une certaine confusion règne sur le rôle de chacun. Le dialogue avec les professionnels de santé -qui suppose l’existence d’organisations de médecins réellement représentatives- est biaisé, alors qu’il est une des conditions d’une réforme efficace du système de santé.
Quelles places respectives pour le ministère, le Parlement, l’Anam , les professionnels, les partenaires sociaux, les patients ? Il va falloir clarifier les responsabilités de chacun. Alors, pourquoi ne pas organiser des états généraux de la santé en appelant à une mobilisation citoyenne, articulant les droits aux devoirs autour des questions de santé ?
