Idées
Lectures et digressions
si l’on ne sait pas pourquoi on lit, on se rend compte, après des années de lecture, que l’on ne finit pas de lire, ni d’ailleurs d’écrire. Comme on ne finit pas d’être un homme.
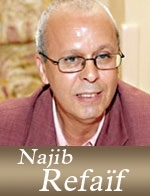
«Mais qui sera le maître, l’auteur ou le lecteur ?» écrit P.N Funbank dans une biographie consacrée à Diderot. Cette épigraphe mise en exergue par Alberto Manguel dès l’ouverture de son brillant ouvrage, Histoire de la lecture (Editions Actes Sud), est la question que l’on se pose lorsqu’on entretient des rapports passionnés avec les livres. Le même auteur parlant de sa passion pour la lecture, écrit dans l’introduction : «Chaque livre était un monde en soi, et je m’y réfugiais». C’est pour éclaircir ce mystère que cet auteur polyglotte et cosmopolite a entrepris l’écriture de cette histoire de la lecture devenue une référence en la matière. Et si l’on ne sait pas pourquoi on lit, on se rend compte, après des années de lecture, que l’on ne finit pas de lire, ni d’ailleurs d’écrire. Comme on ne finit pas d’être un homme. «Les rayons des livres que nous n’avons pas écrits, comme ceux des livres que nous n’avons pas lus, s’étendent dans les ténèbres, au fin fond de la bibliothèque universelle. Nous sommes toujours au début de la lettre A».
Né à Buenos-Aires, en Argentine, en 1948, Alberto Manguel, passionné de livres dès son jeune âge, avait trouvé un petit boulot à mi-temps dans une librairie, ce qui est un luxe pour une personne dans son cas. Dans son «histoire de la lecture» il raconte qu’il a eu la chance qu’un jour, le célèbre écrivain et poète argentin Jorge Luis Borges entrât dans la librairie pour chercher des livres en anglais qu’il ne trouvait pas ailleurs. Le poète argentin avait déjà perdu la vue et c’était sa mère qui lui faisait la lecture. Mais voilà qu’il demanda au jeune Manguel s’il pouvait trouver un moment dans la journée pour remplacer et reposer sa mère qui commençait à fatiguer. Avouez que pour un garçon qui rêvait de vivre parmi les livres, faire la lecture à l’immense Borges et l’un des plus grands lecteurs et érudits de sa génération, relevait de l’inespéré. C’est donc grâce à cette rencontre qu’il va découvrir, à la demande de Borges et dans l’ordre ou le désordre qu’il commandait, des auteurs qu’il n’aurait jamais pensé lire. De plus, le jeune Manguel profitait des commentaires que Borges ne cessait de faire pendant la lecture. Ce formidable exercice de lecture, faite à haute voix à un grand auteur frappé de cécité et commentant d’autres grands auteurs, a certes de quoi transformer la vie d’un jeune lecteur. «Je découvrais un texte en le lisant à haute voix, se souvient-il, tandis que Borges se servait de ses oreilles comme d’autres de leurs yeux pour parcourir la page à la recherche d’un mot, d’une phrase, d’un paragraphe confirmant un souvenir. Pendant que je lisais, il m’interrompait pour commenter le texte afin (je crois) d’en prendre note mentalement».
Le livre de Manguel, cité ci-dessus, n’est pas un ouvrage de souvenirs et d’anecdotes, ni les mémoires d’un grand lecteur. C’est avant tout un essai des plus sérieux, riche, illustré et documenté, sur l’une des plus belles passions humaines depuis l’origine de l’écriture: la lecture. Car les deux sont liés et l’on ne peut lire (ou se faire lire comme c’est le cas de Borges à la fin de sa vie), que si d’autres ont écrit. Divisé en deux grandes parties portant des titres qui résument parfaitement le propos, «Faits de lecture» et «Pouvoir du lecteur», l’ouvrage remonte l’histoire et l’autorité de la chose écrite depuis les premières tablettes d’argile du quatrième millénaire et considéré comme les plus anciens spécimens d’écriture connus jusqu’ici.
Loin d’être un ouvrage aride destiné aux spécialistes, l’Histoire de la lecture est certes un livre savant, mais il se lit avec plaisir lorsqu’on est curieux du mystère de la lecture. De plus, Manguel raconte une histoire de lecture comme un récit d’aventure, avec ses rebondissements, ses fausses intrigues et ses moments de répit, le tout illustré par des exemples et des citations des auteurs connus ou moins connus qui ont composé cette bibliothèque universelle dont rêve tout grand lecteur.
A la fin de cette belle Histoire de la lecture, Alberto Manguel raconte, non sans malice, son livre avant même sa sortie, imagine sa forme et sa texture : c’est un livre qu’il n’a pas encore écrit et qu’il n’a pas encore lu.
«Le fait qu’un livre n’existe pas (ou n’existe pas encore) n’est pas une raison de l’ignorer, pas plus que nous n’ignorions un livre dont le sujet est imaginaire. Il y a des volumes consacrés à la licorne, à l’Atlantide, à l’égalité des sexes, à la couleur des yeux d’Emma Bovary. Mais l’histoire que raconte ce livre a été particulièrement difficile à saisir; elle est faite, si l’on peut dire, de ses digressions».
