Idées
Le prix de l’habitat insalubre
Les réhabilitations de l’habitat dégradé dans les quartiers anciens n’ont pas encore fait l’objet d’interventions à grande échelle. L’urgence des besoins a été rappelée encore récemment par les dramatiques conséquences de l’habitat menaçant ruine.
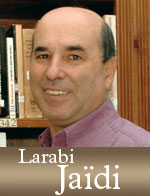
Disons-le sans détour, ne dissimulons pas notre satisfaction ! Celle de voir le Maroc primé au sixième Forum urbain mondial de Naples, organisé par le Programme des Nations unies pour les établissements humains ONU-Habitat. Un prix d’honneur avait déjà été décerné au Maroc, en 2010, pour son engagement en faveur de l’amélioration des conditions d’habitat des populations urbaines vulnérables. Le prix, partagé avec cinq autres pays, récompensait le programme Villes sans bidonvilles (VSB). La même année, Cities Alliance et ONU-Habitat ont classé le Maroc à la deuxième place du Top 20 des pays œuvrant à la résorption des bidonvilles, après l’Indonésie. Voir le pays en tête d’un classement international n’est pas chose habituelle. Quand il s’agit de lutte contre l’habitat insalubre, notre ego national est encore plus flatté.
Mais sachons raison garder. Ces classements internationaux, c’est comme l’auberge espagnole, on y trouve des plats et des ingrédients pour tous les goûts. Les benchmark et les «best practices» sont des exercices complexes, parfois contradictoires et souvent controversés. Le programme VSB qui a valu au Maroc d’être cité en référence n’échappe pas à la critique. Sa performance quantitative reste entachée d’une grande insuffisance : Casablanca, le plus grand bidonville du pays, ne fait pas partie du programme. Ses objectifs et modalités ont souffert de maintes contraintes et moult résistances. Ses bailleurs de fonds internationaux ont relevé le faible engagement de parties prenantes importantes à la réalisation de ses objectifs.
Le programme devait ériger l’accompagnement social et la participation des populations en démarche essentielle de sa mise en œuvre. Aucune de ces innovations n’a été appliquée dans la préparation et la gestion des opérations de résorption. Les projets mis en place se sont appuyés sur des interventions techniques et urbanistiques standards. L’exécution des travaux de construction a fini par devenir la mesure globale de la réussite du programme.
En fait, l’objectif de résorption de cette forme d’habitat et son éradication ne date pas de la conception de ce programme. Elle a été élevée au rang de «symbole de la dignité» nationale retrouvée au lendemain de l’indépendance. Malgré une palette riche en modes d’intervention en vue de la résorption des bidonvilles qui a permis d’atteindre – ponctuellement – certains résultats, la problématique des bidonvilles persiste tant en étendue qu’en complexité de résorption, notamment dans les grandes villes. Par ailleurs, les projets intégrés de restructuration des quartiers clandestins sont loin de couvrir l’ensemble du stock d’habitat clandestin, et posent des problèmes de financement du fait de l’insuffisante implication des municipalités et des régies, et du faible recouvrement des coûts auprès des bénéficiaires. Les réhabilitations de l’habitat dégradé dans les quartiers anciens n’ont pas encore fait l’objet d’interventions à grande échelle. L’urgence des besoins a été rappelée encore récemment par les dramatiques conséquences de l’habitat menaçant ruine. Les causes des limites de ces déficiences ont été identifiées par maintes études d’évaluation : programmation et gestion technico-financière des projets; insuffisance de la maîtrise du foncier ; problèmes de financement de l’auto-construction de logements; difficultés de l’évacuation des sites anciens et l’installation de nouveaux ; rejet des solutions par les bénéficiaires… L’Etat et les institutions en charge du secteur se trouvent constamment obligés de composer avec une hausse en flèche des coûts et des besoins de plus en plus complexes, et tenter d’établir un juste équilibre entre les attentes du public et leurs responsabilités et contraintes financières.
Les classements, les prix internationaux de l’ONU-Habitat visent habituellement à attirer l’attention sur le rendement de la politique de lutte contre l’habitat insalubre, sur l’efficacité des programmes et sur la qualité des projets. Même si ces distinctions et récompenses captent notre attention, à quelle aune faut-il les apprécier ? Quelles questions se posent les Marocains quand ils prennent connaissance du classement international de la politique d’habitat insalubre de leur pays ou des programmes qu’elle met en œuvre ? Quels aspects de cette politique sont pris en compte ? A quel point les indicateurs utilisés pour quantifier ces aspects, les programmes et prestations sont-ils valides et significatifs ? Les indicateurs de classement sont-ils basés sur des données exactes, fiables et comparables ? Les réponses à ces questions sont fondamentales autant pour le public que pour les décideurs. Elles sont incontournables pour apprécier à sa juste valeur la pertinence des classements en matière de politique de lutte contre l’habitat insalubre. Le «benchmarking» ne peut pas se substituer à l’analyse, il lui est complémentaire.
