Idées
Le présent et l’avenir de nos villes
Nos villes doivent trouver de nouvelles démarches de gestion stratégique prenant en compte la complexité et la diversification des régulations urbaines.
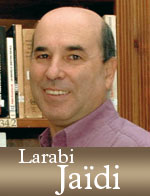
Près de 3 000 participants de plus de 100 pays se sont réunis à Rabat pour assister aux débats du Sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux et du 4e Congrès de cités et gouvernements locaux unis (CGLU) autour du thème : «Imaginer la société, construire la démocratie». Un événement d’une grande portée internationale car c’est principalement dans les villes que se jouera l’avenir de l’humanité. Depuis 2008, la moitié de l’humanité vit dans des villes. A l’échelle mondiale, l’urbanisation se développera encore au cours des prochaines décennies pour atteindre 70% d’ici 2050. Chaque année, c’est l’équivalent de sept villes de la taille de New York qui font leur apparition sur la planète. Les fractures sociales, les ségrégations territoriales et la prise en compte des changements climatiques sont des enjeux urbains. Mais les villes sont aussi la source d’innovations, le lieu de nouvelles solidarités ; elles sont le terrain d’expérimentation des réseaux intelligents et des nouvelles formes de gouvernance.
Les villes intelligentes sont un des grands thèmes au programme du sommet. On se prend à rêver de ces villes intelligentes, ces smart cities où la technologie aura un impact positif sur l’environnement, les services publics et la qualité de vie de ses habitants, des villes dans lesquelles tous les bâtiments seraient reliés à un réseau de puissants fibres optiques qui permettrait à chaque maison et à chaque commerce d’avoir son propre système de téléprésence pour communiquer par vidéo, consulter son médecin, participer à une réunion de travail ou s’entretenir avec l’enseignant des enfants sans jamais quitter la maison. Les rues seraient quant à elles équipées de capteurs qui permettraient à tous les citoyens de connaître le niveau de pollution, l’état de la circulation routière et les temps de déplacement… Ces cités qui semblent tout droit sorties d’un roman d’Isaac Asimov sont effectivement en construction un peu partout dans le monde (Songdo en Corée du Sud, Dubuque dans l’Iowa)…
Mais arrêtons de rêver. Les tendances et l’ampleur du phénomène urbain sont inégales selon les régions du monde. Dans les métropoles des pays du Sud, nous assistons à une urbanisation informelle des périphéries. L’explosion urbaine pose de nombreux problèmes sociaux et environnementaux : accès difficile au sol et au logement, déficience des services de base, pauvreté et ségrégation résidentielle, violences sociales, conditions de travail précaires, transports publics insuffisants. Face à ce sombre tableau de «ville impossible», la résolution des problèmes urbains appelle à l’émergence d’une nouvelle forme de gestion urbaine. Le Maroc est aussi concerné par ce défi.
La ville constitue depuis quelques années l’espace de vie de la majorité des Marocains. Elle est à la fois le centre névralgique de la création de richesses et le cœur de toutes les fragilités sociales. Elle est l’espace de proximité de la vie quotidienne et la clé de l’accès à l’économie mondialisée. Son développement est à l’origine de problèmes nouveaux. L’espace urbain est éclaté et dispose de transports inadaptés aux besoins de la mobilité humaine et de la distribution du fret. L’étalement urbain autour des métropoles est mal contrôlé.
Il est à l’origine de consommation d’espace, de congestion urbaine et de nuisances et de coûts supplémentaires pour les services publics et les réseaux (collecte des déchets, assainissement,…). La métropolisation génère des ségrégations sociales nouvelles et porteuses de risques d’éclatement de plus en plus violents. Nos villes subissent le poids d’une tutelle administrative et financière pesante qui étouffe leur aspiration à l’autonomie relative. Elles souffrent de la fabrication d’une élite défaillante, trop versée dans la soumission à l’autorité ou l’entretien d’un clientélisme populiste et corporatiste. Nos villes refusent de s’organiser entre elles et de conjuguer leurs atouts pour assurer une répartition optimale des infrastructures et services. Certes, la politique urbaine a tenté de réduire l’ampleur de ces problèmes à travers des actions réparatrices (programme «Villes sans bidonvilles», programme de mise à niveau des villes…), anticipatrices (villes nouvelles) ou de projets structurants de grande envergure (Tanger, Rabat, Casablanca). Mais ces interventions sont le plus souvent conduites de façon sectorielle, sans coordination et selon une approche centralisée.
Les grands projets urbains sont souvent réalisés par le recours à une dérogation ou une procédure d’exception et au contournement du droit commun. Ils sécrètent une exacerbation des tensions entre les élus et les agences ou entités intervenantes.
En définitive, la gouvernance urbaine actuelle appelle une remise en cause du modèle de la politique urbaine traditionnelle qui confie à l’autorité locale le contrôle de la gestion de la ville. De nouveaux modes de l’action publique restent à inventer. Tout d’abord, créer les conditions d’une démocratie locale participative. Il s’agit de parvenir à établir une véritable relation de confiance avec les habitants afin de rapprocher la décision du citoyen. Ensuite, améliorer le partenariat entre les pouvoirs publics et le secteur privé. L’enjeu est de parvenir à concilier la logique des élus et celle des chefs d’entreprises, qui n’ont ni les mêmes intérêts ni les mêmes horizons. L’autre enjeu est de parvenir à concilier les priorités nationales et les initiatives locales et à trouver une nouvelle articulation entre les politiques menées à différents échelons.
Nos villes doivent trouver de nouvelles démarches de gestion stratégique prenant en compte la complexité et la diversification des régulations urbaines.
