Idées
Le Maroc est-il un pays émergent ?
Comparativement à d’autres pays de sa gamme, le marché financier du Maroc ne dispose pas d’une surface attractive et ses entreprises ne sont pas des foudres de guerre sur les marchés internationaux.
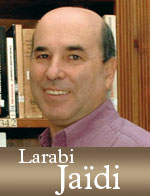
Le Maroc est-il un pays émergent ? La question peut paraître saugrenue. Il y a déjà presque deux décades que des jeunes du monde de la recherche académique française, fraîchement moulus, qualifiaient le Maroc de dragon de l’Afrique du Nord. Fascinés, par la découverte d’un pays en mouvement, ils y retrouvaient les attributs d’une économie dynamique, performante, empruntant le sentier irréversible du progrès. Plus récemment, des organismes internationaux et non des moindres, des agences de notation, des grands cabinets de consultants décernaient à cet élève modèle, discipliné et studieux le satisfecit d’un pays émergent. Quid de ce concept et de la réalité qu’il est censé révéler ?
C’est en 1981 que le terme «marché émergent» a été forgé par un spécialiste des marchés financiers. Cherchant à attirer des investissements sur les marchés des pays en développement, il a compris que l’image véhiculée par le «Tiers-monde» était trop négative. Il lui substitua l’expression «marché émergent» davantage associé au progrès et au dynamisme. La notion d’«économie à marché émergent» a été par la suite consacrée par des organismes financiers internationaux pour caractériser des pays en transition rapide, en cours d’industrialisation, enregistrant des taux de croissance élevés et présentant des opportunités de placement. Sur cette impression générale, le Maroc serait un pays émergent, comme tant d’autres contrées de la planète. En fait, la notion de «pays émergents» ne correspond à aucune définition économique précise ; leur liste varie selon les périodes et les auteurs qui se risquent à les désigner.
Le lancement du processus d’émergence remonte aux années 1970 avec la naissance des quatre nouveaux pays industrialisés (NPI) d’Asie surnommés «dragons» : Hong-Kong, Taïwan, Corée du Sud et Singapour. Ensuite, à l’orée des années 90, apparaît un second groupe appelé «bébés dragons» ou «bébés tigres» comprenant la Malaisie, la Thaïlande, l’Indonésie et les Philippines. A la même époque le Brésil et le Mexique se sont vu attribuer le qualificatif de «jaguars» latino-américains. Le processus d’émergence connaîtra une nouvelle dimension avec le vaste mouvement de transition vers l’économie de marché des pays d’Europe centrale et orientale et de la nouvelle Russie. Enfin, le processus sera consacré, dans les années 2000, par la croissance spectaculaire de pays géants, ce qui a conduit la banque américaine Goldman Sachs à créer l’acronyme «BRIC» devenu par la suite BRICSAM pour Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et Mexique. Ces conquistadors de la mondialisation ne sont pas seulement des pays en développement à fort taux de croissance. Ce qui les distingue, c’est leurs poids économique et leur trajectoire, qui leur permettent désormais de se mesurer aux pays développés les plus influents.
Quoi de commun en effet entre le Maroc, la Chine et la Turquie, entre l’Inde et le Mexique ou bien entre le Brésil et la Hongrie… ? Selon les acteurs concernés, la définition d’économie, de marché ou de pays émergent varie et les critères diffèrent. Pour les organismes financiers spécialisés les marchés émergents sont définis par la capitalisation boursière, le PIB par habitant, la taille du marché et ses entreprises, le degré de liquidité de l’économie et le niveau de la corruption. D’autres institutions retiennent pour sa définition la bonne tenue des agrégats macro-économiques, des taux de croissance supérieurs à la moyenne mondiale et à celle des pays les plus riches, une diversification des exportations sur les marchés des pays industrialisés, et l’adoption de politiques favorisant l’ouverture commerciale et financière. Le Maroc réunit quelques-uns de ces critères mais, comparativement à d’autres pays de sa gamme, son marché financier ne dispose pas d’une surface attractive et ses entreprises ne sont pas des foudres de guerre sur les marchés internationaux. Le club des pays dits émergents n’est pas fermé. On prévoit, d’ores et déjà, que l’Indonésie dotée d’une industrie et reprenant le modèle est-asiatique a l’un des potentiels le plus prometteur de cette catégorie. Le Nigéria, géant démographique, est fort de sa manne pétrolière et de sa présence sur la scène diplomatique africaine. Les Philippines jouent du bas coût de leur main-d’œuvre et brillent par la recherche agronomique. Le Vietnam s’ouvre et s’intègre à l’Asean, ce qui lui permet de développer ses exportations et d’attirer les investisseurs internationaux. La nouvelle vague des candidats du futur proche est encore moins homogène mais elle partage des caractéristiques communes : une population jeune et formée, des classes moyennes en expansion, des réformes économiques et institutionnelles en progression continue. Le Maroc fera-t-il partie de cette nouvelle fournée ? C’est en 2007 qu’un rapport du FMI sur le Moyen-Orient et l’Asie centrale reconnaissait pour la première fois au Maroc le statut de «pays émergent» au même titre que d’autres pays de la région tels que l’Egypte, la Jordanie, le Liban, le Pakistan et la Tunisie… On pouvait lire dans ce même rapport les défis que le Maroc et ces pays devaient relever rapidement : «L’assainissement des finances publiques demeure une priorité dans les pays à marché émergent. Les déficits budgétaires de plusieurs de ces pays restent élevés, ce qui ne permet pas de réduire suffisamment la dette. La poursuite de la mise en œuvre de mesures visant à élargir l’assiette fiscale, améliorer l’administration de l’impôt et réduire les subventions permettrait de limiter les déficits tout en dégageant la marge de manœuvre nécessaire au financement de programmes bien ciblés de lutte contre la pauvreté».
