Idées
Le développement durable, réalité ou utopie ?
Du fait de son mode de développement actuel, l’humanité est pour ainsi dire prise dans un étau, entre les exigences de la croissance économique en quête d’une consommation évolutive vaille que vaille et la dégradation de l’environnement sous les mêmes effets d’utilisation irrationnelle des ressources naturelles et de pollution montante.
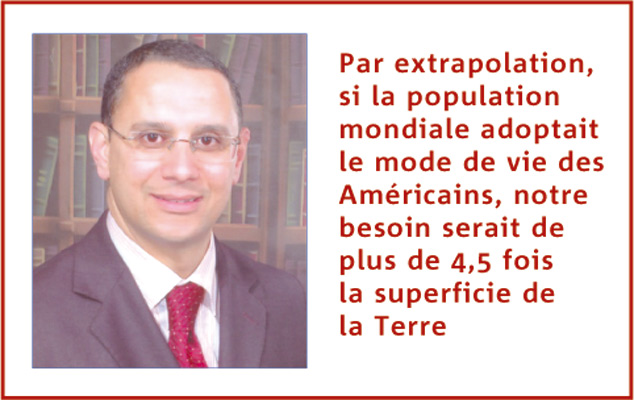
Bien avant la publication en 1987 par la commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’ONU de son fameux rapport Brundtland, auquel l’on attribue la genèse même du développement durable, en 1972 une institution rassemblant des scientifiques et des économistes, le Club de Rome en l’occurrence, avait tiré la sonnette d’alarme sur les effets néfastes de la croissance économique et démographique dans son rapport de Meadows, connu sous le nom célèbre de «Halte à la croissance».
Cette mise en garde exprimée au début des années soixante-dix est intervenue en période des trente glorieuses, durant lesquelles l’économie mondiale a enregistré des niveaux de croissance sans précédent. Des niveaux de croissance certes inégalés, mais biaisés par une dégradation écologique aiguë et une exténuation inquiétante des ressources naturelles non renouvelables ou caractérisées par un long processus de régénération.
Plus tranchant que l’adoption d’un mode de développement responsable répondant «aux besoins du présent sans compromettre les capacités pour les générations futures de satisfaire les leurs» et qui est prôné par le rapport de Brundtland, le rapport de Meadows, défendait fondamentalement une logique de croissance zéro, une sorte de «néo-malthusianisme» condamnant avec virulence toute croissance, économique soit-elle ou démographique. Malgré toutes les bonnes volontés des zélateurs du développement durable, nonobstant le bien-fondé des décisions, demeurant hélas lettre morte, émanant des différentes Conférences des parties (COP), force est de constater que la dégradation écologique se poursuit d’année en année, manifestée principalement par le volume croissant de gaz à effet de serre lâchés dans l’atmosphère, avec les conséquences que l’on connaît et que l’on vit de plus en plus, de réchauffement climatique et de récurrence des phénomènes climatiques extrêmes. Du fait de son mode de développement actuel, l’humanité est pour ainsi dire prise comme dans un étau, entre les exigences de la croissance économique en quête d’une consommation évolutive vaille que vaille et la dégradation de l’environnement sous les mêmes effets d’utilisation irrationnelle des ressources naturelles et de pollution montante.
Les informations qui nous parviennent à fréquence soutenue sur les températures enregistrées dans des régions connues par leur climat tempéré, le rapport effarant de l’Inserm de 2007, mentionnant le nombre de 70 000 morts en Europe à cause de la canicule, donnent des sueurs froides. En 2019, de nouvelles inondations ont été enregistrées dans des zones arides et de nombreux records de pic de chaleur sont tombés dans plusieurs villes autour de la mare nostrum et au-delà.
La grande problématique réside dans la délicate conciliation entre l’économique, naturellement axé sur une échelle temporelle courtermiste, et l’écologique qui s’inscrit dans une logique de temps à long terme. En effet, tandis que la sphère économique est motivée par des résultats immédiats et une valeur boursière suivie à la minute, au niveau écologique les actions d’aujourd’hui n’auront d’effet que plusieurs décennies plus tard. «À long terme, nous serons morts», pour reprendre une expression célèbre de l’économiste Maynard Keynes et qui continue de trouver tout son sens dans les politiques économiques de nos jours, qui au mieux prétendent se soucier de la nature, alors que leur frénésie première demeure lucrative, axée sur la création de richesse, quel qu’en soit le prix.
L’empreinte écologique, qui est définie comme étant l’espace nécessaire à chaque individu pour l’autocorrection des effets négatifs qu’il inflige à la Terre, enregistre à présent un déficit grave et marque une destruction continue du capital naturel de l’humanité.
En effet, l’empreinte écologique moyenne est de 2,8 hectares par individu, alors que la bio-capacité de la terre n’est que de 1,7 hectare par personne. Évidemment, ceci est une moyenne trompeuse qui occulte la différence entre pays. L’empreinte écologique d’un Américain est de 8 hectares, alors que celle d’un Indien est à peine d’un hectare. «Le mode de vie des Américains n’est pas négociable», dixit George W. Bush, argument aujourd’hui d’actualité plus que jamais. Par extrapolation, si la population mondiale adoptait le mode de vie des Américains, notre besoin serait de plus de 4,5 fois la superficie de la Terre.
Tout cela laisse conclure qu’il n’est pas suffisant d’adopter un comportement durable, d’opter pour un mode de développement écologique pour sauver la Terre. Il faut faire beaucoup plus, il faut bannir toute consommation à externalité polluante et renouer des liens amicaux avec la nature à l’image de nos ancêtres. Il faut accepter de renoncer à notre confort total et à notre mode de vie actuel, si nous sommes véritablement conscients que la Terre ne peut plus répondre à tous nos besoins, d’aujourd’hui et de demain.
L’esprit du Club de Rome est bien là, exprimé depuis près d’une cinquantaine d’années. Il ne s’agit donc plus de consommer rationnellement et intelligemment, mais de s’abstenir à toute consommation superflue de quelque nature qu’elle soit, tant qu’elle porte préjudice à la Terre. Le concept de «développement durable», montrant ainsi ses limites, est brusquement évincé par une idéologie plus engageante de «décroissance soutenable».
Ces principes péremptoires, formulés par des scientifiques, semblent être inadaptés à la réalité et à la vraie vie. Comment pourrait-on concevoir une société qui renonce à toute action de développement ? Comment pourrait-on convaincre une entreprise d’arrêter ses activités pour l’unique raison que sa production nuit à la nature, même si elle répond à un besoin réel ? Que seraient les conséquences d’une telle action? Comment convaincre le citoyen lambda de renoncer ex abrupto aux différentes facilités que lui offre la vie d’aujourd’hui, juste parce que demain est incertain ?
Il est évident que les actions de dépollution visant à réparer les méfaits anthropiques infligés à la nature ; que l’adoption par quelques entreprises de nouveaux procédés de production propres, sous l’impulsion essentielle de gains en productivité; que la monétarisation des biens communs destinée à endiguer leur dilapidation, selon les principes de «pollueur-payeur» et de «préleveur-payeur», ne peuvent avoir d’effet tangible tant qu’elles ne sont pas appliquées à une échelle mondiale, partout et par tous. D’ailleurs, même si c’était le cas, ce qui semble utopique, leur effet sur la nature ne serait visible que plusieurs dizaines d’années plus tard. En effet, les scientifiques nous remettent de nos rêveries et relativisent drastiquement les effets positifs des actions écologiques entreprises par-ci par-là, en précisant qu’une tonne de CO2 séjourne dans l’atmosphère pour cent ans au moins. Les conséquences d’un éco-geste donné, entrepris aujourd’hui à une échelle mondiale, ne seront visibles que plusieurs décennies plus tard.
Dans ce même contexte, un point de vue divergent défend l’idée que nous sommes incapables de prédire scientifiquement le futur. Nous n’avons aucune visibilité sur l’hypothétique efficacité des politiques environnementales aussi pragmatiques qu’elles puissent être. Ces politiques pourraient même avoir des conclusions antinomiques du fait qu’elles tentent de dévier le cours naturel des choses. L’Administration américaine récente, fidèle à son climato-scepticisme et à ses positions prenant à contre-pied les préconisations mondiales de lutte contre le réchauffement climatique, croit dur comme fer que l’utilisation ou pas d’énergies fossiles, principale cause d’émission de gaz à effet de serre, ne peut rien changer à une évolution en marche de l’atmosphère terrestre. Bon nombre de climatologues corroborent cette position en attestant que la Terre a connu de par le passé des cycles de réchauffement suivis de cycles de refroidissement climatiques de façon redondante et tout à fait naturelle. Quoique l’être humain puisse faire, il ne pourra pas infléchir ces phénomènes. La Terre, à chaque fois de sa longue histoire, a su s’en remettre sans aucune intervention humaine. Est-ce que ce discours est radicalement réfutable, est-ce que ce discours est suffisamment fondé pour y croire ?
Abdelhanine Lahlou, Responsable pédagogique université CDM
