Idées
Le défi de la coopération interentreprises
Face au défi que représente la mondialisation des échanges et de la production pour les PME d’un pays de petite dimension, comme le Maroc, le renforcement de la coopération entre entreprises apparaît comme un des moyens permettant aux PME locales de tirer le meilleur parti de l’ouverture extérieure
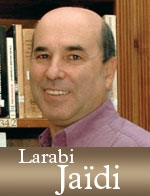
Il est évident que la compétitivité de notre industrie dépend non seulement de l’accélération d’une politique industrielle suffisamment volontariste pour valoriser nos atouts et compenser nos faiblesses structurelles mais aussi de la capacité à promouvoir et diffuser les multiples formes de coopération interentreprises par des réseaux constitués à cet effet. L’atout que représentent ces réseaux au maillage très dense est partout donné en exemple (notamment au Japon et en Allemagne). Parce qu’elles ne sont pas également armées pour bénéficier de l’ouverture sur l’extérieur, une stratégie spécifique aux PME devrait être définie. Elle devrait s’appuyer sur les actions de consortium, de sous-traitance ou d’autres modes de coopération. Ces actions combinées aux mesures de soutien des pouvoirs publics devraient tendre à mettre nos petites et moyennes entreprises en situation de gagner et de pérenniser des marchés à l’exportation. Les systèmes ou consortium d’exportation en commun sont particulièrement intéressants pour les PME aux ressources limitées. Une association de sociétés qui conjuguent leurs efforts d’exportation présente des avantages multiples. Les avantages de la taille permettent aux PME associées de mettre en commun des ressources et d’entreprendre des opérations qui leur seraient interdites si elles restaient seules. Ensemble, elles seraient en mesure de s’imposer sur de nouveaux marchés ou de tirer un meilleur parti du potentiel de leurs marchés existants. L’augmentation de la quantité de produits disponibles pour l’exportation permettra à ces groupements de fournir un marché de grande taille auquel la petite production de chaque associé pris individuellement n’accède pas. Elle lui permettra, en outre, d’obtenir des rabais de quantité sur les tarifs des transporteurs, les matériaux d’emballage, etc. Enfin, l’autre avantage serait l’amélioration de la communication et de la coopération entre les pouvoirs publics et la branche considérée. Il est plus facile pour l’Administration d’aider des sociétés qui s’associent au sein d’un groupe d’exportation en commun.
La sous-traitance est une méthode de gestion appliquée dans tous les pays industrialisés. Le développement de la sous-traitance repose sur des avantages indéniables qui l’emportent nettement sur les inconvénients. Il faut bien distinguer entre la sous-traitance conjoncturelle ou de capacité et la sous-traitance structurelle ou de spécialisation. La seconde donne naissance à une répartition du travail efficace, à caractère permanent et dans la complémentarité entre les deux parties. En revanche, la première n’est que sporadique, occasionnelle. Le donneur d’ordre peut fabriquer lui-même le produit, mais s’adresser néanmoins à une autre entreprise parce que son appareil de production est provisoirement saturé ou parce qu’il est aux prises avec un défaut technique. Dans la pratique la petite entreprise est souvent preneur et la grande entreprise donneur d’ouvrages. Les petites et moyennes entreprises répondent en effet le mieux aux critères classiques d’une entreprise de sous-traitance, et cela en raison de leur spécialisation, de leur souplesse d’adaptation et de leur marge de compétitivité en général. La sous-traitance est courante dans les secteurs où la demande est sujette à de vives fluctuations. Les dirigeants des PME sous-traitantes évoquent souvent les contraintes imposées par les donneurs d’ordre. On attend d’eux qu’ils fournissent des produits conformes à des exigences draconiennes. Des malentendus sur les critères d’appréciation du contrat exposent les deux parties à des conflits. Il est possible d’éviter de nombreuses difficultés en mettant en place des accords de coopération suffisamment explicites et qui privilégient la co-traitance à la sous-traitance.
Les pouvoirs publics ont un rôle important à jouer dans la promotion de la coopération entre les entreprises nationales. Ils peuvent contribuer à cet objectif dans différents domaines. Tout d’abord dans l’incitation à l’innovation, en encourageant les PME à s’investir dans des programmes de coopération. Ensuite dans la réglementation de la concurrence : les PME ont un rôle majeur dans la création d’un environnement économique de saine concurrence, mais il faut tenir compte de leur spécificité en autorisant des dérogations aux règles prévues dans le projet de réforme de loi sur la concurrence en faveur d’accords d’importance mineure, de sous-traitance, de coopération technique, commerciale ou financière.
Face au défi que représente la mondialisation des échanges et de la production pour les PME d’un pays de petite dimension, comme le Maroc, le renforcement de la coopération entre entreprises apparaît comme un des moyens permettant aux PME locales de tirer le meilleur parti de l’ouverture extérieure. Il faudrait surtout construire les modes d’agir en collectif. Les nouvelles approches dessinées par le rapport de la CGEM sur la compétitivité des entreprises industrielles ouvrent des perspectives dans cette direction. Auront-elles un écho suffisant auprès des destinataires ? Seront-elles traduites par des leviers d’action pertinents ? C’est assurément un des défis qu’aura à lever la stratégie d’accélération industrielle.
