Idées
L’argent fossoyeur de la démocratie
Le « consensus politique » qui s’est dégagé au sein de la classe politique nationale en faveur d’une éthique de conduite, contre la corruption dans le financement des partis politiques et des campagnes électorales n’a jamais été respecté.
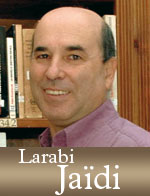
Dans toutes les démocraties, les citoyens se préoccupent aujourd’hui de plus en plus de l’influence que peut exercer l’argent sur la configuration de la représentation politique par le biais des moyens financiers mobilisés dans les campagnes électorales. Un peu partout dans le monde, le financement de ces campagnes a donné lieu à divers scandales. L’affaire Karachi est encore fraîche dans les mémoires. Dans certains pays, il a été établi que la criminalité organisée est fortement impliquée dans le financement des activités politiques. Chez nous, des scandales, dont les médias se sont largement fait l’écho, ont ouvert les yeux de l’opinion publique sur l’étendue du phénomène de la corruption dans les élections. De l’achat des voix à petites unités au financement mafieux par le biais de filières des narcotrafiquants ou de promoteurs immobiliers véreux, en passant par des transactions pour constituer les listes des partis, le registre de ces procédés est étendu et chaque fois renouvelé.
Les campagnes électorales constituent des moments forts et des points culminants de l’action politique. Les formes et les montants des ressources nécessaires au financement des activités qu’elles suscitent sont différents de ceux requis pour le fonctionnement courant des partis. C’est dans les périodes électorales que l’activité politique est la plus intense, les partis distribuant des tracts et des affiches, envoyant des courriers aux électeurs, diffusant à la radio et à la télévision des messages politiques, etc. Les progrès technologiques, l’utilisation de moyens de communication de masse et la professionnalisation des campagnes électorales, du fait d’un recours accru à des consultants et à des agences de relations publiques peuvent faire grimper de façon illimitée les coûts des campagnes. Des dépenses illimitées donnent un avantage aux partis ou candidats ayant un accès privilégié aux ressources financières. Elles risquent de rendre ceux qui occupent des fonctions électives tributaires de ceux qui les ont financés. En raison de l’effet de distorsion que l’argent peut avoir sur le processus démocratique, les campagnes électorales devraient donc être assujetties à un régime de financement différent de celui applicable aux activités normales du parti. Les partis devraient-ils recevoir un financement privé ? Comment donc prévenir le trafic d’influence et sanctionner les dons illicites ? L’Etat devrait-il imposer des limites aux dons effectués par des sociétés ou des parties tierces ? Les dépenses de campagnes devraient-elles être plafonnées ? Si les pays européens s’orientent vers une réglementation restrictive des dépenses des campagnes, cette pratique contraste avec celle, plus permissive, des Etats-Unis, où les dépenses par candidat ne sont pas limitées sous prétexte d’éviter toute entrave à la liberté d’expression. Ainsi, dans l’approche européenne on peut plafonner soit le montant total qu’un parti ou un candidat peut dépenser, soit celui qui est consacré à certaines activités. Il arrive que certaines formes de dépenses soient totalement interdites. Des pays déterminent à qui ce plafond de dépenses s’applique afin d’assurer l’efficacité du contrôle des dépenses. D’autres définissent précisément ce qui peut être comptabilisé comme une dépense électorale et ce qui ne le peut pas, et établissent une distinction nette entre les dépenses de campagne et les autres dépenses.
Le «consensus politique» qui s’est dégagé au sein de la classe politique nationale en faveur d’une éthique de conduite, contre la corruption dans le financement des partis politiques et des campagnes électorales, n’a jamais été respecté. La Charte d’honneur adoptée en 1996 est restée un document sans effet, ni suite. A quoi bon la renouveler si les dispositions de ce document sont jetées aux oubliettes alors que son encre n’est pas encore asséchée. Le plafonnement des dépenses ne serait-il pas le moyen adéquat pour éviter les dérapages, contrôler les inégalités entre les partis politiques, empêcher l’achat des suffrages et limiter l’influence de corruption ? En conséquence, ne faudrait-il pas adopter des dispositions législatives spéciales concernant les montants et les sources des dons privés admissibles, les plafonds de dépenses et les critères applicables aux aides publiques pour le financement des élections ? Les règles applicables au financement des campagnes électorales doivent reposer sur des principes clairs: équilibre entre financements publics et privés, critères équitables de répartition des contributions de l’Etat aux partis, règles strictes régissant les dons privés, plafonnement des dépenses des partis liées aux campagnes électorales, totale transparence des comptes, établissement d’un organisme indépendant de vérification des comptes et sanctions significatives à l’encontre des partis et des candidats qui violent les règles. Pourrait-on espérer que le prochain tour électoral soit préservé de ces pratiques scandaleuses qui sapent la perception des partis politiques en tant que piliers de la démocratie représentative ? A l’évidence, l’importance de règles claires et de comptes transparents sont nécessaires pour restaurer la confiance des citoyens dans la chose politique. Du chemin reste à parcourir pour rendre visible cette perspective.
