Idées
L’Amérique et le monde
Pour rebondir, l’Amérique doit retrouver confiance en elle-même et se convaincre de la perte d’efficacité de la force dans un monde polycentrique et pluriel.
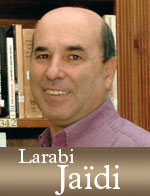
Il y a une constante dans l’histoire américaine: c’est l’idée que les Etats-Unis sont un pays exceptionnel, investi d’une mission de portée universelle qui peut prendre la forme d’un modèle de la Terre promise, ou celle d’une croisade pour la démocratie. A la suite de la dissolution de l’URSS, les Etats-Unis se sont retrouvés dans une configuration inédite d’«unipolarité», c’est-à-dire de suprématie mondiale incontestée. Leurs principaux concurrents s’étaient simultanément affaiblis : l’Europe, en raison du coût de la réunification, le Japon du fait d’une longue période de stagnation. Le résultat fut un excès de triomphalisme de «l’hyperpuissance» qui s’est mué en «néo-impérialisme». Aux lendemains du 11 Septembre 2001, la vision clintonienne de la mondialisation heureuse, où les Etats-Unis entraînaient le reste du monde dans la logique du marché et de la démocratie fut balayée par la vision sombre, manichéenne, de la globalisation, exprimée par Georges W.Bush. Celle d’une lutte à mort, s’étendant à tous les continents, entre le «Bien» incarné par l’Amérique et le «Mal», incarné par le «terrorisme islamique». Les Etats-Unis ont ainsi choisi une stratégie «hard», abandonnant les institutions multilatérales et le droit international et s’engageant dans une mobilisation militaire de grande ampleur, officialisée par la doctrine de guerre préventive.
L’élection de Barack Obama, le président le plus cosmopolite de l’histoire des Etats-Unis, fut saluée avec joie et espérance dans le monde entier. Il était en quelque sorte le candidat du monde et des Américains pour lesquels le monde importe. Il a bénéficié du large soutien des minorités issues des migrations récentes (hispanistes et Américains d’origine asiatique). Si on ne pouvait pas parler de «doctrine Obama» à propos de la politique étrangère, une certaine vision morale s’exprimait dans ses orientations générales en rupture avec les fondements idéologiques du néo-conservatisme et se déclinant dans la remise à l’ordre du jour du multilatéralisme et de la coopération internationale. Obama préconisait l’apaisement des relations tendues des Etats-Unis avec une partie importante du monde, particulièrement le monde musulman, mais aussi la Russie et la Chine.
Pour autant, peut-on dire que les relations des Etats-Unis avec le reste du monde ont changé sous la présidence d’Obama, que la politique étrangère a été moins «impériale» ? Obama a fait de beaux discours, il a mené une politique débarrassée des aspects caricaturaux du néo-conservatisme mais s’est révélé un homme de compromis plus qu’un homme d’action. Sa présidence aura été décevante sous quelques aspects : dépenses militaires élevées, utilisation de méthodes contestables dans le combat contre le terrorisme…Aujourd’hui, Obama estime avoir besoin d’un nouveau mandat pour liquider le pesant héritage de son prédécesseur. En parallèle, il se tourne vers l’avenir, en réorganisant les relations extérieures de son pays autour du Pacifique et de l’Atlantique Sud.
En effet, au Moyen-Orient, l’Amérique continue de vivre les contradictions qui minent son action dans cette région, notamment son soutien inconditionnel à l’Etat hébreu, son grand écart entre Israël et ses alliés arabes, sa dépendance réciproque avec l’Arabie Saoudite, ainsi que son soutien à la stabilité de régimes qui perpétuent la stagnation politique dans cette partie du globe et engendre l’antiaméricanisme. Ben Laden a été exécuté, mais partout, dans le monde arabo-musulman, les islamistes affirment leur présence. Aujourd’hui, l’administration d’Obama souhaite favoriser l’éclosion d’un islam modéré et libéral, capable de contrebalancer l’islamisme et d’intégrer les millions de musulmans au monde globalisé.
Mis au second plan par la guerre contre le terrorisme, les débats américains sur la Chine tiennent désormais la vedette et détrônent progressivement la Russie comme préoccupation centrale de la politique étrangère. Aujourd’hui, la République populaire de Chine, pays le plus peuplé du monde, et les Etats-Unis, pays le plus puissant, sont devenus des rivaux sur la scène mondiale. Leurs relations sont tendues, leurs intérêts sont contradictoires, et l’avenir semble plein de dangers. Les Chinois prennent des parts de marché dans le monde et alimentent les consommateurs américains. Les déséquilibres de la balance commerciale américaine sont dus pour l’essentiel aux échanges sino-américains. La dette de l’Etat fédéral est partiellement financée par la Chine, qui recycle ainsi une partie de ses excédents en bons du Trésor américain. L’idée fait son chemin que Pékin sera le «compétiteur» le plus dangereux de Washington, une fois son potentiel économique pleinement réalisé et son outil militaire modernisé, lui permettant ainsi d’affirmer toutes ses ambitions régionales.
La Chine devient un acteur international incontournable. La mondialisation de la fin du XXe siècle, impulsée par les Etats-Unis, a certes intégré la planète, mais elle a aussi conduit à une transformation qui met un terme au cycle pluricentenaire de primauté occidentale. Il y aura inévitablement redistribution de la puissance et les Etats-Unis, comme l’Europe, devront s’y adapter. Cela ne sera sans doute pas aisé. Les Etats-Unis resteront sans doute pour longtemps la puissance militaire dominante du monde mais ils découvrent qu’ils ne sont plus les maîtres du monde, ni même les maîtres chez eux. Les enjeux cruciaux que sont l’interdépendance, la compétition et la coopération dissimulent des défis internes tout aussi urgents auxquels fait face la société américaine : les inégalités, l’emploi, l’éducation, la santé… Ce sont les réponses données à ces problèmes qui détermineront l’avenir. Pour rebondir, l’Amérique doit retrouver confiance en elle-même et se convaincre de la perte d’efficacité de la force dans un monde polycentrique et pluriel.
