Idées
La renaissance de Keynes
Le défi du keynésianisme
de la radicalité
est de transformer
le discours analytique
en propositions opérationnelles.
En ces temps de crise,
il ne trouvera
de force pour devenir
une vraie pensée économique
que s’il aboutit à des
mesures concrètes qui
se révèlent efficaces…
et sans effets pervers.
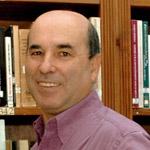
A parcourir la littérature économique récente sur les sorties de crise, on est frappé par l’hommage rendu à Keynes, à la pertinence de sa pensée, à ses prescriptions de politique économique en période de crise. A entendre le discours ambiant sur l’interventionnisme public et les nationalisations Lord John Maynard Keynes doit se retourner dans sa tombe. Se retrouverait-il vraiment dans tout ce qui se dit en son nom ? N’y-a-t-il pas en fait plusieurs Keynes ? Ou au moins deux. Un Keynes pragmatique et un Keynes radical ? Lequel d’entre eux est plus d’actualité ? Le premier, il est vrai, colle mieux au personnage : baronnet de Tilton (sur le tard, cependant, puisqu’il fut anobli en 1942), spéculateur avisé (encore qu’il ait commencé par perdre beaucoup d’argent sur les marchés financiers, au point qu’il dut largement puiser dans ses droits d’auteur des Conséquences économiques de la paix, paru en 1920 – plus de 200 000 exemplaires vendus -, pour payer ses dettes), administrateur de la Banque d’Angleterre, président de la commission qui imagina la Banque mondiale, mécène créateur d’un théâtre, on ne voit guère le plus célèbre économiste du XXe siècle dans la peau d’un révolutionnaire, le couteau entre les dents. D’ailleurs, il se disait lui-même solidaire de la «bourgeoisie éclairée» et avouait ne pouvoir «adopter une doctrine qui exalte le prolétariat crasseux au détriment de la bourgeoisie et de l’intelligentsia qui, en dépit de tous leurs défauts, sont la quintessence de l’humanité».
Ce Keynes pragmatique considérait que, dans une économie de marché, le chômage involontaire (c’est-à-dire touchant des personnes prêtes à travailler aux conditions offertes sur le marché) est la règle, et qu’aucun mécanisme automatique rééquilibrant ne s’exerce sur le marché pour éliminer ce sous-emploi. Il concevait l’économie à l’image d’une machine hydraulique à laquelle il faut injecter de la ressource publique pour relancer ses moteurs. Résumons la pensée du Maître : le niveau d’emploi dépend de la propension à consommer et du niveau d’investissement, lequel dépend des anticipations de profit et du niveau des taux d’intérêt, lequel enfin détermine le partage entre épargne placée et monnaie (donc la demande de monnaie). Rien ne dit que, spontanément, l’investissement va se fixer à un niveau tel que le plein-emploi soit atteint. Au contraire : en raison de la propension à épargner, il y a une forte probabilité pour que le système fonctionne en sous-emploi: «Un acte d’épargne individuelle signifie – pour ainsi dire – une décision de ne pas dîner aujourd’hui. Mais il n’implique pas nécessairement une décision de commander un dîner ou une paire de chaussures une semaine ou une année plus tard».
Ce Keynes pragmatique est mort, et bien mort : l’enterrement a eu lieu dans les années 70 et a été célébré par Milton Friedman (les monétaristes), Thomas Sargent (les nouveaux classiques), le FMI et bien d’autres. L’expérience, en effet, a montré que la machine économique ne répondait plus aux commandes du keynésianisme hydraulique, sinon par l’inflation. Pour la simple raison que nous sommes dans des économies de plus en plus ouvertes. Exit Keynes ? Pas du tout, répondent un certain nombre d’économistes : le Keynes radical, lui, est toujours vivant, et bien vivant. Il montre d’ailleurs le bout de son nez, et même un peu plus, dans la Théorie générale, qui contient quelques formules assassines dont l’auteur avait le secret. Ainsi, dans sa conclusion, il appelle de ses vœux la «disparition des rentiers», dont le revenu n’est justifié que par une rareté artificielle du capital, tout comme il souhaite un alourdissement important des droits de succession : «On peut justifier par des raisons sociales et psychologiques de notables inégalités de fortune, mais non des disproportions aussi marquées qu’à l’heure actuelle». Dans un autre passage célèbre, il dénonce le rôle nocif de la spéculation – «Lorsque, dans un pays, le développement du capital devient le sous-produit de l’activité d’un casino, il risque de s’accomplir en des conditions défectueuses» – et suggère la «création d’une lourde taxe d’Etat» sur les transactions financières. C’est donc davantage dans ce raisonnement qu’il faut aller chercher le Keynes radical. L’effondrement, par KO technique, des partisans du Keynes pragmatique laisse tout le champ à ceux du Keynes radical. Mais autant leurs analyses paraissent convaincantes, autant on ne voit pas encore sur quelles prescriptions elles débouchent. La force du keynésianisme était qu’il débouchait sur une politique économique précise et sur des modèles opérationnels. Mais c’est devenu aussi sa faiblesse, lorsque ces modèles se sont révélés inefficaces et générateurs d’effets pervers. Le défi du keynésianisme de la radicalité est de transformer le discours analytique en propositions opérationnelles. En ces temps de crise, il ne trouvera de force pour devenir une vraie pensée économique que s’il aboutit à des mesures concrètes qui se révèlent efficaces… et sans effets pervers.
