Idées
La poudrière du chômage des jeunes
si l’attente populaire est déçue, nous risquons de voir se perpétuer des mouvements de contestation qui, cette fois-ci, porteront de nouveaux extrémismes
ou de nouveaux populistes autoritaires au pouvoir.
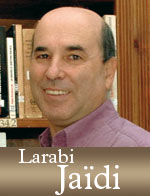
Les analyses qui se sont succédé pour expliquer le phénomène des révoltes dans les pays arabes sont restées bloquées sur le curseur exclusif de la démocratie. Or, la crise de l’emploi des jeunes est le facteur clé de rupture du tacite pacte social développement versus autoritarisme, qui caractérisait la Tunisie, l’Egypte, le Yémen et qui est encore le modèle dominant dans d’autres pays (Jordanie, Maroc, Syrie, etc.). Aujourd’hui, l’équation politique se présente ainsi : la crise a fait tomber les dirigeants répressifs, des réformes constitutionnelles vont ouvrir le champ démocratique et les nouveaux gouvernements vont être jugés par les citoyens à l’aune de leur capacité à créer des emplois et à donner de l’espoir à la jeunesse. Si l’attente populaire est déçue, nous risquons de voir se perpétuer des mouvements de contestation qui, cette fois-ci, porteront de nouveaux extrémismes ou de nouveaux populistes autoritaires au pouvoir. Et dans cette nouvelle configuration, la violence risque d’être au rendez-vous dans des proportions sans commune mesure avec celles connues en 2011.
Plus d’un tiers de la population totale et 47% de la population active ont aujourd’hui, dans les pays arabes, entre 15 et 30 ans. Actives au sens statique du terme, car les jeunes sont aujourd’hui les premières victimes du chômage. Les chiffres officiels sous-estiment sans doute le problème, mais le chômage des 15-24 ans oscille entre 20 et 25% dans la plupart des pays de la région. Il frappe, surtout, les diplômés de l’université. Selon la Banque mondiale, les pays arabes ont consacré sur la longue durée entre 5 et 6% de leur PIB au secteur éducatif contre 3% en moyenne dans des pays d’Amérique latine ou d’Asie orientale. Cet investissement s’est traduit par une amélioration considérable des taux d’alphabétisation, une scolarisation primaire et secondaire. L’accès à l’enseignement, notamment supérieur, a été perçu comme le sésame de l’insertion économique et sociale des jeunes. Mais la croissance du nombre de jeunes sortant des facultés, l’inadéquation des stratégies de développement et les crises économiques ont rendu la promesse de plus en plus théorique. Si on poursuit les tendances actuelles, sans dégradation, la situation relative de l’emploi, il faudrait créer 22,5 millions emplois d’ici 2020 et une croissance annuelle de plus de 8% en moyenne pendant 15 ans pour assurer un équilibre dans les marchés du travail. Autrement, ce sont 12 millions de chômeurs officiels supplémentaires qui ne se sentiront pas socialement intégrés dans cette région (avec une part importante de hauts diplômés).
Les politiques de l’emploi mises en œuvre dans le passé dans la région arabe ont été inefficientes. Rares sont les dispositifs de remise à niveau ou d’insertion dans l’emploi ciblés sur les jeunes qui se sont traduits pour eux par des gains réels en termes d’emplois ou de revenus. Mais ce bilan décevant n’est pas une raison pour renoncer. De nombreux pays d’égal niveau de développement en Amérique latine ou en Asie ne se sont manifestement pas laissés décourager par les résultats, jusqu’à présent décevants, obtenus par les programmes du marché du travail ciblés sur les jeunes. Des initiatives de vaste portée ont été lancées, récemment, dans plusieurs pays, qui énoncent généralement les droits et les obligations des jeunes. Les politiques publiques menées dans la région arabe gagneraient à s’en inspirer d’autant que certains dispositifs commencent à donner des résultats. Trois principes peuvent être retenus.
Primo, les programmes qui se sont révélés plus efficaces sont ceux qui ont été menés à l’échelle locale et en étroite liaison avec les employeurs. Les programmes qui ont pris en compte les pratiques d’embauche des employeurs locaux ou qui ont tenté délibérément de les infléchir, en incitant les employeurs à adhérer au programme ont été tout particulièrement efficaces. Secundo, les dispositifs qui ont le mieux marché sont aussi ceux qui ont su conjuguer de façon appropriée les études et les formations pratiques. Ces dispositifs ont couvert plusieurs aspects selon un dosage approprié.
Tertio, les dispositifs de formation les plus efficaces sont ceux qui sont attentifs aux méthodes pédagogiques employées, que l’enseignement soit dispensé en milieu scolaire ou en milieu professionnel. Seuls des enseignants et des formateurs bien préparés et motivés sont aptes à relever les défis pédagogiques que représentent ces dispositifs. Quarto, les dispositifs efficaces ont su recueillir des informations sur les résultats obtenus et exploiter ces informations pour essayer d’aller vers plus de qualité. Ce principe inspire les programmes de formation à l’emploi qui ont été mis en œuvre dans un certain nombre de pays, la mesure des performances étant reconnue comme un moyen de suivre et de renforcer l’efficacité. Tels sont les grands principes qui devraient inspirer les dispositifs dont l’objectif est d’aider les jeunes à s’insérer activement dans les marchés du travail des pays arabes. Ce ne sont certainement pas les seuls facteurs à prendre en compte, mais ils sont essentiels à la mise en œuvre de programmes efficaces. Les «révoltes» dans le monde arabe ne sont que les prémices d’un malaise beaucoup plus profond d’une jeunesse sans perspectives mais qui, désormais, a décidé de revendiquer ses droits. Empêcher la poursuite ou la recrudescence de la violence sociale dans le monde arabe, c’est faire la guerre au chômage des jeunes par une politique intensive de développement.

