Idées
La nouvelle utopie du Maghreb
Le processus d’intégration
ne réussira que s’il parvient
à mobiliser non seulement
les décideurs politiques
mais aussi tous les acteurs
de la société civile.
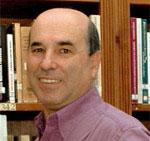
Il y a vingt ans naquit l’UMA. Un enfantement dans l’espoir de voir cette région du monde tourner le dos à ses crispations nationalitaires, à se doter comme beaucoup d’espaces régionaux des embryons institutionnels qui la protégerait des appétits voraces d’une mondialisation galopante. L’UMA a franchi l’âge de l’adolescence, elle n’a pas pour autant atteint le stade de la maturité. Le Maghreb est toujours une espérance politique déçue. Il ne se retrouve ni dans les discours de ses dirigeants, ni dans les stratégies partenariales des grandes puissances, ni dans les bilans statistiques des performances des Nations. Tout au plus reste-il fragilement suspendu à l’espoir de ses citoyens. Si les populations considèrent toujours ce projet d’un œil favorable, il est désormais ressenti comme une utopie faiblement mobilisatrice. De surcroît, en l’absence d’éléments forts d’une nouvelle identité collective, le Maghreb est inévitablement associé à l’effritement des repères nationaux provoqué par la mondialisation de l’économie. Il en résulte des incertitudes et des inquiétudes qui fragilisent une adhésion vouée d’ailleurs souvent à une idée globale plus qu’à une compréhension raisonnée des réalités qui l’accompagnent.
C’est une idée commune de répéter que l’obstacle à la création d’un ensemble maghrébin unifié trouve son origine dans le différent algéro-marocain sur le Sahara. Un conflit qui empoisonne, certes, les relations maghrébines mais qui ne se condense pas toutes les ambivalences d’un projet d’union. Qu’il trouve sa résolution, le chemin d’un Maghreb uni ne sera pas pour autant jonché de fleurs. L’ensemble des pays qui le composent, de la Libye à la Mauritanie, constituent un espace en mutation : cinq nations bien différenciées, aux nuances politiques marquées et aux fractures sociales prononcées, territoire incertain des évolutions islamistes et régionalistes, économies au rythme ponctué par la captation et la distribution de la rente, espace stratégique au sud d’une Méditerranée incertaine sur son avenir et bousculée par les pressions outre-Atlantique. Hier, on aspirait à une intégration semi-fermée, protégée par des barrières douanières communes vis-à-vis du reste du monde, aujourd’hui le régionalisme ne peut être qu’ouvert au libre-échangisme. Hier encore, l’internationalisation des économies traversait les espaces nationaux par les flux des échanges, aujourd’hui la mondialisation renforce par ses appels à la compétitivité la fragmentation en pays aux enjeux spécifiques voire personnalisés. Hier toujours, la complémentarité entre pays signifiait la spécialisation des systèmes productifs en fonction des dotations naturelles de leurs économies, aujourd’hui c’est l’articulation spatiale des séquences de la chaîne de valeur qui dessine la trame de la cohérence des économies. Autant dire que la nouvelle approche de l’intégration régionale est aujourd’hui plus exigeante que celle d’hier. Seule une volonté politique suffisamment forte peut établir un dialogue approfondi permettant de dégager les contours d’un avenir commun, une vision commune des liens politiques et économiques qui doivent réunir les pays du Maghreb dans une perspective à moyen terme. C’est à la définition du contenu de cet avenir commun qu’il convient de s’attacher, dans le cadre d’un dialogue maghrébin rénové, qui sorte du cadre trop formel et restrictif dans lequel il s’est enfermé. Cela permettrait de dégager ensuite la part de volontés conjuguées pour constituer un ensemble solide, doté d’instruments aptes à construire un destin lié entre pays maghrébins : c’est à dire à la fois un sentiment commun d’appartenance et de solidarité, et une tâche commune vis-à-vis du reste du monde. Aussi faudrait-il redéfinir un projet politique mobilisateur dessinant les contours d’un avenir commun, souhaité par l’ensemble des partenaires. Cette vision d’un «avenir commun» s’impose d’autant plus que l’intégration plus poussée des pays maghrébins dans un ensemble géopolitique est la condition quasi incontournable de leur insertion efficiente dans l’économie mondiale. Cela suppose la mise en œuvre de mécanismes de solidarité forts, capables de compenser les effets déstabilisateurs, au niveau social, des restructurations économiques rendues nécessaires par la libéralisation des échanges et de l’économie. Le processus d’intégration ne réussira que s’il parvient à mobiliser non seulement les décideurs politiques mais aussi tous les acteurs de la société civile, qui ont un rôle déterminant à jouer dans le développement économique, social et politique auquel sont confrontés les pays du Maghreb. C’est d’un processus à la fois participatif et interactif que le Maghreb a besoin. Participatif car aucune dynamique profonde ne peut réussir sans l’adhésion à la fois de ceux qui ont la responsabilité de la mettre en œuvre et de ceux qui en seront les bénéficiaires potentiels. Interactif, car si les décisions politiques qui engagent l’avenir d’une société ne peuvent être prises que par les gouvernements, leur légitimité est directement conditionnée par le degré d’écoute des aspirations exprimées par la société civile, auxquelles elles répondent. C’est bien une démarche citoyenne, portée par les corps intermédiaires qui structurent la société, qui constitue le facteur le plus décisif de succès du processus d’intégration. C’est par une patiente action de proximité, conduite par de nouveaux acteurs travaillant en réseau pour conforter leur autonomie qu’il sera possible de faire progresser concrètement la nouvelle utopie du Maghreb.
