Idées
La fracture onomastique
de même qu’une huître renferme en elle ce qu’elle deviendra, sa propre biographie en quelque sorte, le «nom propre», dont on nous a affublé comme une marque de fabrique pour nous nommer et donc nous distinguer du commun, est parfois une énigme, voire un vertige.
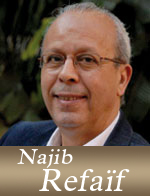
«Je n’ai point de nom qui soit assez mien». C’est par cette belle formule de Montaigne, citée en épigraphe, que la chercheuse Jacqueline Sublet a introduit un ouvrage fort intéressant sur les origines du nom chez les Arabes. Le voile du nom. Essai sur le nom propre arabe, publié en 1999 chez PUF, dans la collection Ecriture, retrace avec une grande érudition l’origine et la formation du nom arabe depuis des temps reculés et notamment depuis le Moyen-Age. Nous avions déjà rendu compte de ce livre en son temps et peu d’ouvrages aussi bien sourcés ont été publiés et encore moins en langue arabe. Il est vrai que Jacqueline Sublet été à l’origine d’une grande entreprise universitaire, «Onomasticon Arabicum», grande base de données en charge d’étudier et de répertorier les noms propres et les biographies des personnages identifiés dans les sources arabes avant le XVIIIe siècle. Ces recherches sont menées dans le cadre de l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT) et sous l’égide du CNRS. Un autre beau titre choisi par Abelkébir Khatibi, La blessure du nom propre, même s’il ne renvoie pas à l’onomastique proprement dite, cette science, qui étudie les noms, évoque poétiquement et mélancoliquement le rapport que l’on pourrait entretenir avec son propre nom. De même qu’une huître renferme en elle ce qu’elle deviendra, sa propre biographie en quelque sorte, le «nom propre», dont on nous a affublé comme une marque de fabrique pour nous nommer et donc nous distinguer du commun, est parfois une énigme, voire un vertige. Seuls certains porteurs de quelques patronymes particuliers peuvent s’en rendre compte. Comme le précise Jacqueline Sublet d’emblée dans son ouvrage cité ci-dessus à propos du nom propre médiéval, c’est le biographe qui est l’auteur du nom. «Le nom propre arabe médiéval, souligne-t-elle, contient cette exigence universelle ; tout savoir, tout recenser, se remettre tout en mémoire à travers les noms des personnes».
Mais loin de cette érudition sur l’ascendance, la descendance et la lignée où un voile patronymique vient cacher le nom ou le révéler à travers la religion et la mystique, la géographie et l’histoire, les pays du Maghreb et surtout l’Algérie ont souffert d’une toute fracture onomastique à l’époque de la colonisation. Un autre voile a été jeté sur le nom propre. Une autre blessure de nom s’est ouverte. En Algérie, considérée, jusqu’à son indépendance en 1962 comme un territoire français depuis son occupation en 1830, l’état civil, légué par les Ottomans lors de leur domination qui a duré trois siècles, a été annulé et révisé dès 1882. Ainsi, et jusqu’à aujourd’hui, de nombreux citoyens se retrouvent affublés de noms très difficiles à porter. C’est d’ailleurs ce qui a poussé les autorités algériennes depuis les années 70 à promulguer des lois afin de permettre à ceux qui le désirent de changer de nom de famille. Les procédures ne sont pas toujours aisées et peuvent durer plus de deux ans, et depuis peu seules quelque 2000 familles ont pu bénéficier d’un décret présidentiel.
Il faut dire que durant plus d’un siècle, suite à une décision des autorités françaises destinée à casser les liens tribaux et communautaires (ceux-là mêmes que l’ouvrage de Jacqueline Sublet a répertoriés et que Ibn Khaldoune avait analysés sous le concept d’Al assabya) des personnes ont dû supporter des patronymes qui relèvent du bestiaire ou des bêtes de foire. Les noms vont de «D’jaja» (poule) à «Halloufa» (truie) en passant par le lapin ou la brebis. On retrouve aussi des patronymes qui sont plus des sobriquets insultants que des identifiants patronymiques. Telle cette famille qui vient de bénéficier d’un changement de nom car pendant des générations elle a été identifiée comme «Zoubia», qui veut dire dépotoir ou poubelle en dialecte local. Au Maroc, zoubia c’est plutôt le foyer d’un feu, mais chez nous aussi, de nombreuses familles n’ont pas échappé à cette fracture patronymique. On retrouve d’ailleurs une vague de changement de noms, notamment chez les ruraux et les classes sociales modestes à la fin des années 60. D’où une floraison de Chawki et de Wahbi qui faisait référence aux vedettes du cinéma ou de la littérature égyptienne de l’époque. D’autres ont été inspirés par la zaouia ou la tribu du coin, sinon par des patronymes nobles dont ils ont revendiqué l’affiliation. Tous ces «voiles du nom» pour dissimiler ou révéler, car un voile cache autant qu’il révèle, ajoutent des surnoms à des noms oubliés, tronqués ou oblitérés afin de retrouver qui un goût d’avenir, qui une glorieuse ascendance et une saveur des origines, réelles ou fantasmées.

