Idées
La cure d’austérité
L’année entame à peine son second trimestre et les finances publiques sont déjà mises à rude épreuve.
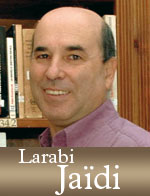
L’année entame à peine son second trimestre et les finances publiques sont déjà mises à rude épreuve. Manifestement, le gouvernement a des difficultés pour tenir ses engagements de réduction du déficit budgétaire. La question semble entendue: si le Maroc veut préserver sa souveraineté économique et conserver la confiance des organismes et marchés financiers internationaux, il va devoir s’attaquer à ses déficits. Une cure d’austérité s’impose. Le problème n’est pourtant pas si simple : non seulement un tour de vis budgétaire risquerait de mettre en péril une croissance déjà vacillante, mais les marges de manœuvre pour maîtriser les déficits sans faire couler les larmes se réduisent. Pour tenir les engagements gouvernementaux de revenir à un déficit de 4,8% en 2013, puis à 3% en 2016, il faudrait faire un effort d’autant plus significatif que l’activité risque de faiblir. Du coup, les recettes fiscales de l’Etat pourraient être moindres que prévu et il sera d’autant plus difficile de résorber les déficits. D’où la nécessité de trouver des ressources d’emprunts supplémentaires pour tenir l’objectif alors que la dynamique de la dette nationale commence à être préoccupante.
Tels sont les termes de l’équation budgétaire au printemps. Comment sortir de l’impasse budgétaire ? Il n’y a guère que deux solutions. Soit augmenter les recettes, soit couper dans les dépenses. La première solution consiste à augmenter les impôts. Le gouvernement avait promis de ne pas accroître la pression fiscale et même de la faire baisser, mais les circonstances pourraient avoir raison de ses bonnes intentions. La question posée reste où prélever davantage, et quand ? Les niches fiscales sont sur la sellette. L’Etat a accumulé depuis des années des dizaines d’exonérations et d’allégements d’impôt qui dérogent à la règle générale et le privent de précieuses ressources. Ces niches représentent un manque à gagner appréciable. Si l’on met de côté celles qui sont liées à des situations de vulnérabilité ou à des incitations efficientes à l’investissement, il reste un large ensemble de dispositifs qui profitent d’abord aux entreprises les plus grandes et aux ménages les plus aisés. Autrement dit, des acteurs qui pourraient certainement payer plus sans que l’activité économique en pâtisse trop. Mais l’action sur les recettes fiscales n’a pas un retour immédiat et aussi puissant que la réduction des dépenses, sauf à user et abuser du contrôle fiscal ou a contrario de l’amnistie fiscale.
La deuxième solution consiste à couper dans les dépenses. Mais encore une fois lesquelles ? Et comment ? Certaines dépenses ont déjà fait l’objet de réduction ces dernières années, comme celles portant sur la masse salariale de la fonction publique, les consommations ordinaires ou le train de vie de l’Etat. Il y a encore de la marge mais dans d’étroites limites. Reste cette variable d’ajustement qu’est l’investissement public, plus simple à manier que les dépenses de fonctionnement, quand on n’ose pas encore s’attaquer à ce monstre budgétivore qu’est la Caisse de compensation. Mais outre qu’elle pourrait s’avérer socialement très coûteuse, une politique de réduction de l’investissement public trop appuyée risque de compromettre un peu plus la croissance. Alors que la reprise est fragilisée, ce n’est donc pas le moment d’en rajouter.
La décision du gouvernement soulève des questions. 15% du montant des crédits votés seront supprimés ou par euphémisme «gelés». Dans son argumentaire, le ministère des finances évoque «l’aubaine» qu’offre l’accumulation des reports de crédits. Mieux valait, selon sa conception, rationaliser l’effort d’investissement en réalisant les projets en souffrance. Argument discutable. Le montant des reports était connu bien avant le vote de la Loi de finances 2013. Pourquoi donc avoir choisi de programmer de nouveaux projets alors que ceux en cours n’ont pas été exécutés à l’horizon prévu. Mauvaise prévision ? Volontarisme politique alors que les signes de l’impasse étaient déjà manifestes ? Effet d’annonce pour calmer des voix de Cassandres spéculant sur les perspectives d’un budget d’austérité ? Peut-être un peu de tout cela. La décision en elle même, quelle que soit l’appréciation portée sur son opportunité, est révélatrice d’un des maux dont souffre la gestion de la dépense publique : la difficulté de l’administration d’utiliser efficacement les ressources mises à sa disposition. Est-ce un défaut dans la conception, le montage et la mise en œuvre des projets ? Est-ce l’effet de la lourdeur du contrôle de l’exécution des marchés ? Toujours est-il que la capacité d’absorption de l’administration est mise en cause. Pourtant, on pensait que les principes de budgétisation pluriannuelle et de gestion axée sur les résultats devaient se traduire par une meilleure prévision des dépenses publiques et une meilleure articulation entre les politiques macroéconomiques et sectorielles et la préparation du budget de l’État.
Et last but not least, le mode de décision du gouvernement est peu conforme à l’esprit de la démocratie budgétaire. Choisir la voie d’une circulaire pour adopter ces mesures prête aussi à discussion. Il ne s’agit pas ici de contester la légalité, encore moins la constitutionnalité de la décision mais son adéquation au discours sur la participation dans la décision publique. Surtout à la veille de l’adoption d’une nouvelle loi organique des finances censée faire évoluer le mode d’intervention parlementaire dans le processus budgétaire. Le Parlement serait davantage investi dans le contrôle de la bonne utilisation des deniers publics. Ce contrôle peut s’exercer a postériori, lors du vote de la loi de règlement mais il peut aussi s’exercer en cours d’exécution. Décider des coupes budgétaires par une circulaire, fût-elle du chef du gouvernement, est une entorse à l’esprit de la future loi organique. Le gouvernement voulait-il agir avec célérité en optant pour un mode de décision administratif ou souhaitait-il éviter de s’embourber dans un débat parlementaire mû par des joutes oratoires plus que par l’intérêt général ?
Le débat aurait permis de renseigner la représentation nationale, et à travers elle l’opinion publique, sur l’évolution du périmètre des dépenses publiques, sur les prévisions et leviers de maîtrise de la dépense en exécution. Certes, la loi organique des finances n’est pas encore adoptée mais un débat tout aussi vertueux aurait pu être initié par une Loi de finances rectificative. En tout état de cause, le mode de faire du gouvernement a porté un sérieux coup à la bonne gouvernance des finances publiques.
