Idées
La constitution dans le temps
Par l’établissement de la constitution d’un pays, il s’agit de traduire « l’ordre social désirable » et d’inscrire les institutions qu’elle comporte dans cette vision. Par-delà la technicité inévitable d’un texte avant tout juridique, se dessinent les contours de ce que les pères de la constitution ont voulu en la rédigeant d’une certaine façon. Déduction logique : la constitution est le principe moderne de réflexion des sociétés politiques, le déterminisme de leur évolution.
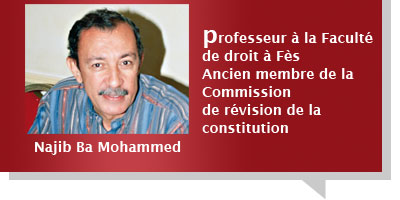
Toute constitution a pour objet de «constituer la société politique». Par l’établissement de la constitution d’un pays, il s’agit de traduire «l’ordre social désirable» et d’inscrire les institutions qu’elle comporte dans cette vision. Par-delà la technicité inévitable d’un texte avant tout juridique, se dessinent les contours de ce que les pères de la constitution ont voulu en la rédigeant d’une certaine façon. Déduction logique : la constitution est le principe moderne de réflexion des sociétés politiques, le déterminisme de leur évolution.
En effet, quand une société s’interroge sur elle-même, quand elle se remet en cause, elle se réforme, elle remet en cause sa constitution. Aussi le «moment constituant» est une prise de conscience par la société de la nécessité de changer de constitution. Il s’agit d’un changement collectif. Par ailleurs, la constitution fait advenir ce qu’elle énonce. A cet égard, elle s’apparente à une réponse de circonstance à des questions du moment dans un croisement de contextes. La constitution est toutefois dans le temps et porteuse de l’avenir d’une communauté humaine, elle n’est pas faite pour un moment. La constitution est une norme système qui domine l’ensemble de l’ingénierie sociale et juridique. Le temps est une dimension importante puisqu’il faut répondre aux besoins d’une société politique en mouvement.
La question des rapports du temps et de la constitution présente un intérêt d’autant important qu’elle peut être abordée sous différents angles qui définissent la constitution comme «processus» et le temps comme «durée».
Ainsi, le processus constitutionnel s’accomplit génétiquement dans la succession de temporalités corrélatives quoique à fonctions variables:
– Le temps “constituant”.
– Le temps de “l’effectivité”.
– Le temps de “la révision”.
Le temps constituant est relatif au pacte politique fondateur de l’ordre constitutionnel choisi.
Trois séquences cardinales structurent cette temporalité : la réforme politique globale initiée par le discours royal du 9 mars 2011, les travaux préparatoires de la Commission consultative de révision de la constitution (CCRC) et du mécanisme politique de suivi qui trahissent une démarche participative, inclusive et transparente, enfin le référendum de ratification populaire du 1er juillet 2011.
Le corpus constitutionnel naquît, s’imposant par un “esprit” qui se révèle dès les premières lignes du préambule : «Fidèle à son choix irréversible de construire un Etat de droit démocratique, le Royaume du Maroc poursuit résolument le processus de consolidation et de renforcement des institutions d’un Etat moderne, ayant pour fondements les principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance. Il développe une société solidaire, où tous jouissent de la sécurité, de la liberté, de l’égalité des chances, du respect de leur dignité et de la justice sociale, dans le cadre du principe de la dignité et de la justice sociale, dans le cadre du principe de corrélation entre les droits et les devoirs de la citoyenneté».
L’accomplissement du “temps constituant” fige la volonté populaire au moment de la ratification. Le temps demeure cependant au cœur de la problématique constitutionnelle que déterminent deux préoccupations contradictoires : la stabilité et l’adaptabilité.
D’un côté, la constitution doit être stable car elle aménage les conditions d’exercice du pouvoir et fixe les droits et libertés des citoyens qui ne peuvent pas être soumis aux aléas du moment.
D’un autre côté elle est soumise au temps qui impose qu’elle s’adapte aux conditions du moment qui permettent des mises à jour ponctuelles et remodèlent le texte. C’est l’impératif de la révision.
Le temps de la révision est considéré comme l’expression différée du pouvoir constituant originaire, conscient de ne pas faire œuvre éternelle. La fonction de réviser la constitution permet, au moyen de procédures préétablies et de prescriptions définies, d’adapter la loi fondamentale à la volonté d’assurer la pérennité de la constitution affrontée aux effets du temps.
La constitution de 2011 consacre son titre XIII à la question de sa révision, avec cette innovation majeure qui sacrifie à la logique de la continuité de l’ordre constitutionnel choisi : «Aucune révision ne peut porter sur les dispositions relatives à la religion musulmane, sur la forme monarchique de l’Etat, sur le choix démocratique de la nation ou sur les acquis en matière de libertés et de droits fondamentaux inscrits dans la présente constitution» (art. 175).
Pareils «interdits» à la révision supposent un «existant constitutionnel» éprouvé, mais soumis à la loi naturelle du changement. Il s’agit d’une temporalité qui interpelle l’effectivité constitutionnelle puisque en dépit de sa généralisation à tous les Etats ou presque la constitution n’a ni le même sens ni la même valeur.
Le temps de “l’effectivité”
Ce constat sur l’effectivité aléatoire des constitutions est cependant à modérer compte tenu de la réceptivité variable des espaces politiques et opinions publiques à ladite norme. De surcroît, la problématique de l’effectivité constitutionnelle a servi de critère à une typologie des constitutions naguère esquissée par Karl Lowenstein. L’auteur avait distingué les constitutions «normatives», c’est-à-dire effectivement appliquées; les constitutions «nominales», c’est-à-dire juridiquement en vigueur mais partiellement appliquées et les constitutions «sémantiques», c’est-à-dire purement formelles. A vrai dire, cette classification est tombée en désuétude, les constitutions de la génération des transitions démocratiques se réclamant de l’Etat de droit et du magistère des juges s’affirment «normatives».
Le problème posé par cette temporalité constitutionnelle est celui de l’effectivité de la norme-système. L’effectivité signifie ce qui existe réellement, ce qui se traduit en actes et s’affirme en pratiques. L’effectivité constitutionnelle implique le temps, court ou long, nécessaire à l’application, le respect et la réceptivité de la constitution, par les pouvoirs constitués que par les citoyens tenus par le devoir d’obéissance et d’adhésion à ses objectifs.
L’application est à accepter dans le sens général de mise en œuvre normative et institutionnelle de la constitution qui correspond à son entrée en vigueur en tant que déterminisme juridique conditionnant action et comportement sociopolitiques individuels et collectifs. La mise en scène de la constitution est juridiquement consacrée à terme par l’acte de promulgation à effet immédiat sous réserve des dispositions transitoires. La promulgation est suivie dans une temporalité qui ne saurait excéder la durée de la législature par les lois organiques (art. 86) dont la promulgation n’est effective qu’après contrôle par la Cour constitutionnelle, de leur conformité à la constitution (art. 132- al. 2).
Ecrit solennel, la constitution ne va pas sans l’interprétation qu’elle suscite et qui lui donne valeur et effectivité. Un texte dépourvu d’interprétation, c’est un texte inerte ou en tout cas en état d’hibernation. Le temps n’est pas indifférent à l’interprétation de la constitution compte tenu aussi de la diversité des interprètes, les attitrés et les libres.
Parmi les interprétations officielles, celle du juge constitutionnel transcende. C’est une interprétation hautement qualifiée d’autant plus qu’elle s’impose, selon des modalités différenciées, à tous, pouvoirs et citoyens.
Les interprètes libres présentent la particularité de n’exercer aucune autorité publique. Ils ne sauraient donc imposer leur interprétation, fut-elle fondée. Ils peuvent cependant, de bonne ou de mauvaise foi, influer sur les opinions. Dans cet ordre, il peut s’agir d’interprétations savantes émanant de ce que l’on appelle la doctrine qui sans doute ne détient pas la vérité absolue, mais qui s’impose par la rationalité méthodologique même si son engagement politique peut la pousser à des dérives et influencer en conséquent l’opinion publique.
La vérité constitutionnelle affleure pour une large part dans les médias. L’écho qui est procuré à certaines controverses, le relais qu’apporte les médias à des politiques ou le silence qu’elles conservent sur les mêmes sujets pèsent d’un poids, très lourd, dans le succès qui est procuré à telle interprétation ou autres. L’interprétation est accréditée ou au contraire elle est rejetée par ceux qui ont vocation de s’adresser à l’opinion publique.
Une constitution est d’abord une idée de droit, un construit en devenir et pour reprendre la formule du général De Gaulle, «une constitution c’est un esprit, des institutions et une pratique» dont le destin est lié aux exigences à satisfaire dans l’ordre des priorités selon le rythme du temps.
L’effectivité constitutionnelle se mesure au regard des pratiques à créer ou des résistances qui permettent de tester la force de résilience de la constitution, soit un «décorum» avéré ou un «imperium» affirmé. En tout cas, il faut du temps pour que les pratiques de la constitution liées à l’exercice du pouvoir ou des droits fondamentaux puissent se réaliser, tout comme aux pratiques dissidentes de s’éroder.
A divers niveaux, l’effectivité de la constitution renvoie confusément à son respect, à sa réceptivité par le corps social. Une constitution est faite pour être respectée, l’acte constituant implique dans la permanence l’obligation de respecter le texte constitué. Le devoir de «respect de la constitution» ne peut se réduire à un loyalisme machinal, cosmétique et transférable. Si le respect de la constitution a une substance, elle est contenue dans le sens de l’expression «respecter la constitution», l’instance «habilitée légitimement» à le faire et le «moment» pour le faire ( permanence ou circonstance ). Encore faudrait-il considérer les variations sémantiques de la constitution: normative, institutionnelle, décisionniste et régime politique.
Respecter la constitution, selon une acception générale, serait rapporter les situations matérielles à la charte fondamentale. L’acte de respecter la constitution est enchâssé dans une formule expresse qui comporte un verbe, “veiller”, et l’activité de veille. Le «Roi veille au respect de l’Islam» en sa qualité d’Amir Al Mouminine (art. 41) ; le “Roi veille au respect de la constitution” en ses multiples qualités dont celle d’abord de chef de l’Etat (art. 42). Le juge veille ensuite au respect de la constitution dès lors que sa fonction est de contrôler les gouvernants et de protéger les droits fondamentaux.
“Veiller au respect” signifiant foncièrement “faire respecter” est une fonction qui revalorise la constitution et la réhabilite comme “épicentre” de l’ordre politique, tout en “sanctuarisant” l’instance chargée de ce “faire” dans la majesté du temps continu. Car pour le Roi, c’est une charge et pour le juge constitutionnel, une compétence. Du côté du Roi , le verbe “veiller” évoque d’autres, voisins, “arbitrer et garantir”, qui mettent à sa charge une obligation générale de faire en sorte que les institutions fonctionnent effectivement harmonieusement, en droit et en fait, tant il est garant de l’ordre étatique et arbitre suprême entre ses institutions ( art. 42).
Quand le juge constitutionnel “veille au respect de la constitution”, il exerce une compétence qui postule le magistère du droit et du juge aux fins de contrôler le pouvoir et de construire l’Etat au bénéfice du citoyen par le moyen d’un droit processuel à même de garantir la démocratie et les droits fondamentaux.
En définitive, tout constitutionnaliste sait depuis longtemps que la réussite d’une constitution et le bon fonctionnement des pouvoirs qu’elle institue ne dépendent pas moins de l’accueil de l’opinion publique que de l’ingénieux agencement de ses dispositions. En effet, le meilleur des textes au regard de l’esprit qui l’a conçu n’a pas d’avenir, ni de chance de durer s’il n’est pas reçu par l’opinion et ne répond pas à ce qu’elle en attend. Par-delà le “moment référendaire” et la mobilisation en faveur d’un vote d’adhésion (ou de refus), la question de la réceptivité de la constitution est bien celle de l’adhésion lente et progressive de la société, élites et collectivité, à la culture juridique, politique et démocratique.
La réceptivité de la constitution est un acte d’intelligence et de confiance de la société, le discours sur la constitution est aussi le critérium du degré d’évolution politique de l’opinion.

