Idées
La consommation des Marocains se transforme
Aux traditionnels clivages entre catégories socioprofessionnelles s’ajoutent les conséquences du chômage et de la précarisation de l’emploi.
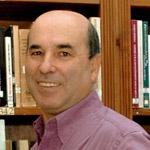
Le développement économique qu’a connu le Maroc depuis plus d’un demi-siècle a entraîné un changement considérable de la consommation des ménages. Les Marocains consomment plus, mais aussi autrement. Certaines dépenses ont pris une place importante (la santé, le logement), tandis que d’autres ont vu leur part reculer dans le budget des ménages (l’alimentation). En théorie, les ménages satisfont d’abord leurs besoins primaires, puis les besoins moins essentiels, et ainsi de suite, jusqu’au superflu. C’est dans cet esprit que le statisticien Ernst Engel a formulé des lois statistiques censées mettre en évidence la hiérarchie des besoins des consommateurs. La plus célèbre de ces lois énonce que la part des dépenses d’alimentation recule lorsque le revenu s’accroît. C’est bien cette évolution qui est constatée au Maroc sur une longue période. La justification de l’énoncé d’Engel est intuitive : chaque individu ne possède qu’un estomac et il ne peut donc accroître indéfiniment les quantités qu’il ingère. C’est pourquoi, quand ses ressources augmentent, il consacre de préférence son surplus de revenu à d’autres postes. Ce phénomène de saturation ne s’observe pas seulement pour l’alimentation, mais aussi dans d’autres domaines comme l’habillement ou l’électroménager. Cependant, la saturation est souvent très relative, parce que, à l’intérieur de chaque grand poste de la consommation, les transformations de l’offre (nouveaux produits, nouvelles fonctionnalités) et des modes de vie (élévation des revenus, travail des femmes, etc.) entraînent un renouvellement des besoins. L’alimentation en fournit un bon exemple : la consommation alimentaire n’est peut-être pas saturée sur le plan quantitatif, mais connaît des évolutions qualitatives continues. Une fois leurs besoins caloriques satisfaits, les ménages s’attachent à améliorer la qualité de leur alimentation. D’où, à mesure que le revenu s’élève, un accroissement de la consommation de légumes frais au détriment des pommes de terre, ou bien un abandon relatif du thé au profit de boissons gazeuses. Cette croissance qualitative des dépenses est, en principe, progressive et illimitée. C’est pourquoi les dépenses alimentaires continuent à croître, même pour les revenus les plus élevés. On pourrait en dire de même des dépenses de santé : si elles progressent, c’est parce que nous sommes prêts à consacrer plus d’argent pour vivre en meilleure forme, mais aussi parce que la technicité croissante des soins médicaux entraîne un renchérissement des coûts. La démarcation entre les besoins primaires et les besoins secondaires est donc souvent floue : s’alimenter est indispensable, mais dans quelle mesure l’amélioration de la qualité de la nourriture est-elle nécessaire ou superflue ?
Même si la précarité s’étend et les inégalités persistent, les Marocains ont, en moyenne, continué à modifier leur mode de consommation. Un phénomène évident en matière d’équipement du foyer et de motorisation. Malgré la lente croissance, les ménages ont continué à s’équiper en téléviseurs, magnétoscopes et autres produits bruns. Même chose pour la voiture ou le vélomoteur. Le processus de diffusion de certains produits est encore d’une rapidité fantastique, témoin le développement du téléphone portable, qui s’est «ruralisé» en l’espace de quelques années. Cette diffusion apparente des normes «modernes» de consommation doit-elle conduire à parler d’homogénéisation de mode de vie et de «fin du social» en matière de consommation? Les groupes sociaux n’auraient plus de consistance et on ne pourrait plus distinguer d’univers de consommation liés à l’appartenance sociale ? En réalité, les inégalités de consommation sont loin d’avoir disparu. Dans une société où les 10 % les plus riches gagnent dix fois plus que les 10 % les plus pauvres, on imagine sans mal qu’ils consomment différemment ! L’apparent rapprochement des coefficients de consommation cache des consommations très différenciées. C’est sans doute en matière de consommation de services, moins ostentatoire, que les écarts sont les plus forts. La consommation de certains services marchands, et notamment ceux qui permettent de prendre en charge une partie du travail domestique demeure réservée aux catégories supérieures. La capacité des plus aisés à acheter aux autres du temps afin d’en gagner pour eux-mêmes est encore aujourd’hui une des formes majeures de l’inégalité sociale. De même, la consommation de soins de santé est l’apanage des plus aisés. La diffusion de certaines pratiques ou comportements de consommation s’accompagne d’un renouvellement de ce qui fonde la distinction. Au bout du compte, la modification réelle des modes de consommation depuis témoigne d’une certaine amélioration du niveau de vie des Marocains, mais aussi de l’évolution des normes sociales : des biens qui semblaient luxueux hier sont désormais consommés par de larges couches sociales. Cependant, les inégalités entre ménages persistent, voire s’aggravent. Et aux traditionnels clivages entre catégories socioprofessionnelles s’ajoutent les conséquences du chômage et de la précarisation de l’emploi, qui touchent en priorité les groupes sociaux défavorisés.

