Idées
La Chine change son modèle économique
La présence chinoise chaque jour plus forte bouleverse les équilibres économiques et géostratégiques dans diverses parties du monde. Elle suscite interrogations et intérêt
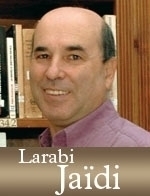
D’une plateforme mondiale de production pour l’exportation, la Chine est en train de muer vers une puissance émettrice d’investissements à destination de diverses régions du monde. Son modèle économique qui reposait sur la compétitivité prix s’essouffle. Sa revitalisation repose sur l’implantation des entreprises chinoises dans des pays relais ou partenaires. Le Maroc dispose-t-il d’une stratégie pour capturer une infime partie du potentiel des IDE chinois ? Cette logique gagnant-gagnant peut ouvrir des perspectives commerciales à destination du grand marché européen.
La Chine a longtemps bénéficié des avantages d’un modèle de croissance combinant des coûts salariaux très bas avec des technologies et des capitaux venant de l’étranger. Le pays est devenu «l’usine du monde» et pas seulement pour fabriquer des chemises. Cette capacité est le résultat en grande partie des délocalisations qu’ont opérées en Chine les entreprises des pays industrialisés (Etats-Unis, Europe, Japon, pays émergents d’Asie les plus avancés).
59% des exportations du pays sont en réalité le fait d’entreprises étrangères établies en Chine. Le label «made in China» désigne souvent des articles assemblés en Chine à partir de demi-produits fabriqués ailleurs. Pour réduire leurs coûts, les entreprises basées en Chine ont cherché à substituer à leurs importations des demi-produits fabriqués localement et à réaliser des activités d’outsourcing… Mais ce modèle a atteint ses limites. La pression sur les prix des biens exportés est de plus en plus forte, alors que les intrants, davantage sophistiqués, sont de plus en plus chers et les prix des matières premières très élevés. Jusqu’en 2010, l’évolution démographique a continué à peser à la baisse sur les salaires, avec l’arrivée sur le marché du travail de la génération nombreuse des jeunes de 20-24 ans (+ de 16 millions) et a continué à favoriser les industries intensives en travail et les exportations reposant sur la compétitivité prix. Aujourd’hui, l’essor des petites industries et des emplois de service, notamment dans les zones rurales, a permis d’absorber l’excédent de la main-d’œuvre agricole. C’est en 2015 que l’évolution de la structure par âge de la population active sera plus favorable à une hausse des salaires. D’autant plus que les autorités prévoient l’extension du système de couverture sociale qui devrait réduire l’épargne de précaution des ménages et augmenter le revenu disponible pour les dépenses de consommation.
Le poids de la Chine dans les flux des stocks d’IDE mondiaux reste encore faible aujourd’hui même s’il est probable que ce poids va s’accroître dans les années à venir. Il ne faut pas oublier que jusqu’en 2002 Pékin freinait des quatre fers quand il s’agissait d’autoriser une entreprise publique à investir à l’étranger. Vingt ans de réformes auront été nécessaires pour que le PCC opère un revirement à 180 degrés dont lui seul a le secret et lance les entreprises d’Etat dans la course à l’internationalisation. En dépit des réformes conduites, et qui ont abouti à la création en Chine de nombreuses entreprises privées, l’Etat reste le grand décideur des stratégies d’entreprises à l’international. Ce n’est qu’en 2004 que la Constitution chinoise a admis le principe de la propriété privée. Mais, depuis cette date, un nombre croissant d’entreprises privées sont dans les starting-blocks. Les réformes à marche forcée ont fait apparaître une nouvelle catégorie d’acteurs de nouvelles structures et des ambitions d’entreprises modernes. Qu’il soit en première ligne de l’actionnariat ou derrière le «paravent», l’Etat chinois est le grand sinon l’unique décideur des stratégies d’entreprise à l’international, fussent-elles officiellement «indépendantes». Le business et la politique vivent en Chine en concubinage notoire. Pour ces entreprises, petites ou grandes, l’Etat est prodigue de ses encouragements par des largesses financières: rabais sur les taux d’imposition, crédit à taux zéro, recours au pactole des réserves de change. Cette politique marque des points : déjà, sur les 100 plus importantes multinationales issues des pays émergents, 44 sont chinoises. Les opérations de croissance à l’international sont réparties entre investissements industriels et fusions et acquisitions. Le premier objectif est de sécuriser l’approvisionnement en matières premières, énergétiques.
La présence de la Chine en Asie et en Amérique Latine reste pour le moment limitée. La Chine n’apporte que 6% du flux entrant des IDE dans ces régions. L’intérêt que la Chine porte à l’Amérique latine s’explique au regard de trois enjeux : pétrolier, minier et agricole. L’Afrique est aussi courtisée pour ses importantes ressources en matières premières. La Chine a besoin pour nourrir sa croissance des ressources dont regorge le continent noir. C’est la région du Golfe de Guinée qui va étancher la soif chinoise. L’Afrique a besoin des aides chinoises pour se développer. Un principe donnant-donnant s’impose dès lors. Sur ces marchés du Sud, la Chine taille des croupières à ses concurrents occidentaux. Les entreprises chinoises ont déjà commencé à changer les règles du jeu de la concurrence mondiale. La Chine est ainsi critiquée parce que l’on considère qu’elle surpaie l’accès aux ressources naturelles, elle accorde trop facilement des prêts à des pays qui sortent à peine du piège de l’endettement, elle prête l’argent sans considération pour les conséquences politiques, sociales et environnementales. Les récriminations envers les investissements chinois et leur méthode de management se multiplient (cadences de production, non-respect des lois sociales). Mais il serait excessif de ne voir dans ces investissements qu’un simple comportement de prédateur économique. La présence chinoise chaque jour plus forte bouleverse les équilibres économiques et géostratégiques dans diverses parties du monde. Elle suscite interrogations et intérêt.
