Idées
Islamisme, mot piège
On aura observé que pendant la campagne présidentielle, François Hollande, à la différence de Nicolas Sarkozy et, surtout, de Marine Le Pen, prenait soin, quand il abordait le chapitre de l’islamisme, de préciser qu’il ne visait pas par ce mot la spiritualité musulmane, mais sa figure pervertie.
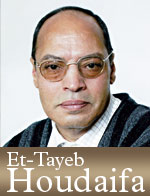
On aura observé que pendant la campagne présidentielle, François Hollande, à la différence de Nicolas Sarkozy et, surtout, de Marine Le Pen, prenait soin, quand il abordait le chapitre de l’islamisme, de préciser qu’il ne visait pas par ce mot la spiritualité musulmane, mais sa figure pervertie. Précaution sémantique superflue, objecterait-on. Comme si le vocable était à ce point univoque qu’il ne prêterait à aucune confusion. Or, d’évidence, il ne l’est pas. Le terme a surgi à l’aube des années quatre-vingt-dix, à une époque où une frange de l’islam idéologique, impuissante à s’emparer du pouvoir, adopta la stratégie de la terreur. Il fallait un terme apte à décrire cette dérive sanglante d’une utopie naguère porteuse d’espoir pour les déshérités. On en vint à créer «islamisme», sans doute sur le modèle de «communisme». Erreur fatale ! D’une part, le mot, s’il était peu usité, existait depuis 1697, en relation de synonymie totale avec «islam» : «L’artiste avait abjuré l’islamisme, et lui et sa femme n’avaient de musulman que le bonnet turc» (Gérard de Nerval). De l’autre, l’usager commun de la langue tendrait à utiliser indifféremment «islam» et «islamisme», avec la même valeur dont il investit «christianisme», «catholicisme» ou «protestantisme». Sauf qu’en l’occurrence, l’acception du mot se trouve lestée d’une charge connotative dépréciative. Les pièges naissent, selon Wittgenstein, de nos mots les plus ordinaires et de la diversité inaperçue de leurs emplois. Mots, maux.

