Idées
Héritage et volonté
on remarque que pour «ceux qui ont» comme pour «ceux qui aimeraient avoir», le rêve ou la fiction diffère selon la catégorie sociale héritage et volonté
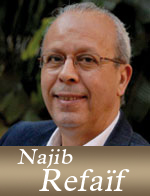
Il en va parfois d’une société ou d’un pays comme d’un patrimoine: il y a celui que l’on reçoit par l’héritage et celui que l’on construit par la volonté. Le premier est conservateur ou renfermé sur lui-même, le second est ouvert sur les autres et sur le monde. Certains individus répondent aussi dans leur vie au quotidien à cette même vision dichotomique, s’en accommodent un certain temps avant d’en pâtir. D’autres enfin, plus avisés ou plus instruits par l’expérience des autres et par l’histoire, tentent d’allier les bienfaits de l’héritage au labeur de la volonté. Ce n’est pas la voie la plus facile, mais c’est la moins risquée et la plus méritante. Mais entre ces deux catégories s’érige parfois le facteur de l’inégalité. Inégalité devant la perception de tout ce qui fait qu’une société avance ou s’immobilise. Inégalité aussi devant la représentation des choses de la vie, devant la bêtise ou l’ignorance. Traversant la société en diagonal, un peu comme le fou de l’échiquier, et passant ainsi des gens de «peu» des quartiers pauvres aux gens de «tout» des résidences riches, on croise une même et seule humanité divisée par cette vision différenciée.
Loin de ces considérations philosophiques, on remarque que pour «ceux qui ont» comme pour «ceux qui aimeraient avoir», le rêve ou la fiction diffère selon la catégorie sociale. Loin de nous ici l’idée de faire dans un quelconque déterminisme social injuste, infondé et réducteur, car la différence n’est pas que sociale, elle est aussi (au sein d’une même catégorie sociale) d’ordre culturel au sens général du mot culture, c’est-à-dire en rapport avec le niveau d’instruction ou la qualité de cette dernière. La représentation est différenciée, tant et si bien que la perception de la fiction dans le domaine du divertissement, par exemple, notion censée en général fédérer, obéit à des critères différents, voire opposés et conflictuels. La fiction est, selon les anthropologues, le siège même de la représentation et la fabrique de modèles ou de héros. Mais si toute fiction dépend de son contexte culturel au sens anthropologique, il en est de même lorsque la notion de fiction rejoint «le monde du possible» ici et maintenant et se confond avec la réalité dans une «théâtralisation» du réel. Dans cette confusion des genres, nous avons affaire à un autre contexte culturel, au sens commun cette fois-ci. Trop commun. Et là, exit l’anthropologie et la culture! Bonjour la démagogie et la bêtise !
Une des dernières illustrations de cette confusion entre le réel et le fictionnel a eu pour théâtre une cérémonie qui rendait hommage au comédien blanchi sous le harnais, Abdelkader Motâa, organisée par une association des œuvres sociales de l’enseignement à Khénifra. Lors de cette cérémonie, un téléfilm produit par 2M a été diffusé où le comédien «hommagé» tenait le rôle d’un homme riche et arrogant dans un village éloigné et qui va suborner une jeune institutrice fraîchement nommée. Le téléfilm, diffusé il y a dix ans déjà, retrace en fait les heurs et malheurs de ces jeunes institutrices célibataires et novices que l’on envoie dans des contrées lointaines et difficiles. Lors donc de cette cérémonie, des instituteurs mâles et en colère ont sommé le comédien de présenter ses excuses pour avoir joué ce rôle de suborneur. Et voilà que le pauvre comédien convié pour un hommage -alors qu’il n’avait rien demandé- se retrouvant, pour de vrai, dans la peau d’un accusé, présente ses plates excuses pour tout le «mal qu’il avait fait». On espère pour lui qu’en professionnel aguerri, il a dû jouer encore une fois le rôle du type qui bât sa coulpe. Cette scène s’est passée devant une salle partagée entre l’étonnement et l’indignation d’une partie des invités et la satisfaction et le contentement des histrions qui confondent la réalité et la fiction. Le pire dans cette histoire qui, ailleurs, relèverait d’un mauvais sketch, c’est que ces inquisiteurs sont des enseignants. On imagine dès lors les dégâts que causent ces béotiens dans les classes auxquelles ils président. Mais, ce qui est encore plus inquiétant, c’est que l’on assiste de plus en plus à ce type de réactions envers les choses de l’art en général et de la fiction en particulier.
Plus qu’un conflit culturel au sens commun, on peut constater qu’une certaine pensée obscurantiste revisite la création, laquelle, avec la femme, sont les deux mamelles, si l’on ose dire, qui nourrissent les griefs des tenants de ce courant idéologique. Peut-être parce qu’ils y voient les véritables menaces contre leur triste dessein. Mais en tout état de cause, tant que la raison qui décortique les mythes, analyse les représentations et met à plat les croyances que nous avons reçues en héritage n’est pas au centre de la pensée, de l’éducation et de la gestion de la vie publique ; et tant que l’imagination, l’art et la création ne sont pas libres et libérés, il y aura toujours de plus en plus d’hurluberlus pour chahuter le cours de l’histoire. Tâchons seulement d’allier intelligemment ce que nous avons reçu par héritage avec ce que nous obtiendrons par la volonté.

