Idées
Enjeux de la restructuration de la minoterie
Il y a un réel besoin de définir une vision stratégique de l’avenir de la minoterie. Les opérateurs de ce secteur ressentent le besoin d’une maîtrise de moyens adéquats pour le relèvement de la profitabilité de la minoterie leur permettant d’affronter la compétition internationale dans de meilleures conditions.
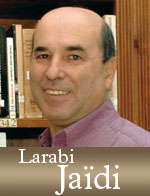
La filière de la minoterie est à la recherche d’une nouvelle logique de fonctionnement. La politique de libéralisation est certes incontournable, elle est même susceptible d’influencer positivement les performances de cette activité. Mais la question fondamentale demeure celle des conditions nécessaires pour parvenir à une utilisation rationnelle des équipements disponibles, à un ajustement des entreprises, à l’amélioration de la compétitivité des produits et à la mise en œuvre d’un cadre de croissance à long terme de cette industrie. Une minoterie saine et performante stimulera la production céréalière nationale et contribuera à l’amélioration des revenus des producteurs. Les relations entre l’agriculture céréalière et le secteur de la minoterie présentent, en effet, un degré relativement élevé de dépendance. Avec les perspectives d’une libéralisation plus avancée de la filière céréalière, la valorisation de la compétitivité de la minoterie appelle, sans doute, la mise en œuvre d’un plan de restructuration global. C’est ce que semble prévoir le ministère de l’agriculture dans la mise en œuvre du Plan Maroc Vert.
L’impératif d’un plan de restructuration de la minoterie s’explique par différentes raisons. D’un côté, l’environnement réglementaire souffre encore de certaines limites : les mesures de libéralisation (révision de la tarification douanière, réforme de l’ONICL…) ont tout juste desserré certaines contraintes pesant sur l’activité de la filière. Les contraintes du cadre réglementaire dans lequel opéraient les minoteries ont fini par produire des effets pervers sur la gestion des unités et sur le comportement des acteurs. De l’autre côté, le secteur pâtit d’une surcapacité d’écrasement : hérité du mode de développement façonné par l’intervention publique, le suréquipement de la minoterie présente de fortes variations selon les moulins et les régions. Il en résulte des écarts de compétitivité dans la position des entreprises sur le marché. Il en résulte aussi une inégalité de taille : face à de puissants groupes dominant le marché survivent des moulins vulnérables, en majorité vétustes et sous-capitalisées et qui auront de plus en plus de difficultés à s’adapter à un marché de la farine libéralisé. De plus, les enjeux de la filière dépassent le seul avenir de la minoterie : maillon dans la chaîne céréalière, ses performances sont influencées et en même temps agissent sur les activités situées en amont et en aval de la transformation du blé. L’accroissement de la production céréalière nationale dépend en grande partie de la capacité des minoteries à offrir des débouchés et des prix d’achat incitatifs aux producteurs.
Enfin, il y a un réel besoin de définir une vision stratégique de l’avenir de la minoterie. Les opérateurs présents dans ce secteur ressentent le besoin d’une maîtrise de moyens adéquats pour le relèvement de la profitabilité de la minoterie leur permettant d’affronter la compétition internationale dans de meilleures conditions.
Une restructuration spontanée et sauvage en fonction des seules lois du marché sera coûteuse pour la profession et la collectivité. Il est nécessaire d’accompagner l’émergence d’un marché libre par la mise en place d’une politique appropriée de guidage des choix, d’amortissement des chocs et d’anticipation des avantages. Dans cette perspective, la politique de restructuration de la minoterie devrait se conformer à une démarche stratégique, offensive, globale et programmatique : stratégique parce qu’il importe d’identifier le potentiel de développement de cette activité, offensive parce qu’il s’agit de définir des actions dans le cadre d’une politique d’offre compétitive ; globale parce qu’il faudrait intégrer les facteurs d’ordre réglementaire économique, financier et organisationnel ; programmatique parce qu’elle devrait se déployer sur une période donnée et selon un échéancier dûment établi. En dépit de quelques grandes réussites, l’activité a toujours besoin d’une rationalisation de la gestion, de l’exploitation des gisements de productivité et de l’amélioration de la qualité des produits. Le surinvestissement a conduit le particularisme des intérêts à s’affronter dans une situation où les mécanismes de garantie ne sont plus de mise. Il a provoqué inéluctablement des effets déstabilisants.
La mise en place d’un programme de résorption des surcapacités s’impose. Ce programme ne saurait être réalisé d’une façon obligatoire, immédiate et arbitraire. Il est censé revêtir un caractère volontaire, progressif et méthodique en procédant par des opérations d’absorption, de fusion ou de rachat. Sa finalité ultime est de réguler efficacement les capacités d’écrasement, d’améliorer le coefficient d’utilisation des unités de production, de donner à certains moulins, destinés à disparaître tôt ou tard, le moyen de «sortir» autrement que par la ruine, de restituer à d’autres la faculté de survivre, voire de s’agrandir. La profession pourrait, par l’intermédiaire de ses instances représentatives, être habilitée à jouer un rôle actif particulièrement important dans la réalisation des opérations tendant à l’assainissement de l’industrie meunière. C’est une opportunité de redorer son image ternie par tant de clichés et affaiblie par des calculs de politique politicienne. Ce sera aussi une façon de reconnaître à quelques-uns de ses leaders le courage d’avoir appelé, il y a plus de dix ans, à une restructuration du secteur pour le faire sortir du guêpier d’une économie administrée et opaque.
