Idées
Charlie à Davos
la sécurité, dans tous ses aspects, appelle un renforcement des instituions de la gouvernance mondiale et à l’échelle des nations et une implication plus forte des acteurs économiques et sociaux dans la conception et la gestion des politiques publiques
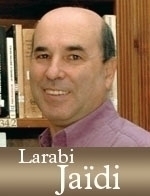
Comme le veut le rituel de chaque mois de janvier depuis plus de quarante ans, la petite commune de Davos, dans l’est de la Suisse, s’est transformée pendant quelques jours en un lieu de rencontre du gotha de la finance et de la politique internationales. Le Forum économique mondial y a tenu ses assises annuelles pour débattre de l’avenir du monde en présence de nombreux chefs d’Etat ou de gouvernement et des dirigeants de grands groupes. Les thématiques économiques de l’heure ont été passées au crible: la stratégie anti-déflation de la BCE, les incertitudes du pétrole, la conférence sur le réchauffement climatique… Mais Davos 2015 a surtout été préoccupée par les dangers de la menace terroriste qui pourraient compromettre l’économie mondiale. L’ombre de Charlie, les attentats de Paris ont pesé de tout leur poids dans le débat. Mais la réflexion sur le combat contre le terrorisme a-t-elle été à la mesure de la gravité du phénomène ? A notre grand désagrément, quand les leaders mondiaux de la politique, de la diplomatie ou de l’économie en sont venus à débattre du terrorisme, leurs discours ne nous ont pas livré les clés de compréhension escomptées sur ce mal qui ronge la planète. On n’y trouve qu’une litanie de dénonciations ; aucun rapport n’y est établi avec les conflits internationaux, la mal-gouvernance mondiale, la reproduction des dissymétries entre acteurs inégaux. Oui, sans nul doute, la terreur est odieuse. Mais le plus important argument pour l’extirper n’est-il pas celui d’en définir les «causes profondes» ? La terreur est en fait un symptôme, une réaction à quelque chose de plus profond qui requiert toute notre attention.
Depuis la fin de la guerre froide et le triomphe de l’économie du marché, un schisme s’est produit avec effet de miroir. On assiste à l’extension à l’ensemble du globe d’une économie mondiale, libérale, dérégulée qui a pour effet de creuser le fossé entre les riches et les pauvres. On peut douter que cette vérité explique à elle seule telle ou telle manifestation particulière du terrorisme. On peut réagir de façon différente aux bilans du libéralisme: c’est un système qui apporte aussi de nouvelles possibilités sociales et politiques, capables de susciter les espoirs et des perspectives au lieu d’alimenter un terrorisme antipolitique et nihiliste. Mais rien ne peut nier que la représentation d’une économie mondiale auto-régulée, qui avait peu à peu pris corps depuis la chute du mur de Berlin s’est avérée une véritable utopie. Ces dernières décennies ont montré que l’organisation des relations économiques et financières internationales ne pouvait être conçue indépendamment de tout redressement de la répartition inégale des richesses et toute action correctrice des dysfonctionnements politiques dans les relations internationales. Les attentats du 11 septembre avaient déjà provoqué un séisme dans les représentations du monde. Mais depuis cette date, la problématique de la gouvernance mondiale n’a pas réussi à intégrer comme il se doit les objectifs et les conditions d’une soutenabilité politique de la mondialisation dans la lutte contre le terrorisme. Le 11 septembre a contraint les Etats-Unis à intervenir pour déterritorialiser complètement les groupes terroristes qui ne servaient plus leurs intérêts géopolitiques. L’installation des talibans en Afghanistan, la manipulation des islamistes irakiens par la CIA font partie de l’histoire du terrorisme dans la région, et renvoient à l’époque où les Américains aidaient activement les mouvements islamistes, entre autres, pour contrer l’URSS. C’est l’humiliation ressentie, la peur de l’administration américaine et le sentiment qu’elle a d’avoir manqué à ses devoirs qui est à l’origine du mot d’ordre : degré de tolérance zéro pour le terrorisme… Mais cette critique fondée invite à considérer le contexte historique dans lequel les événements récents se sont produits.
Oui !, «il n’y aura pas de prospérité s’il n’y a pas de sécurité», mais il n’ y a pas non plus de sécurité sans prospérité partagée. Il faut dépasser la violence, vue sous le prisme islamiste, pour s’attacher à la violence tout court, au mal d’être, à la révolte. Il faut admettre que le terrorisme islamiste n’est qu’une facette d’un malaise de civilisation plus large et qui comprend des phénomènes aussi divers que le taux de suicides, la délinquance, le vandalisme, les mouvements ethniques ou régionalistes violents, ou les tueurs fous qui ne sont plus une spécificité américaine. Dans la lutte contre le terrorisme, on peut démanteler des réseaux, prendre des mesures de protection plus efficaces, inviter les entreprises et la finance à y prendre part, encourager les population à la prudence et à la vigilance, emprisonner les sympathisants de tel ou tel groupe mais on ne peut jamais être certain que le terrorisme ne va pas renaître ailleurs sous des formes différentes, visant des cibles nouvelles et imprévues. Parce qu’elle relève autant de la régulation de l’ordre social que du conflit entre Etats, la lutte contre le terrorisme est potentiellement sans fin. Ce n’est pas une guerre qui peut se terminer par une capitulation et un traité de paix. Peut-on alors imaginer que les chocs des récents attentats soient un facteur de progrès dans la correction des inégalités, l’amélioration de la gouvernance mondiale ? Va-t-on inviter au débat les questions d’équité sociale et de légitimité politique qu’une vision étroitement économique avait voulu évacuer. Il faut certainement y œuvrer. Cela dépend des enseignements que les grands de ce monde et les dirigeants politiques tireront des attaques terroristes sur le nécessaire réexamen général des priorités de la politique mondiale et des objectifs des politiques économiques. Il faut espérer qu’ils finiront par comprendre que la sécurité, dans tous ses aspects, appelle un renforcement des instituions de la gouvernance mondiale et à l’échelle des nations et une implication plus forte des acteurs économiques et sociaux dans la conception et la gestion des politiques publiques. Mais tout indique que ce n’est pas acquis.
