Idées
Brouillon de culture
D’autres voix ailleurs qu’en Egypte commencent à s’inquiéter du sort qui sera réservé à la culture et à la création par les régimes qui se réclament de la religion et uniquement de celle-ci.
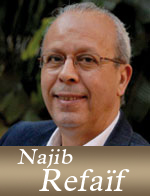
On se souvient, en tout cas pour ceux qui suivent l’actualité culturelle arabe, que lorsque le poète syrien Adonis avait reçu le prix Goethe, il y a un peu plus d’un an, la cérémonie de remise du prix avait coïncidé avec la poursuite des attaques des forces armées syriennes contre la population. Le bilan des victimes était alors de 2 200 morts. Les feux de la rampe de cette prestigieuse consécration avaient valu aussi au poète une salve de critiques de la part de certains intellectuels, journalistes et écrivains arabes, notamment syriens, qui lui reprochaient ses réactions tièdes et surtout tardives quant à la situation dans son pays d’origine. Le poète, en effet, avait montré disons une certaine circonspection et était resté mesuré, voire prudent dans la condamnation des exactions et de la répression commises par le régime contre les manifestants. Echaudé peut-être par les vicissitudes et autres turpitudes des révoltes qui avaient annoncé le fameux «printemps arabe» en Tunisie, puis en Egypte et en Libye, il pensait, au début tout au moins, que les révoltes dans la rue étaient le fait uniquement de courants obscurantistes et craignait une «politique dirigée au nom de la religion, (…) violente et exclusive». Plus tard, dans une intervention dans un journal arabe, il sera plus ferme et clair lorsqu’il a demandé à Assad de quitter le pouvoir et de s’en remettre au peuple. Aujourd’hui, plus d’un an plus tard, que pourrait-il dire encore de plus, de mieux, de plus sage ou de plus intelligent sur ce qui se passe dans cette région du monde ? Et que peut un poète face à la violence des armes et des discours ? Lui qui avait déclaré, à propos de la culture arabe, il y a bien longtemps déjà et bien avant tout ce chambardement : «Nous sommes un peuple en voie d’extinction. (…) Nous n’avons plus la capacité créative d’édifier une grande société humaine, ni de participer à la construction du monde».
On ne peut être plus pessimiste pour un poète arabe, né en Syrie en 1930, sous le nom de Ali Ahmed Saïd, trois prénoms en guise de patronyme troqué contre un pseudonyme mythologique : Adonis, divinité phénicienne représentant un beau jeune homme. Il fut blessé par un sanglier et la déesse Aphrodite le transforma en anémone. Tout un destin. Une immense métaphore. Aujourd’hui, il vit, réside et écrit à Paris depuis des dizaines d’années. C’est dans les années 70 qu’il avait écrit ce beau poème intitulé Les pierres dans lequel on peut lire ce passage prémonitoire : «Montre-lui le chemin, ô nuage. / Il ignore qu’il marche, ô nuage, / sur un astre obscur. /Quand il en sortira pour aller/en direction de la lumière/et du pays secret/dans la patrie du verbe, / il guérira de la guérison de l’oiseau/atteint de plein fouet par le coup/d’une arme à feu». (La poésie arabe. Traduction de René Khawam. Editions Seghers, 1975).
D’un poète l’autre, c’est l’Egyptien Ahmed Abdelâti Hijazi qui s’inquiète, dans un article publié par Al Ahdat Al Maghribya (11 janvier 2013), du sort réservé à la culture par les nouveaux gouvernants arrivés au pouvoir dans son pays. Pour ce poète, c’est un fait : les Frères (musulmans) haïssent la culture. D’emblée, il écrit : «Lorsque les intellectuels et gens de culture que je rencontre m’interpellent sur l’avenir de la culture égyptienne sous le régime “frériste” en vigueur, je réponds que je n’en sais pas plus que vous. Mais regardez un peu ce que les Frères ont produit jusqu’à maintenant en matière de pensée, d’art, de poésie et de prose ; et rappelez-vous ce qu’ils ont dit à propos de la culture et ce qu’ils ont fait subir aux hommes de culture avant même qu’ils n’accaparent le pouvoir. Vous saurez alors ce qu’ils sont capables de produire et de faire dans l’avenir».
D’autres voix ailleurs qu’en Egypte commencent à s’inquiéter du sort qui sera réservé à la culture et à la création par les régimes qui se réclament de la religion et uniquement de celle-ci. Les signes annonciateurs, et qui ne sont pas de bons signes, tendent en effet à indiquer que ce sont les choses de la culture qui inquiètent les nouveaux gouvernants. Mais est-ce une nouveauté ? Lorsqu’on sait que bien avant l’avènement de ce courant politique adossé à une certaine interprétation de la religion, les gens de la culture n’ont jamais été en odeur de sainteté dans le monde arabe. C’est encore et toujours le cas dans d’autres pays de cette région du monde où toute création, innovation ou manifestation de la pensée et de la raison est considérée comme une «bidâa», une hérésie vouée aux feux de la géhenne. Mais le danger dans les sociétés où cette pensée unique et inique règne et se propage, notamment par les nouveaux supports technologiques de la communication dont la modernité sert plus qu’elle ne freine cette tendance, c’est qu’une opinion publique est en train de naître et de se laisser guider sous son influence. Ce qui confirme la lucidité et la pertinence de la formule d’Oscar Wilde : «L’opinion publique n’existe que là où il n’y a pas d’idées».

